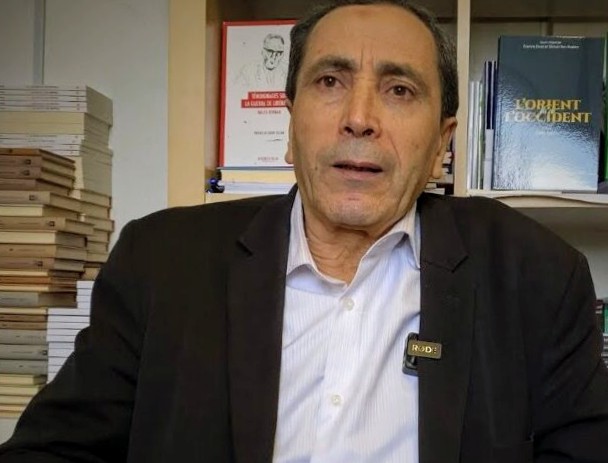Plus de soixante ans après sa première parution, la biographie de Ferhat Abbas écrite par Amar Naroun en 1961 reprend vie grâce à la réédition chez Heritage préparée par l’historien Sadek Sellam.
Cette démarche n’est pas seulement une remise à disposition d’un texte oublié : elle permet de redécouvrir un parcours politique complexe, celui d’un homme qui a cru à l’émancipation pacifique de l’Algérie avant de soutenir la lutte armée, et de mettre en lumière les archives, témoignages et anecdotes qui éclairent d’un jour nouveau sa vie et son action. Dans cet entretien, Sadek Sellam revient sur son travail de réédition, l’importance de Naroun et la place de Ferhat Abbas dans l’histoire et la mémoire algérienne. Au-delà de l’homme politique, cette réédition révèle la dimension humaine de Ferhat Abbas, ses doutes, ses espoirs et ses engagements. Elle met également en lumière le rôle de Amar Naroun, témoin privilégié de l’époque et ami proche d’Abbas, dont la précision et l’acuité des observations offrent un regard unique sur l’Algérie coloniale. Enfin, elle invite les jeunes générations à renouer avec une histoire souvent méconnue, pour mieux comprendre les fondations de la nation et les débats qui ont façonné son indépendance.
Le Matin d’Algérie : Qu’est-ce qui vous a conduit à réunir et présenter à nouveau cette biographie de Ferhat Abbas écrite par Amar Naroun en 1961 ?
Sadek Sellam : Mon travail sur Ahmed Boumendjel m’a fait découvrir des aspects de la personnalité et de la vie de Ferhat Abbas qui ne sont pas suffisamment soulignés dans ce qui a été publié sur lui, sur l’UDMA, et les « UDMistes », comme on dit. Au lieu de lui consacrer un nouveau livre, j’ai préféré rééditer la biographie écrite en 1961 par son ami Amar Naroun, complétée par des documents trouvés dans différents centres d’archives.
Le Matin d’Algérie : En quoi ce texte garde-t-il, plus de soixante ans après sa première parution, une valeur particulière pour comprendre Ferhat Abbas ?
Sadek Sellam : Cette réédition permet d’abord de sortir de l’oubli Amar Naroun, dont l’importance est perdue de vue par la plupart des historiens. Cette biographie est la première à présenter une vue d’ensemble sur Abbas qui faisait l’objet de commentaires parcellaires, d’anecdotes, et de rumeurs. Les révélations et les appréciations faites par Naroun répondaient à un besoin ressenti par ceux qui le connaissaient bien et supportaient mal la désinformation sur son compte. Le livre a été lu dans les camps d’hébergements, dans l’ALN et au sein de l’OPA par des lecteurs qui ne se contentaient pas des « subtilités » du journal Le Monde, alors très lu en Algérie.
Le Matin d’Algérie : On sait que Ferhat Abbas a longtemps cru possible une émancipation pacifique au sein de la République française. Comment expliquez-vous son basculement vers le soutien à la lutte armée ?
Sadek Sellam : Abbas avait une formation exclusivement française et a cru à « l’autre France » que lui ont fait aimer ses maîtres. Il s’est appuyé sur cet enseignement pour combattre le colonialisme au nom des principes de 1789. Mais il s’est aperçu qu’on lui avait donné une image idyllique de « l’autre France ». Il a découvert en même temps l’influence des gros colons sur la classe politique de la France métropolitaine. Il croyait que le bon accueil qui lui y était réservé personnellement allait permettre la satisfaction de ses revendications. Mais il a perdu progressivement ses illusions à l’accumulation d’informations comme celles portant sur les 200 millions qui servirent aux gros colons pour saboter le projet Blum-Viollette.
Le Matin d’Algérie : Vous soulignez l’importance des blocages coloniaux dans cette «radicalisation ». Quels étaient, selon vous, les principaux points de rupture ?
Sadek Sellam : Après les premières désillusions dues à la découverte progressive des réalités de la classe politique de l’entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale a fait entrevoir à Abbas les possibilités d’obtenir un Etat algérien qu’il voulait d’abord « associé » à la France. La circulaire du 7 mars 1944 permit aux musulmans d’avoir des députés et après la création de l’UDMA, Abbas a obtenu 11 députés sur les 13 sièges prévus pour l’Algérie, aux élections de la deuxième Constituante de juin 1946. La Constitution préparée par les députés prévoyait un article rendant possible la transformation des colonies en Etats associés. Selon l’avis de grands professeurs de droit français, cette évolution était possible. Pour s’y opposer, le président du Conseil, Georges Bidault, du MRP (parti de droite) a négocié secrètement avec Maurice Thorez qui fit voter les 150 députés communistes en faveur de la Constitution gouvernementale en échange de l’adoption du statut des fonctionnaires dont le PCF faisait son principal cheval de bataille. C’était là une grande occasion manquée d’obtenir l’émancipation de l’Algérie sans effusion de sang.
Les 11 députés de l’UDMA servirent d’importante force d’appoint qui permit à Vincent Auriol d’être président de la République à l’issue d’une élection serrée. En échange de cet appui, le nouveau président de la République a nommé le préfet Chérif Mécheri secrétaire général du Conseil de l’Union française dont Auriol était également le président. Mécheri, qui se faisait aider par Naroun, rendait de précieux services à l’UDMA. Il plaidait pour le collège unique et recommandait la promotion musulmane.
Le Matin d’Algérie : Amar Naroun connaissait personnellement Ferhat Abbas. En quoi cela donne-t-il à son récit une tonalité différente des biographies postérieures, souvent écrites par des universitaires plus distants ?
Sadek Sellam : Amar Naroun était le fils d’un instituteur de Béni-Yenni, qui avait été formé à Avignon. Il était en France depuis la fin de ses études au lycée Bugeaud d’Alger en1928. Il connaissait bien Saïd, le frère cadet de Abbas, mort au début des années 30 à Paris où il était étudiant. Naroun est devenu l’ami de Ferhat Abbas qui appréciait la précision et l’ampleur de son information et la pertinence de ses jugements sur la classe politique française. Il lui révélait ce que pensait de lui exactement, dans les années 1930, les ténors du Parlement qui l’abreuvaient d’amabilités et multipliaient les compliments sur ses connaissances de la langue, de la culture et des institutions françaises, mais n’en pensaient pas moins.
Grâce à Naroun, qui a pu vérifier la pertinence du proverbe arabe (« c’est ce qui est dit de toi en ton absence qui compte le plus »). Naroun savait qu’Edouard Herriot était hostile aux revendications d’Abbas qui risquaient, selon le chef radical-socialiste, de faire de la « France, la colonie de ses colonies ». Paul Raynaud, qui vouait une réelle estime pour Abbas, pensait à peu près la même chose. Dans les réunions privées, en l’absence d’Abbas, on lui reprochait de ne pas être un assimilationniste intégral. Son assimilationnisme était jugé électoral seulement et sa défense de l’islam et de la langue arabe suscitait une méfiance.
Les universitaires qui écrivent sur Abbas ne connaissaient pas les dessous des cartes comme Naroun, s’en tenaient à un « politiquement correct » et acceptaient censures et autocensures.
Le Matin d’Algérie : On se souvient des manifestations du 11 décembre 1960 à Alger où la foule scandait « Vive Ferhat Abbas ». Ce moment a-t-il été déterminant dans sa reconnaissance internationale ?
Sadek Sellam : Les manifestants de décembre 1960 à Alger scandaient « Algérie musulmane » et « Vive Ferhat Abbas ». Cela permettait de rappeler que à ses détracteurs restées marquées par les polémiques entre le PPA et l’UDMA que le président du GPRA a toujours été un musulman pratiquant soucieux d’affirmer la personnalité musulmane de l’Algérie. Cela l’a fait connaître dans le monde entier où il est devenu plus célèbre que Krim Belkacem qui a pourtant essayé de faire entendre « la clameur de Belcourt à Manhattan » et s’est fait recevoir par Khroutchev à l’ONU. On sait maintenant que les « 3B » avait songé à remplacer Abbas à la tête du GPRA en novembre 1960, juste avant les journées de décembre. Les manifestants de « l’insurrection musulmane » (c’est ainsi que l’appelait Tayeb Boulahrouf) les dissuadèrent de faire un putsch avant la réunion du CNRA où Abbas, malgré sa renommée, a fini par être remplacé par Benkhedda en août 1961. Cette disgrâce l’a ramené à sa première activité, l’écriture. Car avant la politique, il avait pratiqué le journalisme politique. Jacques Berque le considère comme « le fondateur du journalisme politique musulman ». Cette pré-retraite politique lui a permis d’achever à Rabat la rédaction de la « Nuit coloniale », qu’il avait commencé à écrire au Belvédère, sa résidence de la banlieue de Tunis.
Le Matin d’Algérie : Ferhat Abbas est parfois critiqué pour avoir été un « produit de l’école française » avant d’endosser le rôle de président du GPRA. Comment dépasser ce jugement réducteur ?
Sadek Sellam : Comme tous les hommes politiques de sa génération et de la suivante, il était effectivement un pur produit de l’école française. Il en était conscient et déplorait les obstacles à l’enseignement de l’arabe, déclarée « langue étrangère » en Algérie par le Conseil d’Etat en 1933. Cela servait à endiguer les progrès de l’enseignement des Oulamas que Abbas soutenait après la promulgation de la circulaire Michel en février 1933. La revendication de l’enseignement de l’arabe, y compris dans le primaire, faisait partie de toutes les plates-formes de revendication des années 30. Après la guerre, la longue profession de foi, unique, des candidats de l’UDMA, rappelait ces revendications. Quand les Oulémas sont venus à Paris, en novembre-décembre 1950 réclamer la reconnaissance de l’indépendance du culte musulman, maintenu sous contrôle administratif (en fait policier), Ahmed Boumendjel faisait adopter une motion approuvée par 2000 travailleurs algériens et réclamant le financement par l’Etat de l’enseignement de l’arabe aux enfants d’émigrés. En 1946, quand il était à deux doigts d’obtenir un Etat associé, Abbas a donné plusieurs interviews, y compris à des journaux de province, où il promettait un grand ministère de l’émigration chargé de former en France les enfants d’émigrés pour en faire « les cadres de l’Algérie indépendante ».
Le Matin d’Algérie : Quels apports spécifiques apporte cette réédition, notamment en termes de documents d’archives et d’éclairage inédit sur Abbas ?
Sadek Sellam : Outre les révélations de Naroun que l’on ne trouve ni dans les nouvelles biographies d’Abbas, ni dans les écrits sur les « UDMistes », de nombreuses pièces d’archives renseignent avec précision sur l’évolution qui l’a amené à soutenir la lutte armée. Sur les recommandations de Boumendjel (Ahmed, dont on parle moins depuis que son frère Ali a été célébré à l’Elysée), Abbas s’est rendu au Caire pour y rencontrer les Officiers libres, l’émir Abdelkrim et d’autres membres du Bureau du Maghreb arabe (Khider, Allal al Fassi, Nadir Bouzar,…). Boumendjel lui avait expliqué que rien de bon ne sortirait des Assemblées françaises, surtout pas de l’Assemblée algérienne. En 1954, Abbas est revenu au Caire où il a été reçu par Hassan Hodhéibi, guide des Frères Musulmans. Le 2 novembre 1954, il dit au sous-préfet de Sétif (qui venait de Batna et était particulièrement intéressé par les débuts de la guerre) que si la France ne commence pas par proclamer le collège unique avant de reconnaître la République algérienne, il soutiendrait l’ALN des Aurès qui ne comptait aucun membre de l’UDMA. Les archives de Lenoir sont très peu consultées par les historiens de l’Algérie, de plus en plus attirés par la télévision. Même ceux qui les ont consultées, préfèrent ne pas faire état de cette note de Lenoir qui dit avoir été marqué à vie par ce préavis de Ferhat Abbas. Cette omission permet de continuer à vanter les mérites de Abane Ramdane qui aurait été, selon une histoire devenue officielle, à l’origine du soutien du fondateur de l’UDMA à la Révolution.
Les archives révèlent également le rôle d’Abbas dans la diplomatie de guerre algérienne, avant même sa désignation à la tête du service de presse du CCE après le congrès de la Soummam. Seul un historien de l’université d’Alger 2, le professeur Mohamed Khichane a exploité une partie de ces archives dans sa thèse, soutenue en 2013, sur l’action diplomatique du FLN en Europe occidentale de 1956 à 1959. Plus de trente pages sont consacrées aux audiences accordées par Abbas à des journalistes et hommes politiques venus le voir à Montreux de tous les pays européens. Il y a également des interviews réalisés avec Abbas en Suisse, ou au Caire par des journalistes du Monde, mais que Beuve-Méry n’a pas voulu publier, parce qu’il trouvait qu’elles sortaient du « politiquement correct » du moment.
Le Matin d’Algérie : L’historiographie algérienne, parfois marquée par des présupposés idéologiques, a-t-elle sous-estimé ou mal interprété le rôle de Ferhat Abbas ?
Sadek Sellam : En dehors des exceptions comme M. Khichane, et Leïla Benamar Benmansour (qui a étudié Abbas comme journaliste et écrivain) , très peu d’auteurs ont essayé de mieux connaître Abbas pour faire connaître sa démarche. La plupart s’en tiennent à sa lettre au journal le Temps de février 1936, dont il s’est expliqué avec Ben Badis. Ceux qui privilégient l’étude des seuls « novembristes » restent avec leurs préjugés et prennent pour argent comptant les polémiques des lieutenants de Messali contre Abbas, que le chef du PPA n’approuvait pas tout le temps.
Pourtant Abbas devrait intéresser les journaux algériens « indépendants ». Car en tant que fondateur du journalisme politique musulman dans les années 20, il s’occupait personnellement de l’ « Égalité » (fondée en 1944) puis de la « République algérienne » à partir de 1948. Cette publication était un modèle d’acceptation du pluralisme. Par la qualité de ses informations et la pertinence de ses analyses, elle reste sans équivalent jusqu’à nos jours. La « République algérienne » avait une bonne rubrique littéraire tenue par Mme Barrucand, puis par Mme Boumendjel (née Charbonnier, qui signait « Juba III »). Après un compte -rendu élogieux sur « Visages de l’Islam », son auteur, Haïdar Bammate, qui déplorait la déculturation des jeunes Algériens, la « République algérienne » lui a ouvert ses colonnes pour faire connaître l’islam. Ces deux chroniqueuses se souciaient de faire connaître l’Islam aux Algériens francophones bien avant la revue « Jeune Islam », lancée par Mourad Kiouane, et le « Jeune Musulman » lancé par Ahmed Taleb et Ali Mérad dans le même but.
Le Matin d’Algérie : Au-delà de Ferhat Abbas, cette réédition permet aussi de remettre en lumière Amar Naroun. Pouvez-vous nous en dire davantage sur lui et son parcours ?
Sadek Sellam : Amar Naroun (1908-1988) mériterait à lui seul un livre. Il avait lancé le rappel en 1937 qu’il a publié jusqu’à l’aggravation de la guerre mondiale. On y apprend, grâce à Chérif Benhabylès, sur le programme de l’enseignement de Benbadis ce que des spécialistes de l’Islah algérien ne savent pas toujours. Naroun entretenait une relation d’amitié avec Abbas et Boumendjel malgré son appartenance à un courant politique français qu’ils contestaient. Il était député de Constantine élu en 1952 sous l’étiquette « indépendant ». Il a essayé d’industrialiser des régions reculées du Constantinois. Il était en rapport avec les associations d’émigrés algériens, dans le Nord de la France notamment. Ses relations avec les nationalistes, pas seulement algériens, mais orientaux comme les Syriens, et les Tunisiens (il connaissait personnellement Salah Benyoussef) lui valurent de figurer sur une liste de personnalités à arrêter le 2 novembre 1954. En 1955, il fait libérer par son « ami » Edgar Faure des étudiants de l’UGEMA arrêtés arbitrairement par la police. En septembre 1955, il signe la motion des 61 qui coupe l’herbe sous les pieds de Soustelle. Il était le grand-oncle de Khellaf (alias Kasdi Merbah). Dans les années 1980, il publiait une lettre confidentielle aux « franco-algériens » où il dénonçait l’hypocrisie du PS français au sujet de l’émigration, de l’Algérie et du Proche-Orient.
Le Matin d’Algérie : En tant qu’historien et observateur de la mémoire algérienne, comment voyez-vous la place de Ferhat Abbas dans l’imaginaire national aujourd’hui, notamment auprès des jeunes générations ?
Sadek Sellam : L’image d’Abbas mériterait d’être corrigée auprès des jeunes Algériens qui ont besoin d’une meilleure connaissance de leur histoire et de ceux qui l’ont faite, de quelque bord qu’ils soient, et quelles que soient leurs erreurs d’appréciation.
Le Matin d’Algérie : Enfin, que souhaiteriez-vous que le lecteur retienne en priorité de cette biographie et de votre travail de présentation ?
Sadek Sellam : Mon souhait est que les chercheurs algériens qui ne peuvent pas consulter les archives, ni en France, ni en Algérie (où des blocages persistent, malgré des changements dans le personnel des archives) puissent tirer profit des révélations de Naroun et des pièces d’archives mises en annexes. En attendant d’autres publications…
Entretien réalisé par Djamal Guettala