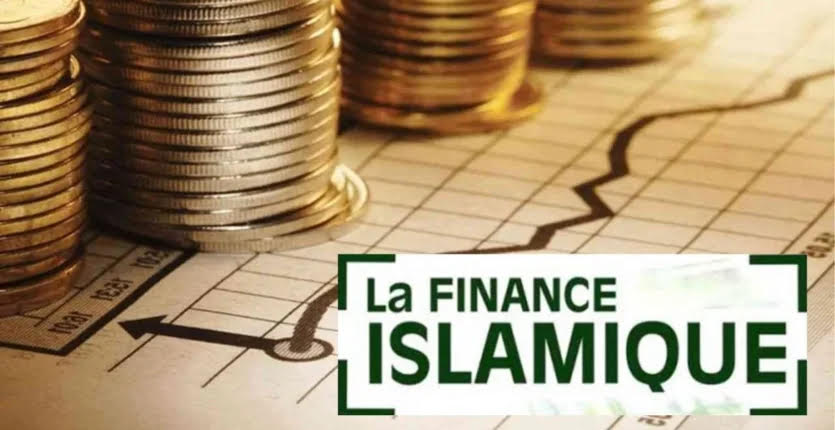Il aura fallu attendre des années, mais c’est désormais chose faite : les souscripteurs de logements LPP en Algérie peuvent enfin transformer leur crédit classique en financement islamique, dit halal. Tout l’art d’un système qui enfonce le pays dans la religiosité.
L’annonce, portée fièrement par le Crédit Populaire d’Algérie (CPA), a été relayée avec emphase par plusieurs médias nationaux. Certains, comme Algérie 360°, n’ont pas hésité à présenter ce mécanisme comme un tournant moral : l’Algérien aurait désormais le choix — ni plus ni moins — entre un crédit halal ou… haram.
Le glissement est subtil, mais terriblement lourd de sens. Derrière cette offre bancaire, présentée comme une victoire du citoyen croyant, se cache une rhétorique culpabilisante. En réduisant le débat à un affrontement entre pureté religieuse et compromission morale, c’est tout un pan de la société algérienne qui se voit sommé de choisir entre piété et péché, foi et faute. Un raccourci dangereux, surtout quand il est relayé sans nuance par les organes de presse.
Car enfin, posons la question simplement : est-ce qu’un enseignant, un retraité, une famille modeste ayant contracté un crédit classique ces dernières années doivent aujourd’hui être considérés comme ayant transgressé un interdit ? Doivent-ils se sentir fautifs d’avoir accédé à un logement via les seuls canaux disponibles à l’époque ? Veut-on vraiment établir une hiérarchie morale entre ceux qui ont « péché par ignorance » et ceux qui, en 2025, peuvent se tourner vers le financement « halal » ?
La finance islamique, en tant qu’outil alternatif, a toute sa place dans le paysage bancaire. Mais à condition qu’elle reste un choix, et non un jugement déguisé. Une offre économique, pas une arme idéologique. À condition aussi que les institutions financières ne se transforment pas en prescripteurs religieux, investis d’une mission morale qui n’est pas la leur.
Le problème ne réside pas dans l’existence de la finance islamique — encore heureux que l’État diversifie ses produits bancaires — mais dans le discours manichéen qui l’entoure. Car à force de faire croire qu’il y aurait désormais deux types d’Algériens — les « halal » et les autres — on alimente une polarisation insidieuse, une forme de pression sociale et religieuse déguisée en progrès bancaire.
Et ce n’est pas anodin. Dans un pays où les tensions identitaires, religieuses et sociales sont déjà vives, ajouter cette couche morale à un acte purement économique revient à tendre une corde supplémentaire dans une société déjà surchargée de lignes de fracture.
L’Algérien mérite mieux qu’un chantage à la vertu. Qu’une économie assise sur une religiosité douteuse. Il mérite un choix éclairé, non un tri moral. Il mérite des politiques de logement transparentes, équitables, et respectueuses de sa dignité — qu’il emprunte en halal ou pas.
Mourad Benyahia