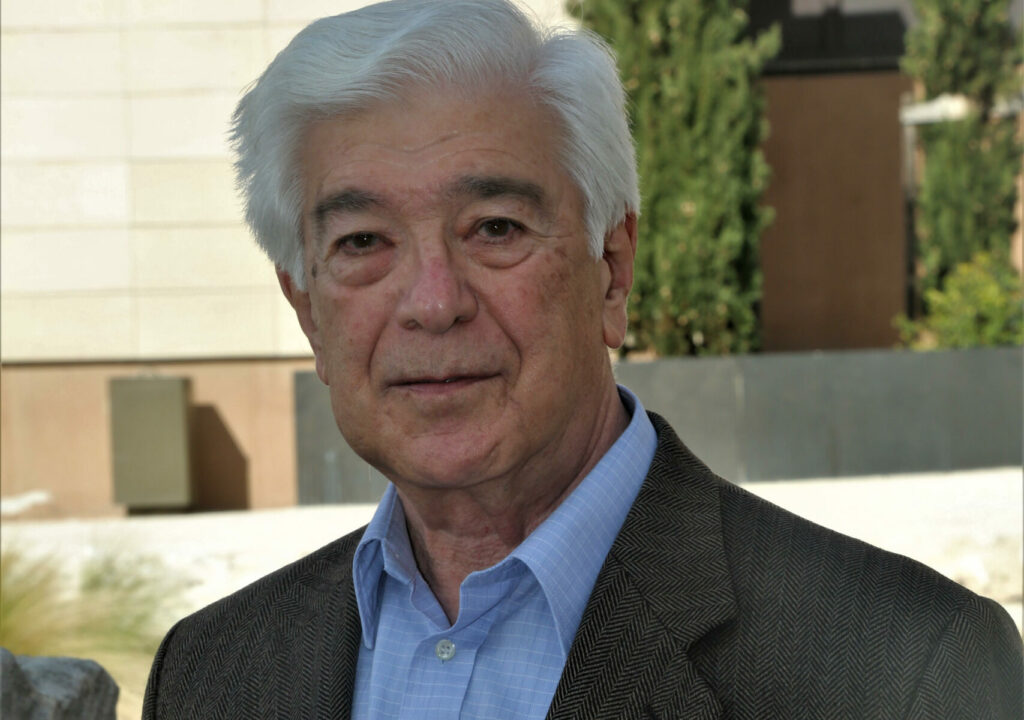Longtemps, l’histoire de Marseille s’est écrite à la lumière du récit grec, façonnée par la tradition phocéenne et les chroniques de Justin. Dans Marseille phénicienne, publié aux éditions Maïa, Gabriel Chakra propose une relecture audacieuse et solidement étayée : celle d’une cité aux origines bien plus anciennes, ancrées dans la présence phénicienne, longtemps éclipsée par le mythe fondateur hellénique.
Archéologie, linguistique et analyse critique des sources antiques se conjuguent ici pour redonner à la ville une profondeur méditerranéenne plurielle, affranchie des récits dominants. Dans cet entretien accordé au Matin d’Algérie, l’auteur défend une idée forte : Marseille doit être replacée dans le vaste réseau d’échanges des civilisations orientales et méditerranéennes. Un travail d’enquête exigeant, nourri de doute, de rigueur et d’intuition, pour rouvrir le dossier de la mémoire marseillaise — et en libérer la vérité.
Le Matin d’Algérie : Votre livre remet en cause une version très ancrée de l’histoire marseillaise. Qu’est-ce qui vous a conduit à réexaminer cette origine grecque que l’on croyait indiscutable ?
Gabriel Chakra : Le doute ! C’est ce qui m’a conduit à revisiter l’histoire de Marseille. Car, telle qu’elle nous est narrée par Justin, prosateur latin du 2e siècle après notre ère, et auteur du texte essentiel sur la fondation de Marseille « vers 600 avant J.-C. », ce récit suscite le questionnement. D’abord, cette datation est très vague, et oblige ensuite à une étude sérieuse de la Méditerranée.
Justin n’étant point précis, on peut établir sur la base des données géopolitiques une estimation haute, 660 avant notre ère, quand les Phocéens se dotent d’une marine opérationnelle ; et une estimation basse, 546, qui correspond à la prise de Phocée par les armées de Cyrus et la fuite des habitants : c’était la valise ou le cercueil.
Il n’y a pas d’autre façon de calculer.
Le problème, c’est qu’entre ces dates, il y a plus d’un siècle. 115 ans, c’est beaucoup. Que ce soit dans l’Antiquité ou à n’importe quelle époque, sur une telle durée des événements surviennent inévitablement, heureux ou tragiques, qui bouleversent ou modifient les conjonctures politiques, sociales et culturelles d’une région. C’est ce qui m’a frappé en lisant Justin, toujours présenté comme l’abréviateur de Trogue-Pompée, sans autres détails. Pas un mot sur sa personnalité, sur son style ou sa méthode. Des lacunes qu’il fallait combler, si je devais écrire un jour sur le sujet.
Justin a pioché sans vergogne dans les Histoires philippiques de Trogue-Pompée, originaire de Vaison-la-Romaine, une somme de 44 livres portant sur Rome, bien sûr, mais surtout sur le monde oriental, de la Macédoine de Philippe II à Ninus, le fondateur de Ninive, une des plus vieilles cités de Mésopotamie. Tout un espace géographique auquel Justin, qui ne connaissait rien de l’Asie mineure, donne une tournure rhétorique. La rhétorique ne se fonde pas sur le vrai, sur la certitude du fait réel, authentique, mais sur le plausible, le vraisemblable. Aucun historien, à l’exception de Michel Clerc, n’a eu la curiosité de confronter sérieusement les écrits de Justin aux récits d’autres prosateurs de l’Antiquité, de procéder à une analyse scripturaire des faits. Car le récit de Justin contient des invraisemblances, des décalages dans la concordance des âges, sans oublier l’utilisation de la légende (le mariage de Gyptis et Protis, une fable !) C’est précisément ce que fait Justin. Et c’est là où chez moi le doute a sonné l’alerte !
Le Matin d’Algérie : Quelles sont, selon vous, les principales preuves archéologiques ou linguistiques qui attestent d’une présence phénicienne à Marseille avant les Phocéens ?
Gabriel Chakra : Les preuves archéologiques et linguistiques de la présence phénicienne à Marseille sont évidentes, mais soigneusement dissimulées – ou plutôt occultées – par les érudits locaux, universitaires ou appartenant aux élites de la ville.À ce sujet, je voudrais que l’on m’explique ce qu’il y a d’infamant ou de dégradant à admettre une présence phénicienne avant celle des Phocéens. L’origine orientale de Marseille serait-elle si méprisable en l’opposant à la filiation grecque ? J’ai écrit ce livre pour en débattre. Cependant les prétendus « fins connaisseurs » de Marseille ne se manifestent pas. Ni courageux ni téméraires ! L’élément principal à noter, n’en déplaise aux philhellènes, c’est que Marseille était déjà une cité avant l’arrivée des Grecs d’Ionie.
Une cité est un milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins et de ses activités, avec la volonté de vivre ensemble. C’est exactement ce qu’était Marseille avant les Grecs. Strabon écrit que les marins grecs parvenus à Marseille « bâtirent un sanctuaire et honorèrent leur déesse Aristaché en la désignant comme prêtresse. » Mais ce qu’il ne dit pas, qui remettrait en cause la version grecque de la fondation de Marseille, c’est qu’un sanctuaire préexistait. Où ? Près de l’ancienne Major, plus précisément rue Rouge, une voie de passage rasée sous le règne de Louis-Philippe. Ce sanctuaire était phénicien. C’est là que fut découverte en 1845 la pierre connue sous le nom de « Tarif de Marseille » (sa photographie illustre la couverture de mon livre) par un maçon, le dénommé Allègre, travaillant dans les entrailles d’une vieille maison érigée à cet emplacement. Je raconte tout cela dans le détail. Ce vestige est la « pierre de Rosette » de Marseille.
Les Phéniciens y avaient un comptoir greffé sur l’économie locale, et le noyau du comptoir était ce sanctuaire où ils se plaçaient sous la protection de leur dieu El (prononcez Il), Baal ou Melkart. La diffusion du culte phénicien était la pierre de touche des alliances commerciales avec les Ligures, auxquels ils livraient tissus, huile, bois de cèdre, métaux précieux, bijoux et armes. Et j’ajoute que leurs navires, bateaux de 25 m de long et 50 rameurs, étaient amarrés dans l’anse de l’Ourse, l’actuelle place de la Joliette, face au Fioul, avant son comblement lors de la percée de la rue de la République, qui relie le Vieux-Port à la Joliette. D’autres navires phéniciens faisaient relâche à Pomègues notamment, le Frioul autrefois appelé « l’ile des Phéniciens ». Les vrais et honnêtes historiens que furent Jean-Baptiste Grosson, Michel Clerc et André Bouyala d’Arnaud ne l’éludent pas. Mais qui les lie ? Qui en fait référence ? À propos des vestiges, vous noterez la découverte en 1856 d’une pierre semblable au « Tarif », dans les fondations de la boulangerie Saint-Victor de M. Meiffredy, à l’angle du boulevard de la Corderie et de l’abbaye éponyme. Qui en parle ? Qui en fait référence ? Rien n’est affirmé ici qui ne soit corroboré par des faits précis et datés.
Il est tout à fait vraisemblable que la fondation de Marseille ait été précédée par la création d’un ou de plusieurs comptoirs exploités avant l’arrivée des Phocéens. Ceux-ci n’ont fait que suivre les voies phéniciennes dans leur reconnaissance de l’Occident. On ne part pas d’un point A (Phocée) vers un point B (Marseille) distant de 2 500 km, si celui-ci n’existe pas.
Pour ce qui est de la linguistique, le mot Massalia est la transposition hellénisée de l’ancienne dénomination du lieu où débarquèrent les marins ioniens, mais ce nom ne s’explique par aucun radical grec. On me l’a confirmé à Athènes.
La vérité est que MarsaElia était cette ancienne dénomination. Partout en Méditerranée où le nom d’une ville, généralement un port, porte le radical Marsa, cette ville est d’origine phénicienne.
C’est le cas de Marsa Matrouh en Égypte, de Marsaxlokk à Malte, de Marsala en Sicile, de La Marsa en Tunisie, de Mers-el-Kébir en Algérie. Pourquoi Marseille ferait-elle exception ?
Le Matin d’Algérie : Vous évoquez un “sanctuaire phénicien” sur le site de la future Massalia. Où situeriez-vous ce lieu et quels indices en témoignent ?
Gabriel Chakra : Le sanctuaire phénicien, mentionné plus haut, était à côté de la Vieille Major, à proximité de l’actuelle cathédrale de la Major.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi, selon vous, cette dimension phénicienne de l’histoire marseillaise a-t-elle été si longtemps occultée ou minimisée par les milieux académiques ?
Gabriel Chakra : La dimension phénicienne de l’histoire de Marseille a été occultée par les milieux académiques pour une raison simple : il est plus prestigieux, à leurs yeux, de se rattacher à une filiation grecque, ou gréco-romaine, qu’à celle d’un peuple de race sémitique. J’y décèle un petit relent de xénophobie. Le paradoxe est que Marseille est définie par ceux-là mêmes comme une ville cosmopolite et pluriethnique !
Le Matin d’Algérie : Vous parlez d’un “refus idéologique” de reconnaître cette filiation sémitique. Pensez-vous qu’il existe encore aujourd’hui un biais culturel ou identitaire dans la manière dont on enseigne l’histoire méditerranéenne ?
Gabriel Chakra : Il n’y a pas UNE mais SEPT Méditerranées : la mer d’Alboran (la passe de Gibraltar), la mer des Baléares, la mer Tyrrhénienne, la Méditerranée Ouest, la mer Ionienne, l’Adriatique et la mer Égée. Toutefois, au lieu d’enseigner l’histoire de ce Bassin à travers ses SEPT mers, chacune ayant sa particularité et son histoire, on la considère dans sa globalité, c’est-à-dire sur 3 800 km, de Tyr à Gibraltar. Manière d’occulter les « sauts de puces » qui ont permis aux Phéniciens, dès le XIIe siècle avant notre ère, d’étape en étape, de fonder villes et comptoirs.
Le Matin d’Algérie : Dans votre livre, vous évoquez une “extravagance de la mémoire marseillaise”. Qu’entendez-vous par là ? Marseille serait-elle victime de sa propre mythologie grecque ?
Gabriel Chakra : C’est à cause de la manière dont on enseigne l’histoire méditerranéenne que j’invoque une « extravagance de la mémoire marseillaise ». Il est temps de remettre cette ville dans son axe véritable, sur sa bonne échelle, la vraie. Comme je l’écris, « ils ne peuvent, et sans doute ne le souhaitent-ils pas, s’affranchir d’une spécificité identitaire et culturelle, ce qui les amènerait à se renier. La tradition pèse ici lourdement. C’est elle qui dicte sa loi ! » Oui, Marseille est victime de sa mythologie grecque. L’héritage de Justin et consorts !
Le Matin d’Algérie : Votre démarche s’apparente à une “contre-enquête”. Comment avez-vous procédé concrètement ? Quelles sources, archives ou terrains avez-vous explorés ?
Gabriel Chakra : Jeune journaliste en 1969, je lisais et entendais dire que Marseille était d’origine grecque. Happé par mon travail, je n’avais ni le temps ni la compétence pour examiner le sujet. Je l’ai donc abandonné avant d’y revenir il y a une dizaine d’années.
Je vous ai parlé du doute. Il y avait aussi une grande part d’intuition après avoir lu l’Abrégé des histoires philippiques de Justin… Pour mettre tout cela en lumière, il m’a fallu du temps, la lecture de nombreux livres, une véritable contre-enquête qui m’a demandé une somme de travail considérable. Je répète que la démarche de Justin était littéraire et non point historique. C’était « ça » qu’il fallait d’abord débusquer, puis dénoncer, et entamer le récit sur une base nouvelle.
Le Matin d’Algérie : Le rapport entre Marseille et Carthage que vous établissez redessine la carte des influences méditerranéennes. Comment cette lecture pourrait-elle changer la perception que les Marseillais ont de leur ville ?
Gabriel Chakra : Dans sa longue histoire, Marseille s’est trouvée en contact, tantôt amical, tantôt concurrentiel, souvent hostile avec les Carthaginois, sans pour autant cesser les relations commerciales… Aujourd’hui, faute d’être informés en toute objectivité, la quasi-totalité des Marseillais ignorent ces liens commerciaux. La seule perception qu’ils ont de leur ville est l’horizon grecque. C’est une obsession !
Le Matin d’Algérie : On connaît votre parcours de journaliste et de chercheur indépendant. En quoi cette double expérience a-t-elle nourri votre méthode d’investigation historique ?
Gabriel Chakra : Ce que je vous dis là explique ma méthode. Celle-ci est fondée sur mes connaissances certes, mais aussi sur la logique, le bon sens, la déduction.
Le Matin d’Algérie : Certains historiens pourraient vous reprocher une lecture trop “symbolique” ou “interprétative” des faits. Que leur répondez-vous ?
Gabriel Chakra : Je leur réponds qu’il n’y a rien de symbolique dans mon livre Marseille phénicienne. Tout ce qui est affirmé est corroboré par des faits précis et datés. D’ailleurs, le livre récent d’Eitan Burstein, L’Étymologie de Marseille (2024), conclut à une « probable origine phénicienne » de la ville. Je suis ravi qu’il abonde dans mon sens.
Le Matin d’Algérie : En filigrane, votre ouvrage interroge aussi notre rapport à l’identité. Derrière l’histoire phénicienne de Marseille, n’y a-t-il pas un appel à repenser la Méditerranée comme un espace métissé, partagé ?
Gabriel Chakra : Mon récit traite effectivement de l’identité de Marseille. On ne peut plus continuer à penser et encore moins à écrire l’histoire de la plus ancienne ville de France sur le canevas traditionnel. Comme je le dis dans ma conclusion, il faut la replacer dans un mouvement plus général, où tous les peuples ont leur place.
Le Matin d’Algérie : Enfin, après Marseille phénicienne, avez-vous un autre chantier d’écriture en cours ? Peut-on s’attendre à une suite ou à une exploration d’autres ports méditerranéens liés aux Phéniciens ?
Gabriel Chakra : Je viens de terminer le manuscrit de mon prochain livre : Marseille, le soleil et le sang, 3 000 ans de tragédies. Des Phéniciens à nos jours, la vieille cité marchande a subi nombre d’épreuves : déferlement d’envahisseurs, saccages et incendies, peste et choléra, bombardements, destruction des vieux quartiers, etc. Mais avec toujours cette aptitude au rebond qu’elle puise dans son énergie, sa force vitale. Cette ville est un miracle !
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Gabriel Chakra est journaliste et historien marseillais. Après plus de trente ans au quotidien Le Méridional, il a contribué à documenter la vie locale et à valoriser le patrimoine de Marseille. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Marseille phénicienne : Chronique d’une histoire occultée, il explore les facettes méconnues de l’histoire de la ville. Membre correspondant de l’Académie des Lettres, Sciences et Arts de Marseille, il se distingue par son engagement pour la mémoire et la culture locales.