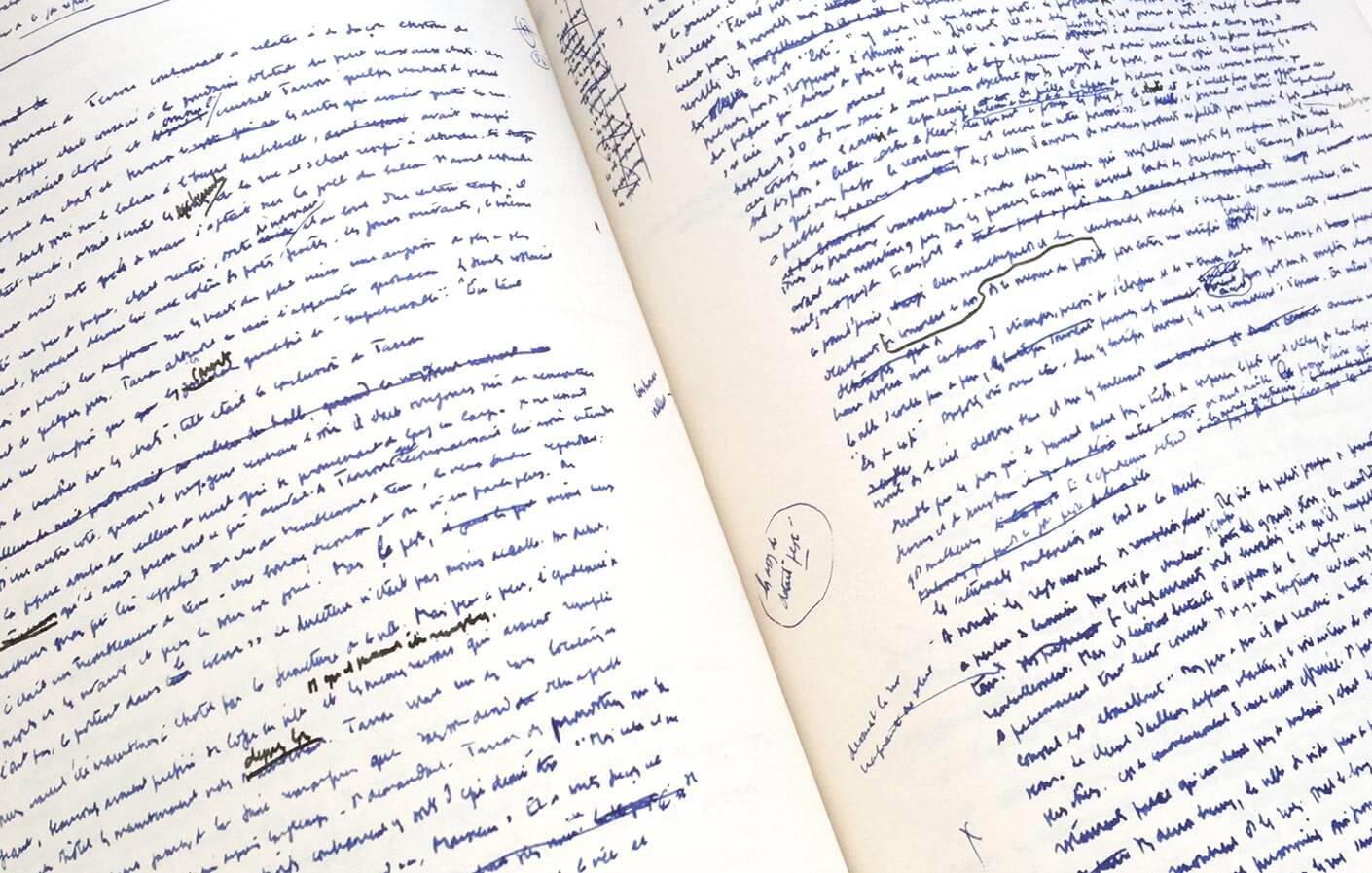
« (…) il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. » Albert Camus
L’Algérie nouvelle semble aspirer à un tri obsessionnel vouant certains groupes à l’absence et l’effacement forcé. Tout comme la Peste dans le roman, cette volonté d’épuration cherche à ériger des frontières étanches entre entités sociales. Pourtant, à l’image de ce que montre l’œuvre, un tel idéal de cloisonnement pur est chimérique et illusoire. Car la présence de l’altérité, qu’elle soit politique, culturelle ou identitaire, est une force avec laquelle il faut composer de manière constructive plutôt que de chercher vainement à l’éradiquer.
Comme le révèle la confrontation avec la maladie, la négation de l’autre ne peut conduire qu’à l’anéantissement de soi. A l’inverse, accepter la présence inaltérable des différences au sein du tissu social, tel est le gage d’une résistance pacifique face à la démesure d’un fléau. C’est seulement dans la solidarité avec autrui et non son exclusion que peut naître la résilience nécessaire au progrès d’une collectivité.
Telle nous semble être la leçon majeure qu’il convient de retenir de ce roman de Camus.
La Peste de Camus est un roman prémonitoire du totalitarisme, des dérives morales de l’ordre social. Écrit juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale, La Peste se déroule en 1940 dans une ville algérienne paisible : Oran. C’est un roman spatial. Tout l’enjeu de l’intrigue semble tourner autour de l’espace où se meuvent les différents personnages ; arène où se joue le tragique de la vie.
Au printemps 1940, la ville algérienne d’Oran est frappée par un fléau insidieux : une épidémie de peste bubonique. Les premiers signes sont troublants – prolifération anormale de rats morts – mais passent inaperçus. Très vite, l’épidémie se propage de manière exponentielle à travers la population.
La ville est placée en quarantaine, paniquée et désorientée. Sous la houlette du docteur Rieux, une équipe de personnages divers se mobilise pour lutter contre la maladie et ses ravages, au prix de sacrifices personnels. Dans le même temps, chaque individu est confronté à la peur, au deuil et à des choix éthiques cruciaux.
Des solidarités inédites émergent face à la terreur panique, tandis que des voix s’élèvent pour dénoncer l’absurdité de la condition humaine. Après de longs mois de lutte acharnée, marqués par d’innombrables morts, l’épidémie finit par régresser, laissant la ville exsangue mais unie par l’épreuve traversée. Celle-ci aura révélé le meilleur et le pire de la nature humaine.
Dans le premier chapitre, le narrateur dépeint méticuleusement la ville d’Oran, cadre de l’intrigue, à travers le regard du docteur Rieux. Il en brosse un portrait assez terne et sans relief. Oran apparaît comme une ville ordinaire, sans véritable caractéristique notable au premier abord, si ce n’est un climat aride et étouffant. Cependant, en creusant davantage, on décèle quelques traits saillants de cet espace urbain.
Tout d’abord, c’est une ville moderne, tournée résolument vers le commerce et les affaires, où les habitants travaillent sans répit pour s’enrichir, sans se soucier d’autres considérations.
Cette focalisation sur l’économie va de pair avec un certain confinement dans des habitudes routinières qui étouffent toute velléité d’émancipation. De plus, sans végétation ni âme, c’est une ville sèche, où le climat ardent rend la vie éprouvante, notamment pour les malades privés de réconfort.
On note également que cette cité tient ses aspirations enfermées “derrière des centaines de murs” et tourne le dos à sa magnifique baie, soulignant son repli sur elle-même.
Ainsi, Oran semble marquée par une certaine forme de monotonie, voire d’étouffement et d’enfermement physique et métaphorique de ses habitants dans leurs habitudes. C’est donc un espace normé, replié sur lui-même et peu ouvert aux changements, ce qui préfigure l’éclatement d’une crise majeure bousculant cet ordre établi.
L’espace tel que dépeint dans ce texte de Camus, oscille habilement entre ouverture et fermeture, reflétant avec subtilité les tensions internes qui habitent la cité d’Oran. D’un côté, la ville apparaît comme un lieu fermé, replié sur lui-même. Ses habitants piégés derrière « des centaines de murs » vivent dans la routine et le carcan des habitudes. Oran tourne le dos à sa splendide baie, symbole d’ouverture vers l’ailleurs.
Mais dans le même temps, des brèches sémantiques laissent entrevoir une certaine porosité. Le docteur Rieux, du fait de ses fonctions, incarne une figure liminaire entre dedans et dehors, public et privé. Ses allers-retours révèlent une ville non hermétique. De même, l’irruption soudaine des rats morts fait office de rupture dystopique, en dépit des dénégations du concierge attaché aux apparences. Cet incident annonce l’imminente effraction du fléau dans la cité.
Par ailleurs, les personnages secondaires introduits sont pour la plupart des figures de passages : le journaliste, la mère du docteur. Leur présence suggère des échanges et une perméabilité, fût-elle contenue. Ainsi, derrière la réclusion assumée d’Oran transparaît en filigrane l’inéluctabilité des infiltrations extérieures, qu’elles soient physiques ou idéelles.
« Nedjma » un regard aigu sur la société algérienne prérévolutionnaire
L’espace urbain oscille habilement entre enfermement et ouverture aux perturbations à venir, préfigurant l’irruption tellurique de l’épidémie. En somme, cette dialectique spatiale en latence inaugure la thématique camusienne de la révolte comme ouverture de soi face à l’absurdité du monde, malgré les mirages de l’enfermement quotidienne.
-
L’analyse de l’espace dans La Peste de Camus à l’aune des catégories tensives est très éclairante.
Tout d’abord, l’espace initial de la ville d’Oran avant l’épidémie était ouvert, perméable aux flux et aux échanges entre l’intérieur et l’extérieur. Mais dès l’arrivée de la peste, on assiste à une fermeture progressive de cet espace, selon une logique inverse typique de la grammaire tensive. La ville se mue en espace clos, parfaitement délimité, où nul ne peut plus entrer ni sortir. Cette fermeture spatiale s’accélère à mesure que la maladie gagne en intensité. Quarantaines, barrages sanitaires, cordons de sécurité se multiplient pour circonscrire au maximum le fléau.
« Nedjma » un regard aigu sur la société algérienne prérévolutionnaire (II)
L’espace urbain devient un huis-clos angoissant où chaque rue, chaque maison peut recéler le danger mortel. De manière intéressante, on relève çà et là des espaces intermédiaires, ni tout à fait fermés ni vraiment ouverts. Les camps de suspect où sont parqués les possibles malades en sont l’illustration la plus nette. Ainsi, selon une logique tensive rigoureuse, l’espace du roman passe progressivement d’un pôle ouvert à un pôle fermé dominant, traduisant l’emprise grandissante de cette force pathogène qu’est la peste. (A suivre)
Saïd Oukaci, Doctorant en sémiotique
