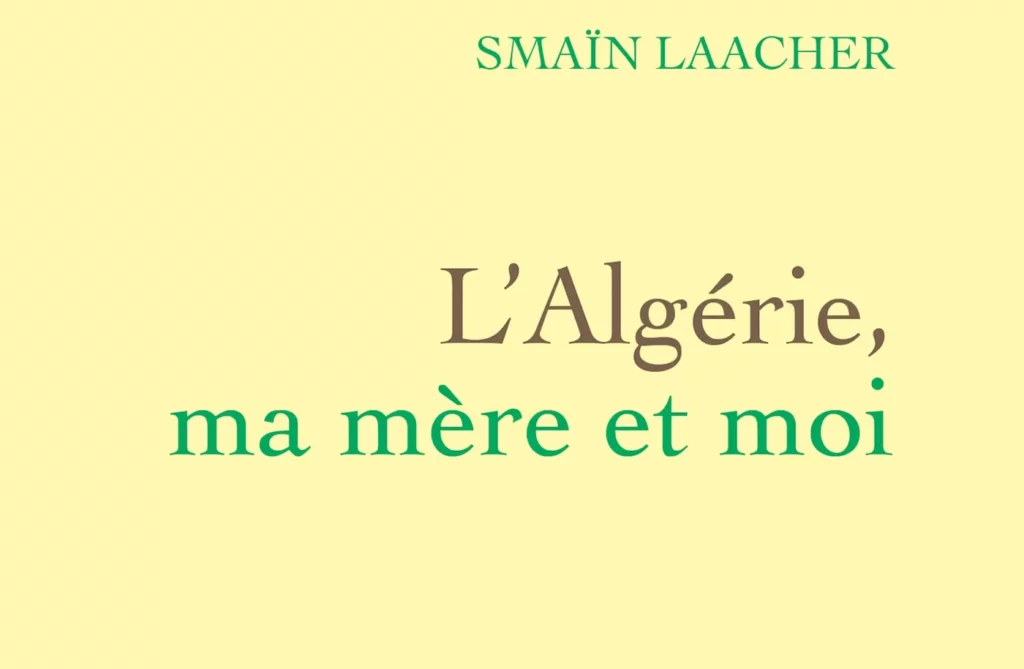C’est un livre dense, intimiste et touchant qu’est L’Algérie, ma mère et moi que vient de publier Smaïn Laacher aux éditions Grasset.
Il se situe à mi-chemin entre le témoignage intime et la réflexion sociologique. L’auteur, universitaire et sociologue, explore sa relation avec sa mère, elle-même issue de l’émigration algérienne vers la France en 1952, peu avant la guerre d’indépendance. Il y évoque pêle-mêle le déracinement de la mère, l’installation en France, la difficulté à appartenir pleinement à la terre d’accueil ou à la terre d’origine, l’impérieuse obligation de faire face à la vie, au veuvage et la dure réalité de l’immigration. Ce que l’auteur raconte en pelures sur sa mère est sans doute commun à des milliers de femmes exilées par mariage et confrontées à cet autre pays et univers étrange et étranger.
Avec L’Algérie, ma mère et moi, publié chez Grasset, le sociologue Smaïn Laacher signe un texte à la fois intime et universel. Derrière le récit d’un fils face à sa mère se dessine le portrait d’une génération entière, ballottée entre deux terres et deux langues, entre la mémoire de l’Algérie et la réalité de la France.
Né en Algérie et arrivé enfant en France, Laacher n’en est pas à son premier livre sur la migration. Mais ici, il délaisse les concepts pour le murmure des souvenirs. Sa mère, arrivée en 1952 d’un village des Aurès pour rejoindre son mari ouvrier, ne s’est jamais vraiment installée. Elle vit, écrit-il, « dans l’imaginaire de son pays de naissance ». Le fils, lui, grandit dans un autre monde : celui de la langue française, de l’école républicaine, de la modernité. Entre eux, un mur invisible : celui des mots qui ne passent pas.
Le récit se lit comme une enquête du cœur. Une photographie de cette mère qui dut mener sa vie, avec ses codes. « Il fallait lui montrer notre allégeance par des mots répétés quasi mécaniquement », écrit Smaïn Laacher. L’Algérie, ma mère et moi est propre histoire écrite sans emphase avec la rigueur du chercheur et la pudeur du fils.
Il décrit les gestes, les silences, les phrases cassées de cette mère analphabète dans la langue du pays d’accueil. Ce qui l’intéresse, sans doute, ce n’est pas seulement la douleur du déracinement, mais le malentendu durable entre deux cultures qui cohabitent sans se comprendre. La France, écrit-il, a offert à ses enfants la liberté d’apprendre, mais au prix d’une séparation : « Ma mère ne savait pas ce que je devenais. Elle me perdait dans une langue qu’elle ne parlait pas. »
Dans ce texte bref mais dense, Laacher fait dialoguer deux voix : celle du sociologue qui ausculte les migrations, et celle du fils qui tente de sauver, par les mots, ce que le silence a englouti. La relation mère-fils devient le miroir d’une fracture plus large : celle entre les générations d’immigrés et leurs enfants nés en France, entre la fidélité au pays d’origine et l’appel du pays d’accueil.Il confie cette fracture permanente entre la mère et ses enfants.
La prose est simple, limpide. Elle est tout en retenue, pleine de pudeur. Son écriture, dépouillée, presque clinique, n’en est que plus bouleversante. Il y a une considération non feinte à cette maman qui a élevé ses enfants seule dans ce pays qui lui est resté étranger.
On sent la gratitude, mais aussi une certaine mélancolie : celle d’un homme bien conscient que l’intégration n’efface jamais tout à fait la nostalgie du pays perdu, que chaque langue apprise laisse derrière elle un territoire perdu. Que l’apprentissage d’une autre langue pour ces personnes est comme un arrachement à la première. À travers la figure de sa mère, c’est tout un pan de l’histoire franco-algérienne que Laacher fait surgir, dans sa complexité et sa tendresse.
L’Algérie, ma mère et moi questionne notre rapport collectif à la mémoire migratoire. Ce n’est pas un livre sur la guerre d’Algérie, mais sur ses séquelles silencieuses : la difficulté à transmettre, à parler, à se comprendre d’une rive à l’autre.
Par sa clarté, sa sensibilité et son intelligence, ce texte s’impose comme un hommage discret à ces femmes venues d’ailleurs, souvent muettes dans les récits officiels, mais dont le courage a façonné la France d’aujourd’hui. En refermant le livre, on garde en tête l’image d’un fils penché sur la mémoire de sa mère, comme pour lui redonner, à travers l’écriture, la parole qu’elle n’a jamais eue.
Yacine K.