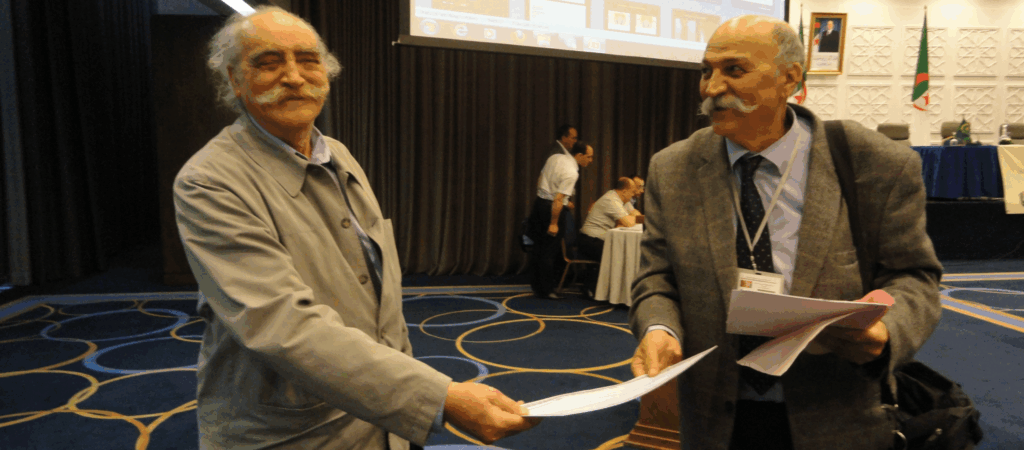Le Professeur Mustapha Maaoui, chirurgien de renom et ancien président du comité pédagogique national de chirurgie, revient sur un demi-siècle de pratique médicale à travers son livre Histoires de la chirurgie – Jeux de mains, jeux de mots (Casbah Éditions). Dans cet entretien, le Pr Maaoui raconte l’évolution technique et éthique de la chirurgie, les rencontres marquantes de sa carrière et l’influence des contextes historiques sur sa vocation.
Le Matin d’Algérie : Votre livre retrace le long parcours de la chirurgie à travers les siècles. Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette histoire et de la raconter de l’intérieur ?
Professeur Mustapha Maaoui : Quand j’ai pris ma retraite en 2023, cela faisait exactement 50 années que je m’étais aventuré dans ce monde très particulier de la médecine avec, dès le départ, l’intention de m’orienter vers la chirurgie. Tous les retraités ne rêvent pas nécessairement de grasses matinées ou de pêches miraculeuses. J’ai ressenti un vide immense que j’ai voulu combler en poursuivant une activité modérée en privé et surtout en me consacrant à l’écriture. Après un premier livre qui raconte une saga sur fond du XXᵉ siècle et de tous les événements qui l’émaillèrent (Éclats de vie. Mémoires synaptiques, Casbah Éditions), j’ai décidé de parler de la chirurgie qui avait accompagné l’Homme depuis qu’il existe et qui a pris sa forme contemporaine avec la maîtrise de l’asepsie, de l’antisepsie, du contrôle de la douleur (antalgiques), des hémorragies (hémostase), du curare pour l’abord des viscères abdominaux, c’est-à-dire une période couvrant à peine un peu plus d’un siècle et demi. On sait par ailleurs que les guerres étaient souvent à l’origine de progrès de la médecine et surtout de la chirurgie.
Avec les deux guerres mondiales ainsi que les guerres de décolonisation (Indochine-Vietnam, Algérie), ou encore le terrorisme de la décennie noire, il y avait de quoi faire. Plus récemment débuta l’ère des transplantations d’organes. La première transplantation, attribuée au seul Christian Barnard, brillant chirurgien narcissique et dépourvu de scrupules, eut un retentissement comparable à celui des premiers pas de l’Homme sur la lune. Les transplantations rénales, hépatiques, pancréatiques, intestinales, etc., prirent le relais. Puis les progrès technologiques occupèrent le devant de la scène avec l’avènement de la chirurgie laparoscopique, puis robotique, ouvrant la voie à la télé-chirurgie comme nouvelle chirurgie. C’est une période exaltante mais qui comporte des zones d’ombre qui imposent des précautions d’ordre éthique et qui peut poser au législateur la révision de la notion de responsabilité. Ayant vécu tous ces événements, il m’a semblé utile de témoigner.
Le Matin d’Algérie : Le sous-titre « Jeux de mains, jeux de mots » interpelle. Quelle place occupe l’humour, l’ironie ou le jeu dans votre manière d’aborder une discipline aussi sérieuse que la chirurgie ?
Professeur Mustapha Maaoui : Le titre initial que j’avais proposé était Histoires de la chirurgie. De fil en aiguille. La conseillère littéraire de mon éditeur, le professeur Aïcha Kassoul, a proposé le titre définitif qui résume, me semble-t-il, un certain état d’esprit qui anime une partie des chirurgiens. Vous conviendrez avec moi que le métier de chirurgien est des plus stressants qui soient. Pour conjurer le mauvais sort, certains ont recours à la musique classique pour apporter une touche apaisante, d’autres chantent, souvent des chansons de salles de garde, lors de moments de grande difficulté, à la manière des soldats qui montent au front et qui ont besoin d’hymnes ou de trompettes pour préserver leur ardeur.
Certains enfin s’en remettent au Seigneur par quelques formules incantatoires murmurées du bout des lèvres. Les plus nombreux, hélas, ont recours à l’invective et aux remontrances souvent sonores pour attribuer les difficultés opératoires à l’aide peu vigilante, au scialytique qui éclaire mal, au malade qui ne dort pas suffisamment et qui « pousse » (reproche indirect adressé à l’anesthésiste…). Enfin, je fais partie des descendants de carabins qui font appel à l’humour ou aux calembours (parfois douteux) pour dissiper la tension. Il faut rappeler que le caractère « sérieux » est loin d’être corrélé fatalement à la tristesse ou la morosité.
Voici ce que pensait Aïcha Kassoul de mon tapuscrit : « Il est des livres dont on appréhende le trop de sérieux. À en croire le titre, celui de Mustapha Maaoui aurait pu faire partie de ces ouvrages sévèrement documentés, si le chirurgien ne connaissait pas les vertus d’une main « légère », habilement apte à se saisir des sujets les plus âpres pour en faire le récit le plus plaisant qui soit. Jeux de mots, jeux d’esprit, le stylet de l’écrivain remplace le bistouri pour fouailler ce qu’il y a de meilleur en nous : la curiosité, l’intérêt pour le savoir, une réflexion sur le sens de la vie et la valeur de l’homme face aux enjeux technologiques et financiers. Le texte, on le voit, ne manque pas de profondeur sans aller toutefois jusqu’au vertige, ni même jusqu’à donner le tournis. L’auteur conforte le chemin avec une sacrée dose d’humour et un sens de la formulation qui fait mouche, signalant non seulement une intelligence de l’esprit mais aussi celle du cœur. (…) L’invitation au voyage serait peut-être plus attrayante si l’on donnait au titre un sous-titre qui mettrait l’accent sur son aspect « littéraire ». Proposition : Histoire de la chirurgie. Jeux de mains – Jeux de mots. »
Le Matin d’Algérie : Vous montrez comment la relation entre soignant et soigné a changé avec le temps. Peut-on encore parler aujourd’hui de « présence » du médecin au chevet du patient ?
Professeur Mustapha Maaoui : Avec l’amélioration étonnante de l’imagerie médicale, souvent demandée par le médecin traitant (et parfois par le malade lui-même), il arrive de plus en plus fréquemment, hélas, de court-circuiter l’examen clinique classique et donc de sacrifier la sémiologie (interrogatoire, inspection, palpation, auscultation) pour scruter exclusivement les images du scanner et/ou l’interprétation de l’imageur. La décision thérapeutique concerne en quelque sorte une image plus qu’un être humain ! Par ailleurs, dans certains pays de haute technologie, on opère de plus en plus grâce à l’avènement de la robotique des malades qui se trouvent dans d’autres pays, voire d’autres continents.
Le Matin d’Algérie : L’introduction du livre évoque l’émergence de l’intelligence artificielle et des technologies invasives. Comment le chirurgien peut-il rester maître de son art dans un tel contexte ?
Professeur Mustapha Maaoui : Cette IA est de plus en plus présente dans différents domaines des activités humaines. Si les progrès technologiques sont inéluctables et représentent bien sûr un bienfait pour l’humanité quand ils sont maîtrisés, ils risquent, dans le cas contraire, de se transformer en un cauchemar, ce qui a fait dire à Einstein : « Le progrès technique est une hache qu’on aurait mise entre les mains d’un psychopathe. »
Le Matin d’Algérie : Vous avez entamé vos études dans les années 1960 à l’université d’Alger, dans une Algérie fraîchement indépendante. En quoi ce contexte historique a-t-il influencé votre vocation ?
Professeur Mustapha Maaoui : Durant la colonisation, les ambitions universitaires pour les « indigènes » étaient canalisées et balisées : pour le droit, on ne pouvait être qu’« Oukil » ou « Bougadhou », ayant pour vocation de régler les chikayettes et les disputes de Clochemerle, et pour la médecine, l’ambition ne pouvait aller au-delà du toubib, médecin de famille. L’indépendance a corrigé cette injustice. Avec beaucoup de mes compatriotes, je me suis engouffré dans cette filière élevée au niveau du possible.
Le Matin d’Algérie : Vous parlez d’un parcours de chirurgien « nomade ». Quelles spécialités avez-vous explorées et que vous ont-elles appris, au-delà de la technique ?
Professeur Mustapha Maaoui : Par « nomade », j’entends les différents services où j’ai été affecté à des périodes étalées sur le temps : Mustapha (Orthopédie-Bichat), Neurochirurgie, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie oncologique-CPMC, Chirurgie digestive-CCA, Gynécologie-obstétrique Parnet, Chirurgie Rouïba, Service de Chirurgie au CHUV de Lausanne, Chirurgie Ain Taya, Chirurgie Thénia, SAMU 38 de Grenoble, Chirurgie Kouba. On voit à travers cette liste les objectifs spécifiques ainsi que la différence des moyens mis à la disposition des chirurgiens selon les sites : entre les moyens du CHUV de Lausanne et ceux de Thénia (où le voltage de l’électricité est à 110 V) avec une activité qui s’est déroulée de 1990 à 1998, en pleine décennie noire, la différence est énorme. Pourtant, c’est à ce niveau que s’est consolidée ma conviction de l’importance de l’élément humain au sein d’une équipe déterminée.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous le sentiment que la chirurgie, telle que vous l’avez pratiquée, appartient aujourd’hui à un monde révolu ?
Professeur Mustapha Maaoui : En dehors de quelques pays très minoritaires, qui pratiquent une chirurgie futuriste, pas obligatoirement au service du malade ou de la santé publique, l’immense majorité des pays pratiquent une chirurgie avec aménagements et adaptation progressifs de leurs activités, et les règles de la chirurgie demeurent les mêmes dans leurs grandes lignes. Pour démarrer une voiture, on a recours de moins en moins à la manivelle et on est passé progressivement de la vitesse au volant à celle du plancher, puis au boîtier de vitesse automatique, et même aux voitures sans chauffeur, sans que les règles de conduite changent fondamentalement.
Le Matin d’Algérie : Le livre est aussi une galerie de portraits, de maîtres, de collègues, de patients. Quelles rencontres vous ont le plus marqué, humainement et professionnellement ?
Professeur Mustapha Maaoui : J’ai côtoyé de très nombreux chirurgiens dont un grand nombre mériteraient d’être cités — il faudrait un bottin ! Comme la chirurgie est un travail d’équipe, je me contenterai d’évoquer l’équipe de Bichat, les fameux Bichat’s Boys, mon premier service, sous la férule du professeur Ferrand, avec Chitour, Martini, Mehdi, Brahimi, Ould M’hamed, Guidoum, Zitouni, et l’équipe « d’en face » : Mentouri, Roche, Djilali. Parmi mes collègues, tous remarquables, je citerai volontiers Saïd Bouhelassa pour ses qualités humaines et professionnelles exceptionnelles.
Deux patients m’ont profondément marqué. Le premier, un ami de longue date de mon père, que j’avais opéré d’un monstrueux chordome périnéal, tumeur derrière le rectum. Il était en position ventrale, ce qui avait provoqué, en fin d’intervention, un arrêt cardiaque. J’étais aidé par deux débutants et il m’a fallu un grand calme pour le retourner, rassurer mon équipe et procéder à un massage cardiaque qui l’a finalement sauvé. Le second patient, je l’ai opéré à Thénia durant la décennie noire. A…, le bijoutier du village, appartenait à une grande famille alliée à toutes les tribus de la région.
Parmi eux, certains étaient des hommes discrets et respectables comme lui, mais il avait, et c’était de notoriété publique, des parents haut placés dans la hiérarchie des groupes terroristes. Un de ses neveux, H…, anesthésiste dans mon équipe, me l’avait amené en consultation avec un dossier complet. Il savait qu’il s’agissait d’un cancer du rein droit localement avancé, occupant tout l’abdomen, avec envahissement de la veine cave. La famille refusait l’idée de toute évacuation, me demandant de l’opérer sur place, dans une totale confiance. Le « jour J », l’hôpital était envahi par une foule d’hommes de tous âges, répartis en petits groupes dans les couloirs. L’anesthésiste me rassura : tout était prêt, la banque de sang débordait de flacons du groupe de son oncle, et de nombreux parents attendaient dehors pour donner le leur, « du sang sur pied », en quelque sorte. L’atmosphère était lourde : cinq heures d’une chirurgie périlleuse, au cœur d’un environnement vasculaire complexe, avec un prolongement cancéreux flottant dans la veine la plus grosse et la plus fragile de l’organisme, à retirer en même temps que le rein.
Autour du bloc, une foule silencieuse, peut-être mêlée d’assassins. Mais je ne ressentis aucune hostilité, seulement une tension extrême. J’ai choisi de ne voir que le malade. L’intervention se déroula sans incident. Le bijoutier se remit rapidement et vécut encore trois ans, sans récidive. Avec le recul, j’avais sans doute commis un délit de faciès, mais les craintes étaient réelles. Quant aux grands chirurgiens, j’en ai croisé beaucoup, mais s’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait Ton That Tung. Fils de mandarin annamite, il refusa la charge héréditaire pour se consacrer à la chirurgie, entamant à Hanoï une carrière fabuleuse qu’il poursuivit à Paris.
En 1937, il décrivit magistralement, en la « réinventant », l’anatomie du foie, révolutionnant ainsi la chirurgie hépatique majeure. Ton That Tung démocratisa cette chirurgie en prouvant qu’on pouvait, avec une parfaite connaissance de l’anatomie, réaliser les opérations les plus complexes sans appareillage sophistiqué — simplement avec les doigts. Il appelait cela la digitoclasie. Refusant les honneurs et la richesse, il retourna en Indochine rejoindre le combat de son peuple. Il dirigea les services de santé pendant trente ans, menant la lutte contre le colonialisme français, puis contre l’impérialisme américain.
De la jungle, il publiait dans des revues occidentales indexées des articles en chirurgie hépatique, en neurochirurgie et d’autres spécialités avec des résultats supérieurs à ceux des plus grands centres occidentaux. À la fin de la guerre, alors que les Anglo-Saxons l’invitaient partout, lui et son épouse déclinèrent toutes les offres, sauf celle du professeur Mentouri, qui les invita en Algérie. À la clinique chirurgicale A, cette légende vivante nous fit l’honneur d’une conférence ; il ne s’aida ni de transparents ni de diapositives, mais du tableau noir et de la craie. « Ce que l’on conçoit bien se dessine clairement », aurait-on pu dire en conclusion de cet exposé magistral. Cette conférence fut suivie d’une hépatectomie tout aussi magistrale.
Le Matin d’Algérie : L’éthique occupe une place centrale dans votre réflexion. Quels sont, selon vous, les dilemmes éthiques les plus urgents auxquels la chirurgie contemporaine est confrontée ?
Professeur Mustapha Maaoui : Soigner, c’est avoir cette possibilité très particulière de faire intrusion dans l’intimité et parfois de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. De toutes les spécialités médicales, la chirurgie est celle qui permet d’atteindre ces objectifs et le passage à l’acte, y compris au sens psychanalytique du terme, est accepté, voire demandé par le patient, et autorisé par la loi, car légitime et porteur d’un projet thérapeutique. Étymologiquement, la chirurgie est l’œuvre de la main. C’est en partie vrai, car c’est le cerveau qui guide la main (Homo sapiens guidant Homo habilis). Et même si on sait ce qu’il faut faire et qu’on sait le faire, on ne peut pas toujours le faire : il y a une régulation morale, éthique, religieuse, juridique… La révolution industrielle a été à l’origine de la spécialisation.
La révolution numérique laisse apparaître la perspective d’une sur-spécialisation. On a de plus en plus recours à l’intelligence artificielle et à la robotique en rajoutant des CO-BOT (Coopération-Robotique), c’est-à-dire des bras animés chargés de seconder le chirurgien. Il se pose alors deux grandes questions autour de cette situation : comment le chirurgien, avec sa mentalité et son ego, forgés sur des millénaires et renforcés à l’ère moderne par des progrès plus visibles et donc « plus palpables », accepterait-il ce contrôle ? La deuxième question est : « jusqu’à quand le cyborg se contenterait-il du rôle de supplétif ? » La révolution industrielle a été à l’origine de la spécialisation. La révolution numérique laisse apparaître la perspective d’une sur-spécialisation qui va partager ses prérogatives avec d’autres spécialistes, voire avec un robot s’il ne lui en délègue pas simplement toute l’initiative. Nous sommes en train d’assister à un glissement vertigineux qui a poussé certains pays, parmi les plus avancés, à revoir les attitudes et comportements dont doit faire preuve le chirurgien, notamment au sens des responsabilités en ce qui concerne les soins à prodiguer au patient, les relations éthiques avec les collègues, les patients et les proches, ainsi que la capacité de s’adapter aux innovations et aux changements dans le domaine de la chirurgie. Un chirurgien doit s’en tenir aux fondamentaux, sans perdre de vue les nécessaires progrès que l’on se doit de maîtriser en évitant d’en être les esclaves.
Le Matin d’Algérie : Vous évoquez avec lucidité les dérives financières qui influencent les choix médicaux. Comment préserver l’acte chirurgical des logiques de rentabilité ?
Professeur Mustapha Maaoui : Le pouvoir financier et la corruption, qui est son bras armé, ont gangréné tous les secteurs de la vie : la politique, le commerce, les sports, les religions, etc. La santé en général, et la chirurgie en particulier, n’échappent pas à ce pouvoir. Le plus bel exemple est celui du kyste hydatique qui est provoqué par un parasite, véhiculé par les carnivores (chiens), transmis au mouton et qui indirectement peut infecter l’homme. Quand on a compris ce cycle et le problème qui y est directement lié, la solution était évidente : s’en tenir à des règles drastiques en matière d’hygiène : abattage des moutons sous contrôle vétérinaire dans des abattoirs et destruction à la chaux de toute carcasse de mouton malade, lavage des mains et purges régulières des chiens de compagnie. Pour avoir appliqué ces règles élémentaires de propreté, les Irlandais, par exemple, ont éradiqué le kyste hydatique. Dans notre pays, nous nous payons le luxe de traiter cette maladie archaïque en chirurgie laparoscopique, voire robotique, avec, comme traitement adjuvant, des « médicaments » qui n’ont d’autre intérêt que celui d’enrichir ceux qui arrivent à les vendre aux pays sous-développés.
Le Matin d’Algérie : En tant que chirurgien ayant exercé en Algérie, quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’évolution du système de santé algérien, notamment dans le domaine de la chirurgie ?
Professeur Mustapha Maaoui : Notre pays est un pays composé en grande partie de jeunes, supposés être en bonne santé. Certes, il faut qu’il y ait quelques grands hôpitaux polyvalents équitablement répartis à travers le territoire national, mais le système de santé doit être orienté plus vers la prophylaxie que vers les thérapeutiques lourdes. Les accidents de la circulation sont parmi les plus meurtriers d’Afrique, et la drogue fait des ravages. Ce doit être un axe de travail qui ne relève pas seulement du domaine de la santé. Il convient donc de préférer Hygiée à Panacée et de s’occuper du bien-être des populations (droit au travail, au logement, etc.) pour être efficace.
Pour ce qui concerne la chirurgie, je sais qu’il y a d’excellentes équipes chirurgicales à travers le territoire national. J’ai une seule crainte quant aux récentes réformes concernant l’enseignement de la médecine en général et de la chirurgie en particulier : celle décidée brutalement de passer à l’anglais.
Certes, c’est jusqu’à présent la langue de la recherche scientifique, mais quid de la langue chinoise qui représente un pays qui va prendre les rênes des innovations scientifiques à venir ?
Une telle décision aurait dû être prise par une commission pédagogique et concerner l’enseignement supérieur d’abord, accompagnant la langue arabe et française jusqu’au passage du témoin. Dans un pays où l’anglais est maîtrisé au « stade » de « One Two Trai, Viva l’Ongérée », la décision me paraît suicidaire en l’état. Nous nous retrouvons dans la situation où le retour à la langue arabe, qui était une nécessité morale, culturelle, indépendantiste, aurait dû respecter les acquis et échapper à l’idéologie pour n’obéir qu’à la pédagogie. Pour avoir failli dans cette stratégie, nous avons acquis la maîtrise non pas de la langue arabe, mais de la langue de bois.
Le Matin d’Algérie : Si vous deviez résumer en une phrase l’esprit de Histoires de la chirurgie, que voudriez-vous transmettre avant tout à vos lecteurs ?
Professeur Mustapha Maaoui : Une équipe chirurgicale fonctionne comme une équipe de football : c’est une équipe qui fonctionne collectivement avec des individualités qui ont chacune son ego, et il peut se manifester aussi bien de la solidarité que des sentiments comme l’esprit de compétition, ce qui est positif, mais aussi de la jalousie. Par ailleurs, le chirurgien, comme le footballeur, reste un être humain vivant à des périodes données et dans des sociétés particulières, et c’est cette humanité, avec ses forces et ses faiblesses, que j’ai voulu transmettre, en mettant en lumière des figures comme Ton That Tung, le « Maradona de la chirurgie », qui a allié maîtrise technique et engagement humain, plutôt que Pelé, très grand sur le terrain et uniquement sur le terrain.
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Mustapha Maaoui — Ancien président du comité pédagogique national de chirurgie, ex-vice-président du Conseil de l’Ordre des Médecins, ex-chef de service de Kouba.