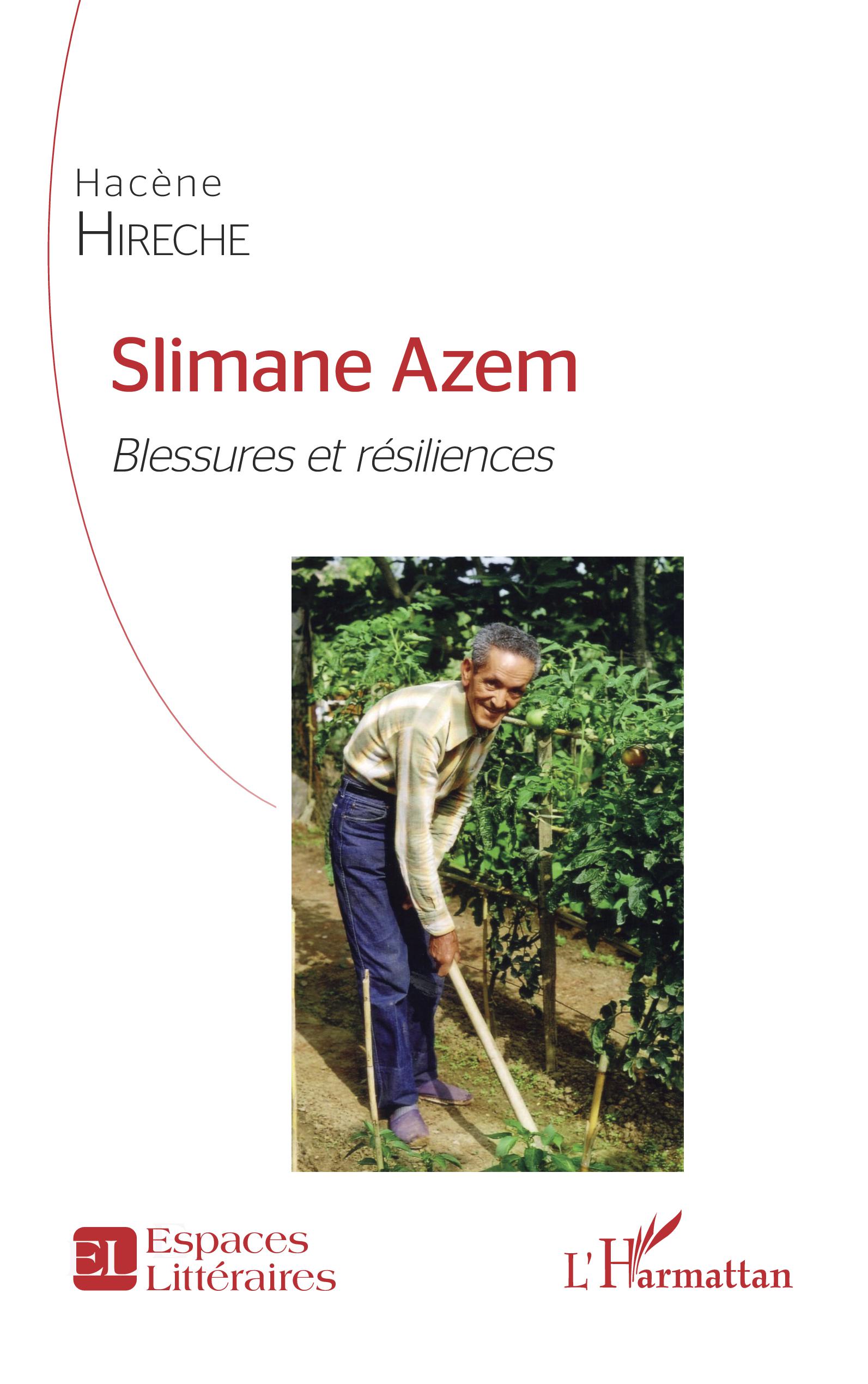
Il fut un temps où l’on pouvait, chez les Kabyles, s’acquitter d’une dette en récitant un poème à son créancier (1). Le Cantique des cantiques ne suffirait pas à nous libérer de notre dette envers Slimane Azem tant elle est incommensurable.
Il faut savoir gré à Hacène Hirèche de nous le rappeler dans cette biographie-hommage où l’émotion contagieuse côtoie la rigueur de l’analyse qui est à la fois socio-historique et psychologique, voire psychanalytique. Il dresse dans cet ouvrage le portrait d’un poète-chanteur polyvalent, un « éducateur populaire » comme le qualifie à juste titre le préfacier Mokrane Gacem, un poète qui scrute les travers et les mutations de la société par le truchement de la métaphore, parfois en s’aidant de la satire, parfois en taillant dans le vif des lâchetés humaines, un poète avant-gardiste, visionnaire et précurseur, notamment dans l’acceptation des chanteurs dans la société traditionnelle qui n’accordait pas, loin s’en faut, trop d’importance aux chanteurs avant les années quarante, quand elle ne les méprisait pas.
Le poète Ben Mohamed note dans un texte reproduit en annexe de l’ouvrage, que « c’est l’entrée en scène de Slimane Azem qui, à partir de la fin des années 1940, a commencé à modifier ce regard sur le chanteur et sur la chanson ». Le lieu et la date de naissance du poète, son exil précoce, déterminent à n’en pas de douter son son éveil et son éclosion féconde à la poésie chantée.
Hacène Hirèche, en symbiose culturelle avec le poète, part de ces racines profondes dont il trouve trace dans les poèmes. Slimane Azem est né au lendemain de la première guerre mondiale, en 1918. Il a passé toute sa jeunesse dans l’entre-deux guerres dans une Kabylie délaissée par le pouvoir colonial et frappée de plein fouet par la famine de 1939. Le kabyle grattait la terre nourricière à en mourir, il en sanctifiait chaque pan.
Dans l’univers azémien, le terme « terre » a le même statut que le Dieu soufi, « rebbi », qui émaille ses chansons. On comprend pourquoi il était si animé par la fibre écologique, à en juger par ces strophes (pp. 82- 83) : « Lweqt tura yethewwel (Le temps est désormais déréglé)/iteddu akken i s yehwa (Et agit à sa manière)/Ula d lḥal ibeddel (Le climat a lui aussi muté)/Texseṛ ula d lhawa (L’atmosphère en est altérée) / Kulci tura yemxebbel (Tout est maintenant chamboulé) / Yexleḍ yiṭij d lehwa (Soleil et pluie s’enchevêtrent)/Ur nezmir ara ad neɛqel (Nous ne pouvons plus discerner)/Ma d anebdu neɣ d ccetwa (Entre été et hiver). Et l’homme « ikeṭṭer di lḥerfa / Wehmen ukk widak yeɣran » (L’homme a abusé de ses activités / Les gens de sciences en sont tourmentés ».
Les climatologues du GIEC(2) ne renieraient pas ces vers anticipateurs. Et le poète a plusieurs cordes à son arc. Il a ce secret de nous enchanter en chantant le désenchantement de l’exil. L’amour est douloureuse séparation. La satire est un éclat de rires nerveux. Sans doute sa poésie politico-pamphlétaire est la plus populaire parce que sa causticité légendaire lave l’affront linguistique et culturel dont font l’objet ses frères kabyles. Elle panse « les plaies du monde mémoriel kabyle auquel il n’a cessé de s’identifier ». Hacène Hirèche a choisi judicieusement une chanson-pivot, anticoloniale, («Ffeɣ ay ajṛad tamurt-iw », Criquet, quitte mon pays), d’où, par éclats de vers, il tisse le fil qui relie ce poème aux autres comme dans un rhizome deleuzien.
Le terme Ajṛad (criquet) désigne dans son usage métaphorique une multitude invasive. Cet insecte s’attaque au grain à même l’épi, autrement dit à la source première du pain quotidien : Teččiḍ lḥebb terniḍ alim (tu as mangé le grain et la paille). Il sied donc à l’image du colon prédateur qui n’a pas manqué de censurer cette chanson dès sa sortie en 1956. La portée de cette chanson est universelle. Tout peuple colonisé peut s’en saisir et en faire son hymne national (à lire pp. 59-62).
Il est une autre chanson que l’auteur a eu l’intelligence de coupler en miroir avec celle du criquet, la bien nommée chanson (« In-as i Leflani », Dites à un tel/bon entendeur) qui date de 1959. Le chanteur exhorte ce Mr Tel à revenir à la raison et observer une trêve.
Les ignares en poésie châtiée du régime algérien sous Boumédiène l’ont lue et interprétée de travers près de vingt ans après sa parution afin d’accuser le chanteur d’être de connivence avec la France coloniale au motif que le terme « Leflani » invoquerait le FLN(3), et donc un appel au renoncement à la lutte de libération nationale. C’est comme si on extrayait de Boukharrouba (vrai nom de Boumédiene » le terme « khra » pour le lui envoyer à la figure.
Hacène Hirèche, au fait du parcours politique du poète-chanteur qui fut un militant nationaliste de première heure, démonte point par point cette supercherie linguistique en identifiant ce fameux Mr Tel en la personne de Messali Hadj (4) entré alors en rébellion contre le FLN. La trêve recommandée par le chanteur concernait sans conteste la lutte fratricide entre le FLN et le MNA de Messali Hadj. Hirèche souligne fort à propos que Azem est « un homme sagement insurgé ».
Mais le mal était fait. Double blessure, double peine (long exil et privation du retour auprès des siens). Les blessures de Slimane Azem, les nôtres par ricochet, appellent la résilience et, partant, la création qui vivifie l’esprit par de sublimes chansons qui convoquent, à l’instar de Jean de La Fontaine, la gent animale pour instruire les hommes et confondre ses persécuteurs post-coloniaux. La grenouille de Jean De La Fontaine meurt d’ambition démesurée (« s’enfla si bien qu’elle creva »).
Chez Azem ça sera le crapaud (« Taqsiṭ bb-wemqerqur », La fable du crapaud), crâneur au possible, qui ramage faussement sur le bord d’un ruisseau pour informer le peuple qu’il excelle, n’est-ce pas, dans la nage. Il finira la tête farcie de gloriole et le ventre plein d’eau. Il explose. Le vent ramasse sa peau (Yetteṛḍeq/Agwlim is yeddem it waḍu). Boumédiene, son altesse le crapaud, en a eu pour son grade mal acquis, autant que ses chiens de garde (chanson « Tlata yeqjan », Trois chiens), et ses perroquets (chanson « Baba ɣayu »), tout bons à rendre comme des flûtes les airs dont on les remplit (« Keč d nnefs i k-ččuren / Am jewwaq bu-seb ɛa tefla »). Hélas, la poésie apaise mais ne guérit pas.
Le Azem de Hirèche nous le fait sentir, il nous rend inconsolables d’être les compatriotes d’un poète génial banni de son pays natal par des pâtres bâtés de siècles sans racines.
En bon connaisseur de la culture amazighe, Hirèche cherche dans la tissure des poèmes un fil conducteur qui tient ensemble, par transmission et héritage, les grands poètes kabyles, de Si Muh U Mhend, le mentor de Dda Slimane, à Aït Menguellet, ces poètes dont le travail sur la langue à laquelle ils restituent « ses lettres de noblesse » relève à chaque fois de la résurrection, tant la langue amazighe est attaquée de toute part par des Ponce Pilate linguicides. Hirèche convoque çà et là ces poètes puits de références pour nous administrer quelques piqûres de rappel, de ces vers qui dessillent les yeux et interdisent le sommeil asservissant. Car, hélas, le criquet a fait des petits, et le rossignol n’est pas à ce jour parvenu à en venir à bout.
L’auteur pérégrine ainsi d’un poème à un autre, y sonde l’âme du poète Slimane Azem, moins pour nous fournir un bilan de sa « grammaire poétique » qui nécessite une exégèse des plus savantes, que pour y trouver lui-même refuge et racines.
Il faut dire aussi que Hirèche, de par la proximité de son village qui est à quelques encablures de celui du poète, partage avec lui aussi bien l’« émotion géographique » que l’émotion profondément culturelle. Ils portent tous les deux dans leurs prunelles les empreintes des mêmes paysages, des mêmes montagnes, des mêmes couchers du soleil. Cette émotion n’entache aucunement l’analyse, elle nous invite à l’empathie.
Du reste, la poésie ne se lit pas avec la raison raisonnante, elle résonne en vous quand elle raccroche votre âme aux montagnes qui vous ont fait naître : « hommes, faune, flore s’agrippent avec symbiose aux solides rochers des lieux et ont l’air d’exécuter avec cœur une symphonie céleste » (p. 54), « ces panoramas exceptionnels, devenus sa géographie intérieure ont nourri le paysage verbal du poète. » (Ibid.)
Le poète a vécu dans la douleur de l’appel dévorant de ce terroir interdit, d’Agwni g-Eɣran, son village natal. Il repose aujourd’hui à Moissac (sud de la France), dans un cimetière communal, non loin d’un jardin qui porte son nom, un jardin qui vaut tous les panthéons d’une Algérie ingrate. Un livre à lire, dans l’ambiance de « Madame encore à boire », tant l’évocation de Dda Slimane vous harponne par le cœur et les tripes. Jusqu’aux larmes.
Achour Ouamara
Hacène Hirèche, Slimane Azem, Blessures et résiliences, L’Harmattan, Coll. Espaces littéraires, 2022.
Renvois
1.cf. Mammeri Mouloud, Poèmes kabyles anciens, François Maspéro, 1980, p. 44)
- Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.
- Front de libération nationale
- Messali Hadj est un des premiers leaders du mouvement national algérien. Il s’est opposé au déclenchement de la guerre d’Algérie en novembre 1954. Il a créé pour ce faire un mouvement dissident, le MNA (Mouvement National Algérien) contre lequel le FLN a livré une lutte fratricide sans merci.
