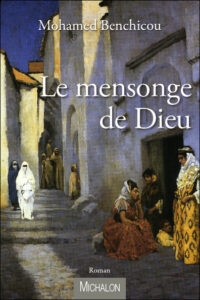
Ta mère Amira avait trois ans. Nous avions fui notre maison depuis un mois déjà. Depuis la rafle du Vél’d’Hiv. Hanna et Samuel avaient vu l’étau se resserrer sur nous. Brutalement. Bestialement. Ils avaient compris que Pétain allait nous livrer aux nazis.
Nous pensions, une fois évacués d’Alsace, avoir échappé aux mains noires du Führer en regagnant les bras de la mère patrie ; mais ce furent les bras de la mère patrie qui nous conduisirent au bûcher. Nous croyions nous être éloignés de la frontière de la mort ; mais elle nous avait poursuivis en France, au creux des bras de la mère. Elle s’était donné un nom sinistre, « ligne de démarcation », et ne protégeait de rien. Elle séparait le bourreau et le traître, la France occupée et la France collaborationniste.
Nous étions dans la France collaborationniste, la « zone libre », disait-on, sous Pétain, « entre Français » ; et pendant quelques mois, Gabríl et Hanna s’étaient nourris de l’illusion que nous étions dans le refuge de Dieu. Dieu, la famille, la patrie, les nouveaux étendards de la France.
Jusqu’au jour où de premières rumeurs sinistres annoncèrent un enfer proche. On avait d’abord entendu parler des centres d’internement pour les Juifs qu’on avait ouverts dans les communes voisines, à Saint-Pardoux-la-Rivière, au Change, à Périgueux… Le mois suivant, il fut ajouté, en lettres rouges, la mention « Juif » sur leurs papiers d’identité. Puis un jour, ma mère a été renvoyée de l’hospice d’Annesse-et-Beaulieu. « Ordre de la préfecture : les Juifs sont exclus de la fonction publique », avait expliqué la directrice. Lorsque, au printemps 1942, l’étoile jaune est devenue obligatoire, même pour les Juifs de la zone libre, Hanna et Samuel ont compris qu’ils n’étaient plus dans le refuge de Dieu.
Et qu’il fallait fuir. Samuel a rejoint le maquis avec cette ultime consigne à Hanna :
– Ne reste pas ici !
Alors elle nous a emportées, Amira et moi, avec quelques vêtements chauds, bien que nous fussions en juillet ; elle nous a emportées sans vraiment savoir où aller. Elle parlait d’une amie, Deborah, qui habitait à la sortie de Bergerac ; mais Deborah, toute tremblante, nous a chassées sur le seuil de sa porte :
– Partez, partez, ils rôdent par là… Ils sont venus chercher ma belle-soeur, je ne veux pas vous garder, fuyez, fuyez, parce qu’ils doivent revenir…
Nous ne savions plus où aller. Hanna s’est assise sous un platane et s’est mise à prier. Elle portait Amira qui pleurait de faim. Son visage s’est éclairé subitement.
– Shalom ! On va aller chez Shalom Wertheimer !
Shalom Wertheimer faisait partie de ces Juifs dont on ne parle pas, les Juifs collaborateurs. Ils avaient aidé à arrêter de plusieurs centaines de leurs coreligionnaires en les dénonçant aux nazis. Ils étaient généralement physionomistes, chargés de repérer les
Juifs à leurs traits, ou « contrôleurs », vérifiant, sous les porches des immeubles, si les hommes interpellés étaient circoncis ou non. Ils étaient, d’autres fois, « piégeurs » : cigarette aux lèvres, ils demandaient du feu en yiddish, ost fayer ?, et ceux qui comprenaient et proposaient leur briquet étaient immédiatement embarqués. Shalom Wertheimer, lui, était un collaborateur de niveau supérieur. C’était un vieux ferrailleur qui s’était enrichi grâce aux Allemands et aux tortionnaires de la Gestapo française.
Aux premiers il livrait des marchandises de toutes sortes mais aussi des renseignements utiles. Aux seconds il désignait des Juifs fortunés, propriétaires de riches collections, que la Gestapo se chargeait de dépouiller par de fausses perquisitions à domicile ou, pour les plus coriaces, par le chantage et les sévices corporels au sinistre bureau parisien de la rue Lauriston.
La singularité de Shalom Wertheimer était qu’il s’adonnait à sa félonie avec une remarquable duplicité, n’oubliant pas de verser obole à la Résistance et même de procurer de faux papiers à certains Juifs traqués. C’était sa façon d’assurer sa place dans le bon côté de l’Histoire, quelle que soit l’issue de la guerre. C’est ainsi que Samuel avait fait sa connaissance. Il était son « contact » dans la Résistance. Il n’ignorait rien de son double jeu et s’en indigna dès la première rencontre.
– Toi, juif, tu trahis les Juifs !
Wertheimer avait une explication pour tout.
– Qu’est-ce que tu racontes, Samuel ? Je devrais renoncer à mes affaires, me reconnaître des devoirs envers le dernier des Juifs sous le seul prétexte qu’il est juif ? Quelle importance, un Juif désœuvré, Juif fainéant, Juif vaurien, Juif gueux, Juif mendiant ? Eh bien non, Samuel ! Moi, je veux sauver les Juifs méritants ! Hanna a marché jusqu’à Saint-Pancrace, où Shalom Wertheimer possédait une somptueuse résidence. Il était en compagnie de son fils Amos, banquier prospère et personnalité incontournable de la finance.
– Tu cherches un abri ? Je risque gros, mais je ne peux laisser la soeur d’un résistant comme Samuel se faire déporter ! Tu te rappelleras, au moins, que le vieux Shalom t’a aidée, n’est-ce pas ? Vous allez loger dans un appartement à Champagnac-de-Belair. Tahar va vous y conduire. C’est mon jardinier et mon chauffeur, un homme de confiance. Nous sommes restées huit jours dans cet appartement. Le souvenir qui m’en reste, c’est d’y avoir eu terriblement faim, et d’y avoir sans cesse entendu ma mère me rabrouer :
– Je n’ai rien à te donner, Warda !
Il n’y avait, en effet, ni pain, ni sucre, ni conserves. Tahar nous avait laissé quelques provisions, mais elles s’étaient épuisées. Ma mère n’osait pas sortir.
Nous sommes restées cachées, dans le silence et l’obscurité, fenêtres fermées, prenant soin de ne faire aucun bruit, parlant à voix basse. Nous redoutions autant les voisins que la gardienne.
Ma mère ne pleurait pas ; moi en revanche je pleurais, parce que j’avais faim, parce que je voulais aller à l’école et que je ne pouvais pas y aller. Un jour, ma mère m’a pris la main et, pour la première fois, dans cet appartement lugubre où nous avions peur et faim, m’a parlé d’un ton solennel.
– Warda, tu es grande maintenant. Tu peux comprendre ce que je vais te dire : tu vas entrer dans une période de ta vie où tu vas beaucoup souffrir, mais chez nous, on ne pleure pas ! Tu m’entends ? On ne pleure pas ! Ta grand-mère nous l’a interdit.
Elle était pleureuse, haznié, elle pleurait pour les morts qu’elle ne connaissait pas, et elle s’est toujours vu verser des larmes. Nous avons trop pleuré, pour nous et pour les autres, m’a-t-elle toujours dit. Alors, on ne pleure pas !
Depuis cette nuit, je n’ai plus pleuré. Et puis un jour, Tahar est venu nous voir au milieu de la nuit.
– Partez vite ! Wertheimer vous a données, la milice vient par ici ! Venez, on va chez Chico le Gitan !
Tahar a pris d’autorité Amira dans ses bras et nous nous sommes engouffrés dans les ruelles sombres de Champagnac-de-Belair, le cœur battant, rasant les murs, jusqu’à sortir enfin du village. Nous avons ensuite beaucoup marché dans la nuit. J’avais peur, j’étais fatiguée, j’avais envie de pleurer mais j’avais promis à ma mère de ne plus le faire. À l’aube, Tahar s’est arrêté dans une clairière, à la sortie de Thiviers.
– On y est !
Et nous avons trouvé Chico dans sa roulotte. Comme tous les Gitans, il était mystérieux, excentrique et captivant. Il avait une crinière blonde qui lui tombait dans le dos et portait une chemise blanche de pirate sous un gilet brun aux tressages or et rouge et un bandana rose autour du cou. Mais ce qui m’a le plus frappée, c’était la grande boucle en or qu’il portait à l’oreille. Il a écouté Tahar sans rien dire puis s’est levé pour décrocher sa guitare. Et il m’a chanté :
« Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos
Harían con tu corazón… »
Ma mère me chuchotait la traduction à l’oreille :
« Va-t’en, lune, lune, lune
S’ils arrivaient les Gitans
Feraient de ton coeur parure
D’anneaux et de colliers blancs
Petit, laisse-moi danser
Lorsque les Gitans viendront
Tes jolis yeux seront clos
Sur l’enclume, ils te verront… »
– Tu as aimé ? m’a demandé Chico en souriant. C’est un poète de chez nous, assassiné il y a cinq ans. Lorca. Quel âge as-tu ?
– Onze ans.
– Alors Warda, n’oublie jamais que la poésie parle aux morts et aux muets. Elle te fera toujours connaître l’autre, respecter l’autre et t’aidera même à faire connaissance avec toi-m
Puis il s’est levé pour partir.
– Je vous laisse la roulotte. Moi, je vais crécher chez Garcia, un pote qui tient le café Ganaud sur la place d’Aisne. Tahar est resté un peu avec nous. Hanna était émue.
– Merci…
– C’est la vie, madame… Chico et moi, on sait ce que ressent un homme persécuté. La grande solitude. L’errance. Lui en tant que Gitan, moi en tant qu’Arabe, nous avons toujours connu le racisme, le regard méprisant des autres, la mauvaise réputation de voleur de poules.
Il nous a apporté des provisions et venait chaque soir nous rendre visite, nous rassurer, et parfois même nous faire rire. Manuela avait raison. C’est toujours auprès des gens abandonnés que notre famille a trouvé ses moments de joie, l’indispensable amour et la force de survivre aux époques noires. J’ai pu constater, à mon tour, que cet amour-là, cet amour précieux, n’est pas forcément fait pour nous rendre heureux. Il est, c’est vrai, difficile d’être heureux dans une époque noire. Cet amour nu et innocent est surtout fait pour révéler en nous la force de souffrir et de supporter. De triompher de nous-mêmes ! Oui, qu’aurions-nous été sans amour ? Comme dit Manuela, c’est la seule force qui transforme un homme ordinaire en un être extraordinaire.
Et puis un soir, Tahar a déboulé avec Chico, le visage retourné.
– Partez, partez vite ! Les miliciens bouclent le quartier.
Chico et moi, on va prendre les enfants. Les miliciens ne nous contrôleront pas. Hanna, vous nous devancez. Si vous en réchappez, rendez-vous au café. Ma mère n’avait pas fait cent mètres que deux miliciens l’ont abordée :
– Papiers !
J’ai vu, à la dérobée, ma mère qui s’éloignait de nous pour toujours. Nous nous sommes offert un dernier regard. Le sien était imposant.
Elle a discrètement mis son index sur les lèvres, m’enjoignant ainsi de ne pas me trahir. Je lui ai fait le cadeau de ne pas pleurer et j’y ai ajouté un léger sourire. Elle nous a quittés sur cette image.
(Exrait du roman Le mensonge de Dieu de Mohamed Benchicou, 2011 Editions Inas-Koukou pour l’Algérie, Editions Michalon pour le reste
