En mars 1962, la politique de la terre brûlée menée par l’OAS venait d’atteindre le sommet de l’horreur avec l’assassinat, le 15 de ce mois, de Mouloud Feraoun, à tout juste 49 ans, avec cinq collègues des Centres sociaux.
Parler de Dda El Mouloud c’est plonger dans les souvenirs de nos premiers livres d’école, lesquels contenaient de nombreux textes de notre écrivain. Dès les premières années de scolarité, nous étions déjà bien imprégnés des personnages du « Fils du pauvre ». Coincés entre « Nos ancêtres les gaulois » et « Ces femmes roulent le couscous » défilaient gaiement les personnages Fouroulou, Ramadan, Lounis, Tassadit, Fatma, Baya, Nana, Halima, etc. L’éveil de nos consciences venait de commencer. Nous ne nous endormirons plus.
La biographie de Dda El Mouloud est largement présente sur internet. Nous ne la reproduirons donc pas, préférant nous focaliser sur ses échanges avec Albert Camus, le fils de l’autre pauvre. La lettre de 1958 est particulièrement révélatrice de la colère qui gagnait notre écrivain, à l’approche de la fin de la guerre :
La source de nos communs malheurs (lettre à Albert Camus)
Par Mouloud Feraoun
Je suis, peut-être, moins surpris que vous-même du silence qui entoure votre dernier livre et finira par l’étouffer. Auriez-vous, par hasard, le désir d’éteindre l’incendie en faisant la part du feu, prétendriez-vous interposer entre ceux qui se battent au lieu d’encourager les vôtres tout en cherchant à décourager les miens ?
Avouez, monsieur, que si votre attitude étonne, l’accueil réservé à votre ouvrage n’a, lui, rien de surprenant, car si depuis quatre ans on a cessé de réclamer, de solliciter, d’exiger votre opinion, il est clair que cette opinion, en fin de compte, devait être celle de tous, fermement installée dans les têtes, dans les cœurs — les ventres, ajouterai-je. Il est clair qu’on vous demandait de condamner les uns, d’approuver les autres, même de trouver quelques bonnes raisons pour cela. Quelques bonnes raisons qui auraient échappé jusqu’ici, parce que vous êtes un grand esprit, que c’est une grande chose pour la France d’avoir des hommes tels que vous et une veine pour les politiciens de s’appuyer sur vos arguments. On ne vous demandait rien d’autre. Qu’avez-vous fait, monsieur ?
Non seulement vous dites ce que vous pensez de ce que l’on a décidé d’appeler le problème algérien mais vous pensez juste et vous dites bien. Et cette pensée juste vous a conduit précisément à refuser d’approuver les vôtres et de condamner les miens.
Voilà pourquoi, monsieur, de cette Algérie qui souffre, que vous aimez bien, vous du moins, je vous adresse un salut amical, avec toute l’admiration que l’on doit à un esprit lucide, à un homme courageux.
N’ayant ni votre talent ni votre courage, pourrais-je garder l’anonymat afin de dire, à mon tour, très brièvement, très simplement mais en toute franchise, ce que je pense de ce problème ? Sachez pourtant que je suis instituteur « arabe », que j’ai toujours vécu au cœur du pays et depuis quatre ans au centre du drame. Le mot « arabe » n’est d’ailleurs pas très exact. Pourquoi ne pas préciser après tout ?
Il me revient à la mémoire une anecdote qui remonte au 9 mai 1945. C’était en Alsace. Pour annoncer les événements qui, la veille, avaient commencé d’ensanglanter le constantinois, un journal local étalait ce titre en première page et en gros caractères : « Révolte arabe des kabyles ! » Mettons que vous recevez aujourd’hui une lettre arabe d’un kabyle et vous avez du même coup toutes les précisions désirables.
En 1958, je sais, on s’intéresse davantage à l’Algérie. Mais hélas ! à l’Algérie seulement, le Sahara avec, bien entendu. En tout cas, on ne s’intéresse aux arabes ou aux kabyles que pour les tuer, les mettre en prison, les pacifier ou, depuis quelque temps, pour intégrer leurs âmes, dans la mesure où ils en ont une de soigner leurs corps souffreteux, plus ou moins couverts, plus ou moins couverts de loques.
Vous êtes bien jeune, monsieur, quand le sort des populations musulmanes vous préoccupez déjà. À cette époque-là, moi qui suis de votre âge, je m’exerçais à faire correctement ma classe et je gagnais sans doute plus que vous. Vous étiez bien jeune et votre voix bien faible, il m’en souvient. Lorsque je lisais vos articles dans Alger Républicain, ce journal des instituteurs, je me disais : « Voilà un brave type. » Et j’admirais votre ténacité à vouloir comprendre, votre curiosité faite de sympathie, peut-être d’amour. Je vous sentais tout près de moi, si fraternel et totalement dépourvu de préjugés ! Mais déjà aussi, je vous assure, je ne croyais pas en vous, ni en moi-même, ni en tous ceux qui s’intéressaient à nous et qui étaient si peu nombreux ; car tout le mal qui pouvait nous venir des autres, personne n’avait pu l’empêcher d’être fait. À cette époque-là, enfin, nous avions conscience de notre condition de vaincus et d’humiliés et depuis longtemps nous ne tenions plus que le langage de vaincus, tandis que les vôtres, tout naturellement, tenaient plus que jamais le langage de vainqueurs. Non pas que nous ayons renoncé à tout espoir, mais le salut, nous ne l’attendions plus que de l’imprévisible — ou de l’inéluctable, ou encore du temps qui s’écoule. Nous en étions là, tous les résignés, préoccupés des seuls soucis de l’heure, du seul combat pour une existence difficile. Il y avait parmi nous des privilégiés, oui, des instituteurs par exemple. Ils étaient satisfaits, respectés et enviés. Ils s’appliquaient à bien conduire leurs leçons en vue d’obtenir de beaux succès au certificat d’études.
Mais ce langage de vaincus, nous vous le tenions comme une réplique définitive à votre langage de vainqueurs. Cela nous permettait de solliciter des réformes et le droit de vous ressembler. Lorsque vous vous en êtes rendu compte, vous, Albert Camus, le cri pathétique que vous avez poussé et qui vous honore à jamais n’a pas été entendu. Non seulement on n’a rien voulu entendre mais on vous a chassé de ce pays qui est le vôtre, parce que vous étiez devenu dangereux. Plus dangereux que les vaincus que personne ne prenait au sérieux.
Ces privilégiés, à vrai dire, que l’on pourrait appeler des semi-évolués, des évolués ou enfin des intellectuels, étaient à mi-chemin entre vous et les leurs, chacun sait qu’ils ne demandaient qu’à venir à vous, à s’assimiler tout à fait, fût-ce au prix de quelque ultime reniement, de quelque dernière humiliation, mais, de toute manière, une fois au sein de la famille adoptive, un peu de patience aurait arrangé les choses et, aux nouvelles générations, il eût été facile de perdre tout complexe, de se débarrasser de toute arrière-pensée, de perdre leur personnalité pour ainsi dire.
Mais, à côté des bourgeois et des gens instruits, des camelots vagabonds qui avaient parcouru la France et des ouvriers de Saint-Denis ou d’ailleurs, il y avait la masse que vous ignoriez et qui vous le rendait bien. Cette masse ne faisait pas que vous ignorez : l’ignorance était son état.
À cette époque, monsieur, la femme du Djebel ou du bled, quand elle ne voulait pas effrayer son enfant pour lui imposer silence, lui disait : « Tais-toi voici venir le Bouchou ». Bouchou, c’était Bugeaud. Et Bugeaud, c’était un siècle auparavant ! Nous étions encore là, en 1938, alors que, de votre côté, vous écriviez cette page que je ne peux m’empêcher de reproduire comme le plus solennel avertissement qu’un homme de cœur ait pu donner à son pays :
« Les Kabyles réclament des écoles comme ils réclament du pain… Les Kabyles auront plus d’écoles le jour où on aura supprimé la barrière artificielle qui sépare l’enseignement européen de l’enseignement indigène, le jour enfin où, sur les bancs d’une même école, deux peuples faits pour se comprendre commenceront à se connaître. »
» Certes, je ne me fais pas d’illusions sur le pouvoir de l’instruction. Mais ceux qui parlent avec légèreté de l’inutilité de l’instruction en ont profité eux-mêmes. En tout cas, si l’on veut vraiment d’une assimilation, et que ce peuple si digne soit français, il ne faut pas commencer par le séparer des français. Si j’ai bien compris, c’est tout ce qu’il demande. Et mon sentiment, c’est qu’alors seulement la connaissance mutuelle commencera. Je dis ‘commencera’ car elle n’ a pas été faite. «
Ainsi, il y a vingt ans, deux communautés vivaient côte à côte depuis un siècle, se tournant délibérément le dos, totalement dépourvues de curiosité et, de ce fait, aussi peu susceptibles de se comprendre l’une que l’autre, n’ayant de commun que leur mutuelle indifférence, leur entêtement à se mépriser et cet inhumain commerce qui lie le faible au fort, le petit au grand, le serviteur et le maître.
Telle était la situation. Telle restera jusqu’au début de la révolte.
Ceux qui étaient « assimilables » étaient aussi des utopistes croyant pouvoir s’évader de leur condition pour adopter la vôtre. Mais ni la cravate ni le complet ne firent oublier chechia et saroual dans un pays où il n’y avait rien d’autre. Pour bien faire, il eût fallu, au contraire, que le costume disparût pour laisser place à la gandoura et au seroual et le peuple algérien, tout entier en burnous, eût à coup sûr retrouvé son unité : celle qu’il avait eue au long des siècles, en dépit des divisions intestines, de la multitude des langages et de la diversité des genres de vie. Car il y avait bien cette unité nord-africaine imposée au moins par le climat, le milieu, la nécessité de vivre dans cette « île de l’occident », et que ni les Phéniciens, ni les Romains, ni les Vandales, ni les Arabes ne réussirent à disloquer. Tous ces conquérants, au contraire, s’adaptèrent au soleil du Maghreb, aux steppes de ses plateaux, à la rude existence des montagnes, s’amalgamèrent, fusionnèrent dans le désordre, les disettes et l’anarchie, si bien que lorsque les français arrivèrent, ils ne trouvèrent qu’un seul peuple. Ils purent sans doute s’aimer ou se détester mutuellement, s’allier ou s’entre-déchirer avec toute la cruauté dont l’homme est toujours capable. Il y eut sans doute des castes, des privilégiés, des vaincus et des vainqueurs. Mais tout cela se passait entre eux, se trouvait entre eux, les unissait au moment même où ils se dressaient les uns contre les autres : affaires intérieures auraient à l’ONU les grands stratèges des deux mondes !
En réalité, il n’y avait d’autre assimilation possible que celle des nouveaux par les anciens et cette assimilation, dans l’ordre naturel des choses, a commencé de se faire à notre insu et malgré vous. Peu à peu, depuis un siècle, le peuple algérien d’origine européenne s’est détaché de l’Europe au point de devenir méconnaissable et de ne plus ressembler qu’à lui-même, je veux dire aux autres Algériens qu’il méprise mais dont il partage l’accent, les goûts et les passions.
Aujourd’hui, je sais comme vous, cher monsieur, que les Français d’Algérie « sont, au sens fort du terme, des indigènes ». Je souhaite seulement qu’ils en aient conscience et qu’ils n’accusent pas trop la France lorsqu’il lui arrive de les oublier, parce que chaque fois que « la mère-patrie » répond à l’appel de ses enfants abandonnés, c’est pour tancer vertement ces autres indigènes qu’elle n’a jamais voulu adopter et qui, dans le fond, n’ont jamais cru à une impossible filiation.
Impossible, pourquoi ? Parce que la seule condition qui l’aurait rendue effective n’a jamais été réalisée : celle qui aurait consisté à transplanter purement et simplement les Algériens en France pour en faire des Français. Car un Algérien, en Algérie, quel que soit son origine, ne saurait être qu’un Algérien.
L’erreur de la France, je crois, c’est d’avoir voulu faire des Algériens des Français par devoir. Nous, les vaincus, il a bien fallu que nous nous inclinions, mais vous qui êtes ses enfants, vous réclamiez aussi vos prérogatives, vous les obteniez à nos dépens, vous les exerciez sur nous, et cette démocratie, qui vous autorisez à demander justice, devenait pour nous une tyrannie.
Mon propos n’est pas de dresser aujourd’hui un nouveau réquisitoire contre un régime dont tout le monde connaît les tares et que, pour ce qui vous concerne, votre vie, de même que votre œuvre tout entière ont totalement condamné. Je ne voudrais pas non plus accabler mes compatriotes d’origine européenne qui, je sens, je le pense, en dépit des cruelles apparences, sont aussi près de moi que n’importe quel autre habitant de ce pays. Mais il faut bien reconnaître qu’ils ont tiré tout bénéfice d’une ambiguïté soigneusement entretenue, que nous n’avons jamais eu la possibilité de dénoncer, nous contentant, avec plus ou moins de véhémence, plus ou moins d’illusions, plus ou moins de bonheur, de réclamer notre part de ce bénéfice comme prix de notre attachement (forcé) à la France. Cette équivoque, à mon avis illégitime, est la source de nos communs malheurs.
Lorsque les Algériens d’origine européenne nous disent qu’ils sont Algériens, nous entendons qu’ils sont d’abord Français, puis Algériens de surcroît. Voilà ce que nous comprenons, ce que depuis toujours ils ont voulu nous faire entendre. En vertu de quoi ils sont les maîtres. En vertu de quoi, aussi, répétons-le, toute contestation inquiétante de notre part les fait se tourner vers la métropole qui, consciente de ses devoirs, vient consolider leur position.
« Les Arabes peuvent du moins se réclamer d’une appartenance non à une nation, mais à une sorte d’empire musulman, spirituel ou temporel. » Que reste-t-il d’autre à faire ? Toute fois leur ambiguïté, à eux, ne confère aucun pouvoir réel, n’en conférera sans doute jamais.
Lorsque le musulman dit qu’il est Algérien, chacun sait qu’il n’est que cela. Mais cela même, il ne l’est que dans une certaine mesure qui marque son infériorité et l’habille irrémédiablement comme d’une livrée étroite.
Mais il n’est pas nécessaire de supposer puisque tout se passe comme si l’Europe avait confié à la France le soin de veiller sur ses enfants, comme si la France était chargée de veiller sur les chrétiens et les juifs, dans un pays où la majorité est musulmane. Pour notre part, nous ne pouvons lui en vouloir, car, à côté de cette mission qui la diminue à nos yeux, elle en a rempli une autre plus grande et plus belle auprès de nous, une noble mission qui fera que toujours, malgré tout, nous serons à notre manière des enfants.
Si nous poussons la simplification jusqu’à son expression irréductible, nous dirons qu’il y a d’une part une communauté plus importante qui voudrait demeurer française en droit sinon en fait, d’autre part une communauté plus importante qui demande à être pleinement ce qu’elle est.
Le problème ainsi posé peut apparaître aux uns comme une absurdité, aux autres comme une lapalissade mais, depuis quatre ans, il nous a précipités dans un drame affreux dont tout le monde fait les frais.
Oui, monsieur, devant l’ampleur de ce drame et son injustice, devant les souffrances de notre peuple, sa destruction qui pourrait aboutir à son extermination, on voudrait renoncer à son orgueil, à sa susceptibilité, on voudrait renoncer à être Algériens-Français, ou Algérien tout court, ou même Français, pour être simplement humain, cesser de tuer, cesser de détruire, recommencer d’aimer. Devant la cruauté et le mensonge déchaînés sur l’homme devenu innocent parce qu’il n’arrive plus à comprendre, on voudrait renoncer à tout pour que se taise définitivement la bête et que soit réhabilité l’homme. Mais de quelque côté que se tourne désespérément le regard, nous ne voyons pas l’issue de l’insondable tunnel où nous voilà tous plongés.
Il est possible après tout que les stratèges aient raison et que s’accomplisse la conquête, ou la reconquête, même au prix de l’extermination.
Il est possible aussi que le peuple des villes, des djbels et des campagnes, à la fois l’enjeu et le champ de bataille des nobles idées qui s’affrontent et au nom de quoi on le piétine sans pitié, il est possible que ce peuple, las d’être martyrisé, prenne sur lui, un jour, de refuser la souffrance ; cela ne voudra nullement dire qu’il accepte les nobles idées des uns et rejette désormais celles des autres : le problème restera entier et d’autres générations auront à le poser à leur tour.
Ne vaudra-t-il pas mieux éviter de leurrer et de se leurrer en assumant loyalement la tâche de combattre soi-même son propre malheur ? Ne vaudra-t-il pas mieux tenter de créer les conditions d’une véritable fraternisation qui n’aurait rien à voir avec celle du 13 mai ?
Cette tâche, ce n’est pas aux stratèges de l’accomplir, mais aux Algériens eux-mêmes, tous ceux qui se piquent d’avoir de nobles idées. Et qui feraient d’abord leur examen de conscience.
M. Feraoun
« La source de nos communs malheurs », lettre à Albert Camus, Preuves, Paris, Congrès pour la liberté de la culture, n. 91, septembre 1958.
On ne peut lire un texte aussi lucide sans avoir une pensée pour Boualem Sansal, assassiné à petit feu, sous nos yeux impuissants, par les héritiers de l’OAS.
Kacem Madani

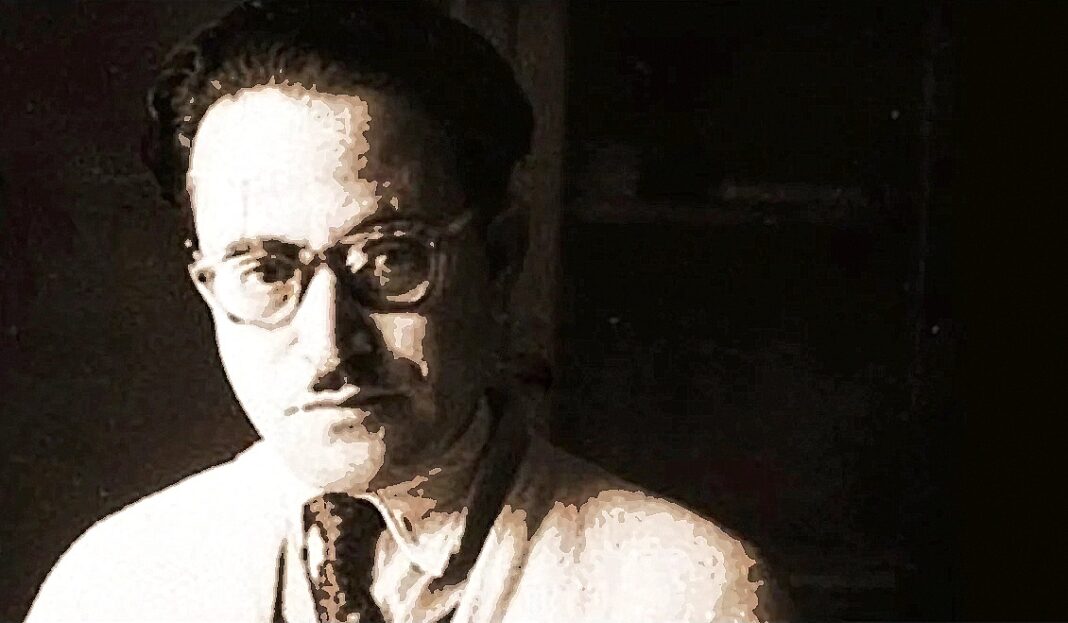
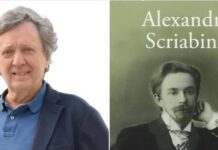


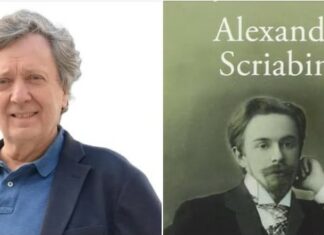





Je cite – la conclusion – « Cette tâche, ce n’est pas aux stratèges de l’accomplir, mais aux Algériens eux-mêmes, tous ceux qui se piquent d’avoir de nobles idées. Et qui feraient d’abord leur examen de conscience. »
A se demander si Camus ne lui a pas repondu: Et tu m’ecris tout ca, a genoux a partir du vaaaassssttttteeeee paradiTozio d’allah, je suppose…
Decidemment, il y a des khortis durs a cuire. Les kabyches se suicident en fumant du gaz et buvant du petrole…le CUL EN L »AIR BIENSUR et jusqu’a maintenant.
Je me suis trompé j’ai adressé mon post sur l’autre fil. Tamyou, cela me donne l’occasion de me rattraper.
Il y a lonta ,3emi Hmed lmarouki, est venu me voir pour que je lui écrive une lettre au directeur de
loukasyou familiale, qui lui a diminué sa pansyou.
Je lui ait fait une lettre à la Mouloud Feraoun pleine de politesse. Quand je l’ai lu ,
mi Hmed est devenu furieux. Il m’a dit : Lalla a Khali Lqebeyli, ana maranich netleb, hadda heqi.
Alors drahem matchi ta3 yemah, wahed l3et… ! Maranich nekhteb fih, ana hebit nsaltih(insulter) . Alors 3awedlou lektiba. Ou kteb kina nahdarlek. La Pudeur m’interdit de vous dire les mots qu’ils m’a dictés car ils ne sont plus dans les manuels d’ornithologie d’aujourd’hui.
J’ai un autre commentaire, en attente de roqyage chez l’Imam Ghafour, je le poste dès retour.
iles-is ttimeqsin, a winnat ! Vous n’êtes pas obligé d’avoir des avis sur tout. Surtout quand c’est à l’emporte-pièce.
Amalgames, tir à vue sur tout ce qui bouge ! S ttawil kan a yahbib !
Je m’embrouille je ne sais plus à Quel saint me vouer!
Lla Validassyou, corrigera mon tir,
J’allais souligner ici le ton cérémonieux adopté par Feraoun, et je ne sais plus si j’ai expédié mon post à la bonne adresse.
Il y a lonta ,3emi Hmed lmarouki, est venu me voir pour que je lui écrive une lettre au directeur de loukasyou familiale, qui lui diminuée sa pansyou.
Je lui ait fait une lettre à aa Mouloud Feraoun pleine de politesse. Quand je l’ai lu ,
mi Hmed est devenu furieux. Il m’a dit : Lalla a Khali Lqebeyli, ana maranich netleb, hadda heqi.
Alors drahem matchi ta3 yemah, wahed l3et… ! Maranich nekhteb fih, ana hebit nsaltih(insulter) . Alors 3awedlou lektiba. Ou kteb kina nahdarlek. La Pudeur m’interdit de vous dire les mots qu’ils m’a dictés car ils ne sont plus dans les manuels d’ornithologie d’aujourd’hui.
………….
« On ne peut lire un texte aussi lucide sans avoir une pensée pour Boualem Sansal, assassiné à petit feu, sous nos yeux impuissants, par les héritiers de l’OAS. » Que c’est bien dit !
OK ! OK ! Tous les goûts sont dans la nature. Mais moi, je n’aime pas cette relation.
Comment ? Camus, las d’amadouer l’ »indigène » qui, selon lui, ne lui rendait que de la férocité, choisit sa mère plutôt que la justice. Mais, nos deux intellectuels lui adressent des révérences et de la prose.
Feraoun, sous prétexte que Camus était un « sans-dents » comme lui, l’enseveli sous l’encens pour se permettre des familiarités.
Le colonialisme n’est pas une fiction mais une réalité sanglante. Face à cette réalité, je n’aurais pas été inspiré comme Shakespeare et son Roméo, mais plutôt comme Bruno Traven dans La révolte des pendus.
C’est tout de même dingue : on nous présente la relation entre Feraoun, Jean Amrouche et Camus comme celle des derniers intellectuels ayant conservé leur raison, pendant que tous les autres l’auraient perdue.
Je ne dis pas qu’ils avaient exactement le même regard sur les événements – même si tout pousse à le croire –, car ils étaient tous issus d’une même école qui les avait éduqués à la bonne conscience. Une convergence totale n’était donc pas possible. Leur relation n’avait rien de passionnel : je la qualifierais simplement d’intellectuelle. Feraoun et Amrouche avaient un rapport terrestre à la colonisation, tandis que, pour Camus, le colonialisme restait une abstraction théorique. Un roman.
Au fond, cette relation n’était qu’une politesse. La comparaison est presque malencontreuse. J’ai juste un regret : tout se passe comme si ces deux écrivains kabyles avaient une dette envers Camus, comme s’il incarnait à leurs yeux une image fantasmée de la France.
Je comprends maintenant pourquoi certains défendent Sansal. Et encore, lui a l’excuse de la distance et de l’anachronisme.
Alors que Feraoun et Jean Amrouche n’assumaient pas leur regrets, Sansal, lui, aurait présenté franchement des excuses , pour l’ingratitude de ses compatriotes.
Je cite: « … tout se passe comme si ces deux écrivains kabyles avaient une dette envers Camus, comme s’il incarnait à leurs yeux une image fantasmée de la France. »
Je pense que c’est plutot UNE ATTENTE de lui, une de denonciation ou peut-etre de deviner leurs espoirs et a lui de les formuler a la france.
Cependant, de quoi se plaignent-ils… Mouh c’est mieux que Bonne-a-petre?
Une chose est sure, une mefience se deguage de leur correspondance. Camus devait se sentir perplexe devant la mouhmouhation assume’e de Feraoun. Ou peut-etre que le Camus se sens mal place’ se sachant quelqu’un qui a mis-de-cote’ son Judaisme anterieur pour se faire accepter a moitie’… il doit bien en etre conscient et se dire Mais pourquoi combattre le colon de vos terre et ne rien faire, meme pas rejeter, celui de la tete ?
Cette touchante lettre est pleine de pépites. Je reprend cette expression dépeignant parfaitement l’époque: « Révolte arabe des kabyles ! ». Elle nous renvoie à notre condition de 3 collège. Nous étions la dernière roue de la charrette coloniale qui n’a même pas la reconnaissance du statut.
Les récits des anciens qu’on retrouve fidèlement transcrits dans le reportage d’A. Camus sur les famines en Kabylie témoignent du volet matériel de de ceux qui vivaient la condition du 3e collège.
La domination des européens était économique et politique. La domination de l’islam et de l’arabisme est identitaire. Aux privations économiques et politiques s’ajoute celle plus pernicieuse plus destructrice du déni.
Le colonialisme n’étant plus, la domination économique sur des bases ethniques a disparu. En lieu et place, nous avons la mainmise des militaires sur le pays qui reprennent ainsi les usages de l’époque turque en la matière. La domination identitaire est restée telle qu’elle et est même promue en pilier de survie du nouveau régime.
Comme à l’époque coloniale, ceux qui ne ressentaient plus le déni identitaire tournent le dos au pays. Ils se plaisent même qu’on leur raconte qu’ils sont de la veine des conquérants.
J’ai noté au passage quelque chose qui m’a intrigué .Un détaille diriez-vous. Je ne suis pourtant ni un puriste ni un littéraire, je ne donne pas une analyse mais juste un sentiment. Une lecture impressioniste. j’ai été tout de même surpris par l’usage du « m » minuscule pour « Monsieur » qu’il a repris à plusieurs reprises pour d’adresser à Camus. Je pense que le choix de Feraoun d’écrire « monsieur » en minuscule dans sa lettre à Camus ne relève pas du hasard. Ce détail typographique, apparemment anodin, ne marque-il pas volonté de rupture. Il retire à Camus la « distinction » dont pourtant il l’attribut et du respect t protocolaire pourtant affiché. Dans le contexte de la guerre d’Algérie, ce « m » minuscule n’est pas un simple écart de style : il signifie une séparation. Feraoun, pris dans la réalité coloniale et ses violences, semble vouloir replacer Camus dans son propre camp – celui des Européens d’Algérie – tout en revendiquant son appartenance aux siens. Ce choix est révélateur d’un désarroi : celui d’un homme qui, face à l’intransigeance des positions en temps de guerre, reconnaît en Camus un interlocuteur singulier, mais lui rappelle qu’il reste malgré tout du côté du pouvoir colonial, volontairement ou non.
Cette nuance typographique et syntaxique est d’autant plus frappante lorsqu’on la met en parallèle avec des expressions comme « les miens », « les vôtres », qui, bien que marquant un rapport d’appartenance, peuvent également être employées avec une certaine distance, notamment dans un contexte où l’auteur semble observer plutôt que s’inclure pleinement. Il ne dit pas « nous », mais « eux », tout en conservant un lien. Ce procédé permet à Feraoun de parler de ce groupe sans s’y fondre totalement, d’en être issu tout en le tenant à distance critique.
Je ne crois pas que ce choix d’écriture soit anodin: il s’inscrit dans une attitude discursive plus large où Feraoun refuse de s’impliquer ,il adopte une posture de témoin, voire de moraliste, qui juge et évalue de l’extérieur. La minuscule devient ainsi le marqueur d’un entre-deux, d’une appartenance mitigée, d’un regard ambivalent oscillant entre inclusion et distanciation.
j’ai vu détaille et attribut en un coup d’oeil , le reste jipalta
«Je ne voudrais pas non plus accabler mes compatriotes d’origine européenne qui, je sens, je le pense, en dépit des cruelles apparences, sont aussi près de moi que n’importe quel autre habitant de ce pays. Mais il faut bien reconnaître qu’ils ont tiré tout bénéfice d’une ambiguïté soigneusement entretenue, que nous n’avons jamais eu la possibilité de dénoncer, nous contentant, avec plus ou moins de véhémence, plus ou moins d’illusions, plus ou moins de bonheur, de réclamer notre part de ce bénéfice comme prix de notre attachement (forcé) à la France. Cette équivoque, à mon avis illégitime, est la source de nos communs malheurs. »
Sur le plan identitaire, il suffit de remplacer ‘européens’ par ´arabophones’ (en realité, dardjophones) pour dissiper l’illusion de notre indépendance et avoir le topo d’une situation coloniale qui, pour nous, kabyles, perdure depuis les années 1850.
Tout en étant sur le fond d’extraction berbère, les dardjophones et les islamistes ont toujours tirés parti sur les plans culturels et identitaires des ´constantes nationales’, piliers idéologiques du régime.
Je ne crois pas que Feraoun faisait cette distinction , il était Kabyle, mais pas moins nationaliste comme d’ailleurs les berbéristes de son temps. Kabyle dans les veines, mais algériens avec les arabophones qu’il n’excluait pas.
Cependant , moi qui n’ai fait que l’école buissonnière de Guezgata jusqu’au certificat d’étude que j’ai raté trois fois., voila comment j’aurais écrit à Camus.
Bismi allah errahman errahim,
Ya khouya Camus La3ziz,
De nos montagnes, de nos plaines, de nos villages, des appels à la révolte fusent. Eux, ils veulent nous faire taire, nous étouffer sous le poids de leur silence, et nous forcer à croire que l’absence de réponse est le verdict ultime. Mais vous, monsieur, vous avez choisi pire que le silence : une réponse à une question qui n’a pas été posée. Ils attendaient de vous une condamnation sans appel, une légitimation de leur violence, et vous leur avez offert la seule chose qui ne puisse être acceptée : noyer votre indifférence dans une pensée libre. Pire encore, vous avez, par votre silence, choisi l’omission. Ce silence dans lequel vous vous êtes vautré est une impardonnable diversion. On nous exécute par le déni.
Nous savons, nous, ce que vaut ce mutisme. Nous savons qu’il n’est que l’ombre portée de l’aveuglement et de la peur, qu’il ne peut être que provisoire, qu’il annonce l’explosion. Car l’histoire ne s’arrête pas là où le pouvoir le décrète, elle ne s’enterre pas sous les discours des vainqueurs, elle germe sous les pas de ceux qu’on croyait brisés. L’Algérie saigne, mais elle n’est pas morte.
Les vôtres ont conquis, ils ont pris, ils ont dépecé ce pays comme une bête livrée aux rapaces. Ils ont fait de nous des vaincus, des humiliés, et de vous des complices malgré vous. Ils vous ont laissé parler tant que votre voix ne dérangeait pas, tant que votre plume n’égratignait pas le mythe qu’ils se racontaient à eux-mêmes. Mais dès que vous avez osé refuser leur partition, dès que vous avez cessé de dire que ce pays leur appartenait de droit, ils vous ont bannis. Vous n’étiez plus des leurs. Vous aviez trop vu, trop compris.
Et nous ? On nous a laissés mendier un droit de regard sur notre propre existence. On nous a tolérés à condition que nous rampions, que nous devenions de bons indigènes, que nous parlions leur langue sans élever la voix. Ceux qui ont voulu croire à l’assimilation, tout en rejetant l’idée de s’assimiler eux-mêmes au risque inéluctable que cette terre qu’ils ont volée les rejette, n’ont trouvé, en bout de course, que mépris cinglant et rejet tranchant. Car cette assimilation n’était qu’un leurre, un mirage destiné à nous maintenir dans l’attente, à nous faire oublier que nous étions déjà autre chose : un peuple, une nation en devenir.
Mais cette nation, ils la refusent. Ils n’ont jamais voulu de nous que soumis, jamais voulu de notre histoire que mutilée, jamais voulu de notre avenir que sous leur joug. Ils disent : « Nous sommes Algériens. » Nous entendons : « Nous sommes Français, et vous n’êtes rien. » Car la vérité, c’est que nous ne pouvions être que ce que nous sommes : Algériens, sans atténuation, sans concession. Ce nom qu’ils nous refusent, nous le reprenons de force.
Qu’ils nous exterminent, s’ils le peuvent. Qu’ils déchaînent toute leur violence, nous avons déjà trop subi pour reculer. Vivants, nous sommes morts ; morts, nous serons vivants. Alors qu’ils fassent parler leurs armes, qu’ils broient nos villages, qu’ils nous soumettent à la « question » Fautes d’atteindre nos consciences qu’ils torturent nos corps – ils ne font qu’accélérer l’inéluctable. Car même si nous devions tomber tous, d’autres renaîtront de nos cendres, ou comme dit Teryèle, l’ogresse de nos fables, ces cendres seront nous. Ils recommenceront le combat encore et encore.
Les masques tombent. Ceux qui nous parlaient d’humanité nous traitent en bêtes. Ceux qui se disaient nos frères nous chassent à coups de canon. Très bien. Nous avons cessé d’espérer leur justice, nous ne réclamons plus leur reconnaissance. Nous savons maintenant que notre seul avenir est entre nos propres mains. Il n’y a plus d’alternative : il faut tout prendre ou tout perdre. Il faut faire taire cette bête immonde qui nous piétine et reconstruire, sur ses ruines, notre propre monde.
Demain, le rideau de fumée se dissipera et, sous les décombres de l’histoire, la vérité apparaîtra, nue et brutale. Et vous, Camus ? Où serez-vous, monsieur, quand le sort vous jettera du mauvais côté ? Vous vous consolerez sans doute auprès de votre « mère » que l’épée de la « justice » aura épargnée, et retournerez à vos abstractions théoriques, excellemment interprétées auprès de disciples consentants. Vous avez voulu éviter la guerre en criant raison à des hommes sourds. Maintenant que la guerre est là, où poserez-vous vos pas ? Mais vous êtes trop enfermé dans votre contenance. Vous pouvez vous esquiver avec des mots, mais les balles qui fusent de partout ne ratent pas leurs cibles. Alors sauvez-vous !
Désormais, nous ne demanderons plus, nous prendrons !
Je vais forcer la comparaison, même un peu trop : on peut dire que la kabylité de M. Ferouan et sa génération c’est comme l’artisanat et l’artisan. L’artisan sait manier à la perfection les outils, faire des merveilles de ses mains. Et quand il s’agit d’aligner deux phrases pour expliquer son métier, il est se révèle moins habile.
Taqvaylit transparait dans tout ce qu’écrit M. Feraoun sans qu’il ait besoin de trop mettre le mot dessus. A contrario, nous bégayons continuellement avec l’agitation de ceux qui n’arrivent pas à aller au fond des choses.
Les choses prennent parfois du temps pour arriver à terme.
s
Monsieur Feraoun,
J’aurais pas été surpris par votre lettre qui m’est adressée personnellement, si je ne connaissais pas le penchant des vôtre pour les familiarisations même si vos épanchements sont dans l’air du temps. Il me semble que, emporté par l’ardeur de votre fougueuse passion pour une Algérie qui n’existe que dans vos rêves, vous croyez pouvoir vous permettre de vous adresser à Camus pour lui soumettre vos élucubrations, dont l’intensité, je le crains, trahit plus une réaction passionnée qu’une juste appréciation des faits. Je ne vous en blâme point ; je comprends qu’il est tentant, lorsqu’on n’y est pas invité, de s’investir soi-même d’une mission ou d’une cause, de s’arracher sa place par effraction. Mais, voyez-vous, ce genre d’impertinence ne glorifie nullement et n’est point la voie qui conduit au Panthéon, outre qu’il ne permet pas d’atteindre le haut niveau de complexité de la situation qui manifestement vous incommode.
Je ne puis m’empêcher de noter, dans vos lignes, une certaine crispation à l’idée que l’on puisse regarder votre pays avec un regard que la rigueur intellectuelle exige qu’il ne soit pas complètement naïf. Moi, monsieur, ce regard, je l’ai posé, non comme un tribun, un idéologue, ou un pêcheur en eau calme qui taquine le poisson avec des cailloux, mais comme un homme qui cherche, dans la mesure de ses forces, à exprimer ce qu’il perçoit au fond de l’humanité et seulement ce qu’elle donne à voir. Vous me reprochiez avec beaucoup de sollicitude, presque maladroitement car vous n’osiez pas le faire autrement, de ne pas avoir pris parti comme vous l’auriez souhaité, et vous vous étonnez que je refuse d’endosser certaines de vos certitudes. Ne croyez-vous pas qu’il y a chez vous un paradoxe inhérent à votre double culture, et c’est là le drame, qui vous emprisonne dans une impossible conciliation ?
Mais voyez-vous, je me suis toujours tenu à distance des certitudes assénées avec ferveur. Il me semble que l’écrivain, s’il doit choisir, ne saurait être un militant : sa tâche est d’éclairer, et non d’enrôler. S’il faut tuer un homme, ce ne sera ni par la plume ni par le soleil, mais par une vérité qu’on ne saurait ignorer. Si vous cherchiez la justice, mal vous en a pris de vous adresser à Camus. N’ai-je pas répondu à cette question ? La justice des hommes, ou leur justice, c’est, nonobstant mon plus féroce ami, de l’humanisme aussi. Caïn n’a-t-il pas tué son frère ? Il n’y avait pourtant pas d’Algérie à se partager. Alors l’indignation comme excuse, l’indignation littéraire, pour romancer, je ne puis la tolérer que si elle ne se permet pas de se substituer à la lucidité. Mieux vaut être désabusé.
Mais bien sûr vous ne pouvez pas renoncer, vous n’en avez pas le courage, l’appel de la forêt vous a déjà récupéré, vous êtes déjà rentré chez vous, dans votre kabylité.
Les causes justes, monsieur, sont une commodité chez les intellectuels et une ferveur de charbonnier chez les hommes ordinaires. Je me méfie comme de la peste des excès et des épanchements auxquels je préfère la rigueur analytique. Ce n’est pas une esquive, bien au contraire, mais une exigence théorique.
Quant à l’accusation implicite que vous formulez – celle d’un regard distant, peut-être condescendant, ou pire d’un silence complaisant – je ne saurais que vous répondre sinon que la distance n’est pas toujours le signe du mépris, mais parfois celui de la neutralité objective. S’il est aisé de s’abandonner aux passions collectives, il est plus difficile de préserver, hors de la procession des fidèles, cette salvatrice individuation, indispensable à toute lucidité et indépendance d’esprit, qui permet encore de voir.
Voilà, monsieur, pour ne pas me défiler, sans besoin ni nécessité de vous convaincre, ma réponse. Mais simplement témoigner de mon attachement à une certaine forme d’implacable vérité qui ne saurait qu’être « Étrangère » à la vôtre.
Puissiez-vous à votre tour voir.
Bien à vous,
Albert Camus