Depuis la destruction d’un drone malien par l’Algérie à Tin Zaouatine, à la frontière entre les deux pays, dans la nuit du lundi 31 mars au mardi 1er avril, la tension n’a cessé d’augmenter.
Le Mali et ses alliés, le Niger et le Burkina Faso, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), se rebiffent contre l’Algérie. Alors que ces pays sont en butte à de sérieux problèmes de sécurité, ils se permettent d’ouvrir un nouveau front avec leur grand voisin du nord, l’Algérie. Dans des communiqués très virulents du dimanche 6 avril, cette alliance des pays du Sahel a affirmé que le drone malien n’avait jamais pénétré l’espace aérien algérien et ont accusé Alger d’être un « exportateur de terrorisme ».
Aujourd’hui, c’est l’Algérie qui réplique sur un ton tout aussi ferme, dénonçant des « allégations mensongères » qui, selon elle, servent de « dérivatifs à l’échec » du « projet putschiste » malien. Alger et Bamako se sont fermés mutuellement leur espace aérien, ce qui intensifie le conflit, bien que celui-ci ne prenne pas encore une dimension militaire.
Dans son communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce l’Algérie comme un « bouc émissaire » pour les autorités maliennes, accusées de tenter de masquer leurs échecs sur les plans politique, économique et sécuritaire. Alger fait aussi référence à l’incapacité des « putschistes » maliens à mener une véritable lutte antiterroriste, évoquant le groupe russe Wagner.
Concernant le drone, l’Algérie apporte des précisions, en détaillant que toutes les données du ministère algérien de la Défense, y compris les images radar, attestent d’une violation de l’espace aérien algérien à « minuit huit minutes sur une distance de 1,6 kilomètre ». Selon Alger, le drone se serait ensuite éloigné avant de revenir avec une trajectoire offensive, justifiant ainsi sa destruction. Elle ajoute que ce n’est pas la première fois qu’un drone malien pénètre l’espace aérien algérien, citant des incursions précédentes en août et décembre 2024.
Les deux pays affirment disposer de preuves irréfutables concernant la trajectoire du drone, mais aucune des deux parties n’a choisi de les rendre publiques, laissant ainsi le champ libre à la spéculation parmi les observateurs, et au dilemme pour les citoyens des deux pays de choisir leur camp.
Espace aérien fermé
Le lundi 7 avril, le ministère algérien de la Défense a annoncé la fermeture de son espace aérien à tous les appareils en provenance ou à destination du Mali, sans plus de détails, ce qui concerne également les vols civils commerciaux. En réponse, le Mali a fermé son propre espace aérien aux aéronefs algériens, civils et militaires.
Cependant, cette fermeture ne concerne pas les alliés du Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui restent autorisés à survoler l’espace aérien algérien. Alger a d’ailleurs exprimé son mécontentement face à « l’alignement inconsidéré » de ces deux pays sur les accusations du Mali. Par « réciprocité », l’Algérie a rappelé ses ambassadeurs du Mali et du Niger pour consultation et reporté la prise de fonction de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso. Les trois pays de l’AES avaient, eux, rappelé leurs ambassadeurs en Algérie le dimanche 6 avril.
Les autorités maliennes, quant à elles, ont convoqué l’ambassadeur algérien à Bamako pour protester contre l’« hostilité » du régime algérien, annoncé leur retrait du Cemoc (Comité d’État-major conjoint) et indiqué leur intention de porter plainte devant les instances internationales « pour actes d’agression », sans préciser lesquelles. Bamako avait notamment accusé Alger de « parrainer le terrorisme international » et dénoncé « un acte d’agression inédit » dans les relations entre les deux pays.
Une tension latente pourrit les relations entre Alger et Bamako depuis que les putschistes ont décidé de remettre en cause les accords d’Alger et sont partis en guerre contre les combattants de l’Azawad.
Notre voisin du sud manque de réalisme. Sinon pourquoi diable le Mali, déjà bien empêtré dans sa guerre contre les djihadistes et les rebelles touareg, se permet-il de titiller l’Algérie qu’il sait incapable d’affronter ? Qui a intérêt à créer un nouveau front à l’Algérie dans sa profondeur du Sud ? N’y a-t-il pas des parties tierces qui pourraient tirer les ficelles de cette montée de tension ? Concrètement, actuellement ces pays du Sahel sont soutenus dans leurs lutte par au moins trois pays, la Russie par le biais de ses mercenaires Africa Corps (ex-Wagner), la Turquie qui fournit au moins des armes et sans doute les Emirats arabes unis qui se permettent de jouer les trouble-fête. Un autre pays, le voisin marocain, a déjà offert à ces pays du Sahel de les aider et de leur permettre un accès vers l’Océan par le territoire du Sahara occidental.
Au-delà de la guerre de mots, un aspect particulièrement inquiétant des tensions actuelles réside dans les exactions commises par l’armée malienne contre les populations locales. Ces actes ont notamment pris la forme de massacres de civils dans plusieurs régions du pays, ce qui aggrave encore la situation humanitaire déjà précaire. Plusieurs organisations internationales de défense des droits humains ont dénoncé ces tueries de civils commises par les militaires au Mali.
Les violences imputées par plusieurs ONG à l’armée malienne ainsi qu’aux mercenaires d’Africa Corps (Russie), qu’elles soient ciblées contre des communautés ou plus aléatoires, continuent de semer la terreur parmi la population civile. Que font les colonels de Bamako pour protéger leurs populations ? Etrangement, ils ont sous-traité la sécurité de leur pays (la leur ?) au profit de mercenaires et se piquent de nationalisme quand un de leur engin militaire est abattu. Une chose est claire : cette crise n’arrange pas aussi l’Algérie dont la voix devient de moins en moins audible en Afrique.
Rabah Aït Abache/agences





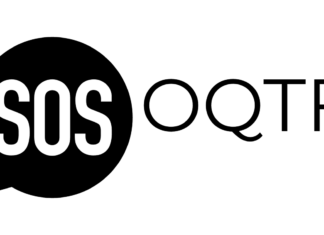





Gaza.