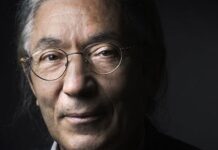Dans cet entretien exclusif avec Le Matin d’Algérie, Wafa Ghorbel, romancière, chanteuse et universitaire, nous ouvre les portes de son univers artistique et intellectuel. Marquée par une double appartenance tunisienne et française, elle tisse une œuvre où se mêlent identité, résilience et création.
À travers ses romans, tels que Le Jasmin noir, Le Tango de la déesse des dunes et Fleurir, elle explore les blessures de l’intime et les élans de vie, portée par une écriture polyphonique et musicale. De son rapport aux langues arabe et française à l’influence du flamenco ou de Georges Bataille, Wafa Ghorbel nous livre une réflexion profonde sur l’art, la mémoire et la capacité à « fleurir » malgré les failles. Cet échange révèle une artiste qui fait de l’entre-deux un espace de création vibrant, où la douleur se mue en lumière.
Le Matin d’Algérie : Votre parcours est marqué par une double appartenance, tunisienne et française. En quoi ce métissage nourrit-il votre imaginaire d’écrivaine ?
Wafa Ghorbel : Ce métissage ne fait pas que nourrir mon imaginaire : il le constitue. Ce double ancrage, parfois vécu comme un arrachement ou un déchirement, est en réalité un sillon fertile. J’écris depuis cette ligne de faille. Être entre deux terres, deux langues, deux cultures, c’est habiter un intervalle. Et c’est dans cet intervalle que mon imaginaire prend forme, qu’il tisse des ponts.
Je viens d’un jardin aux parfums mêlés, où le jasmin et la rose cohabitent sans se confondre. Le jasmin, c’est ma Tunisie natale : une fleur discrète, mais entêtante, qui embaume les nuits d’été et s’offre sans bruit. La rose, quant à elle, incarne la France : plus éclatante, plus codifiée peut-être, mais tout aussi essentielle à mon imaginaire. Elle évoque pour moi la langue française, avec ses pétales de douceur et ses épines de rigueur. Entre ces deux fleurs, il n’y a pas de hiérarchie, mais un tressage. Mon écriture naît précisément de ce bouquet, de ce tissage, de ce frottement entre deux sensibilités, deux rythmes, deux musiques. J’ai longtemps cru qu’il fallait choisir, renoncer à l’une pour appartenir pleinement à l’autre. Aujourd’hui, j’ose affirmer que c’est dans la tension entre les deux que je me tiens debout, et que j’écris. C’est peut-être cela, être écrivaine pour moi : concevoir une maison dans l’entre-deux, où le manque devient matière, où le va-et-vient devient source d’invention, de croisements, de correspondances. Mon écriture se tisse à partir de cette complexité identitaire, et c’est sans doute ce qui la rend mouvante, poreuse, toujours à la recherche d’une forme qui puisse accueillir l’écart, la fêlure.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes romancière, chanteuse, universitaire : comment ces trois dimensions dialoguent-elles entre elles dans votre création artistique ?
Wafa Ghorbel : Je ne les vois pas comme des identités séparées, des compartiments fermés, mais comme des voix complémentaires dans une même intériorité. L’universitaire en moi lit, analyse, interroge, met en perspective. La chanteuse cherche le rythme, l’intonation juste, l’émotion nue. Et la romancière accueille tout cela, le savoir et l’élan, la rigueur et la fièvre, pour écrire un monde à la fois pensé et senti. Au fond, ce que je cherche, c’est une forme de cohérence sensible : faire dialoguer la pensée et la voix, la scène et la page, l’esprit et le corps. Enseigner-chercher, chanter et écrire sont autant de manières d’habiter le monde et le langage qui se croisent, s’entrelacent, s’influencent. J’écris en chantant, je chante en écrivant, je pense en rythme, je romance en mélodie.
Le Matin d’Algérie : Vous avez choisi Georges Bataille comme objet de thèse et comme compagnon de route intellectuel. Qu’est-ce que sa pensée vous a permis d’ouvrir, ou de bousculer ?
Wafa Ghorbel : Bataille a été pour moi une secousse fondatrice. Il m’a permis de regarder l’obscur sans ciller, de sonder les limites du langage, de questionner le corps, la transgression, le désir, l’angoisse. C’est lui qui m’a offert l’audace, non pas de tout dire, mais de dire autrement, en acceptant l’éclat, le chaos, l’inconfort. Toutefois, mon univers romanesque ne ressemble pas du tout au sien. Mon écriture, même si elle peut emprunter le chemin du vertige, ne cherche pas l’annihilation. Elle est habitée par une autre énergie : celle d’une vie tenace, en dépit de sa fragilité.
Le Matin d’Algérie : Votre premier roman a été écrit en arabe, mais aujourd’hui vous écrivez en français. Comment vivez-vous cette bascule linguistique, et que dit-elle de vous ?
Wafa Ghorbel : Mon premier roman (non publié), je l’ai écrit vers l’âge de quatorze-quinze ans, en arabe littéraire. Ensuite, à l’université, je me suis spécialisée en langue et littérature françaises, parce que le pays des Lumières a toujours exercé sur moi une attirance inexpliquée. C’est en France, juste après le dépôt de ma thèse de doctorat, que j’ai commencé à écrire Le Jasmin noir, mon premier roman qui ne sera publié que bien plus tard. Dans ce contexte franco-français, les mots me sont venus plus naturellement en français.
La bascule, en vérité, n’en est pas une. Il s’agit plutôt d’une danse entre deux rives, deux voix qui m’habitent depuis l’enfance. L’arabe est mon premier amour. C’est la langue du berceau (ou presque, puisque le tunisien n’est pas vraiment l’arabe littéraire), ma langue maternelle, celle qui m’a appris à dire la tendresse, la colère, le manque, toujours avec pudeur. C’est la langue de mon surmoi. Le français, quant à lui, est la langue de la construction, de l’analyse, du rêve articulé, structuré. C’est l’amour choisi. J’ai appris à y penser, à y lire, à m’y libérer sans restriction, sans lignes rouges. Cependant, quand j’écris en français, je le fais toujours avec un souffle arabe, voire tunisien, en arrière-fond. Une sorte d’accent souterrain, une musicalité de l’exil. Des mots, des expressions, des chansons en arabe agrémentent mes écrits.
Ce passage d’une langue à l’autre ne gomme rien : il ajoute. Il me rend plus poreuse, plus attentive à l’esprit et au rythme de chacune. Mon écriture cherche justement à faire dialoguer ces deux sources, à en tisser une identité multiple. En somme, cette « bascule » linguistique parle moins de rupture que d’alliance, de traduction intime d’une voix en mouvement.
Le Matin d’Algérie : L’intime est très présent dans votre écriture. Quelle est votre frontière entre autobiographie assumée et fiction littéraire ?
Wafa Ghorbel : Je n’ai jamais écrit de texte strictement autobiographique. D’ailleurs, je remets en question le genre lui-même. J’écris des romans plus ou moins inspirés de ma vie, de mon parcours, ou de celui de personnes que j’ai croisées. Même Le Jasmin noir, qui est sans doute le roman le plus proche d’une part de mon histoire, ne saurait être rangé dans la case de l’autobiographie. Je dirais plutôt qu’il s’agit d’une autofiction. La frontière entre réalité et fiction est mouvante, poreuse. Je ne ressens pas le besoin de raconter ma vie, mais j’aime faire d’une expérience vécue, d’un frisson ancien, d’un souvenir enfoui, d’une blessure non suturée, ou d’un désir – comblé ou non – un point de départ pour la fiction. Très vite, cependant, les personnages s’éloignent. Ils prennent le large, vivent d’autres vies, empruntent d’autres voix. Je crois davantage à la sincérité de l’émotion qu’à la transparence du récit. Ce qui m’importe, c’est de toucher le lecteur, non de me confesser. En cela, je m’inscris dans une écriture de l’entre-deux : entre la vérité et la fiction, entre ce qui a été vécu et ce qui aurait pu l’être.
Le Matin d’Algérie : Dans vos romans, les personnages féminins affrontent des blessures profondes, mais cherchent à « fleurir » malgré tout. Peut-on parler d’une écriture de la résilience ?
Wafa Ghorbel : Oui, sans doute. Une résilience lucide, qui ne gomme pas la douleur, mais la sublime. J’ai horreur des récits où l’on « s’en sort » comme dans un conte moral. Ce qui m’intéresse, c’est le chemin, pas le triomphe. Mes héroïnes ne sont pas des modèles de force : elles tanguent, trébuchent, chutent, doutent, mais elles avancent, une fleur à la main, même flétrie, même noircie. Leur résilience est une manière d’habiter la faille autrement. Non pas de la refermer, mais d’y faire entrer la lumière : « N’est-ce pas par la blessure que la lumière entre en soi ? Rumi l’avait dit. Je danse pour fendiller davantage ma meurtrissure, l’étirer aux mesures de l’univers, y allumer un soleil doré et y faire pousser des fleurs… les fleurs du mal… les fleurs du bien. » C’est ce que dit Yasmine Ellil, l’héroïne de Fleurir (Fleurir, Kalima Éditions, p. 132). Mes héroïnes, comme des tournesols, s’inclinent vers la lumière sans pour autant renier l’ombre qui les a façonnées. Elles avancent toujours, même abîmées. Il y a en elles une obstination à vivre, à danser avec leurs blessures. Pour moi, écrire, c’est accompagner ce mouvement. La résilience suppose parfois une forme d’oubli. Moi, je travaille plutôt avec la mémoire, même douloureuse, même entachée.
Le Matin d’Algérie : Vous évoquez le flamenco comme un art salutaire, presque cathartique. En quoi la musique et la danse peuvent-elles, selon vous, réparer l’être ?
Wafa Ghorbel : Le flamenco dans Fleurir – comme le tango dans Le Tango de la déesse des dunes, comme le chant dans Le Jasmin noir – touche à quelque chose de viscéral. Il s’agit d’un cri esthétisé, d’une plainte mise en rythme, d’une douleur qui danse. Il y a dans cet art une manière de transfigurer la peine, de la porter à incandescence pour mieux la traverser : « Je danse pour écraser mon mal de mes pieds, pour le déchirer de mes mains, pour l’anéantir au rythme de cette musique déchaînée et de ces voix cassées et coupantes comme des lames. Je danse pour réhabiliter mon corps bafoué, mon corps meurtri. » dit Yasmine Ellil (Fleurir, p. 132). Je ne danse malheureusement pas comme Yasmine, mais je fais danser mes cordes vocales.
Quand je chante, c’est mon corps tout entier qui s’engage. Il devient instrument, caisse de résonance, terrain d’accueil pour les émotions enfouies… La musique, la danse, le chant ont ce pouvoir-là : ils permettent de dire ce qui ne peut se dire autrement. Ils court-circuitent la raison, contournent le mental et touchent au noyau brut de l’être. Je crois profondément que l’art peut réparer, non pas en effaçant les blessures, mais en les sublimant, en leur donnant une nouvelle forme, une dignité, une beauté. Il ne s’agit pas d’une consolation, mais d’une transmutation. Une façon de redonner souffle à ce qui étouffait.
Le flamenco, tout comme le kintsugi (cela s’applique aussi à toute forme d’expression artistique), est « l’art de sublimer les cassures, les fissures », comme l’explique Adam à Yasmine, dans Fleurir : « Kintsugi, veut dire réparer à l’or… Il s’agit d’une méthode japonaise qui consiste à réparer des objets cassés en porcelaine ou en céramique avec de la laque et de la poudre d’or, de mettre en valeur la cicatrice, de l’exhiber au lieu de la dissimuler… La fracture de l’objet ne signifie plus sa fin, mais plutôt son renouveau, le début d’un autre cycle de vie… » (Fleurir, p. 352).
Yasmine Ellil fait de La Singla, une bailaora gitane sourde-muette, son maître à penser, à danser : « Elle danse comme si sa vie en dépendait, comme si un cri, un gémissement ou une plainte allaient échapper des forces d’impulsion de son corps, comme si elle cherchait à chasser les fantômes du mutisme et du silence qui la hantent depuis sa naissance. » Como caballo sin freno « , chantait Camarón de la Isla, elle se déchaîne, libre, comme un cheval sans frein. » (Fleurir, p. 129).
Le Matin d’Algérie : Vous enseignez aussi bien le roman, la bande dessinée, le théâtre, la poésie que la chanson. Pourquoi est-il important, selon vous, d’ouvrir l’université à ces formes artistiques diverses ?
Wafa Ghorbel : Pour moi, il est essentiel d’ouvrir l’université aux différentes formes d’expression artistique parce que la littérature ne vit pas en vase clos. Elle se nourrit de tout : des images, des couleurs, des sons, des gestes, des silences. Ouvrir l’université, c’est refuser la hiérarchie implicite entre les formes dites « nobles » ou « savantes » et celles qu’on juge plus populaires ou périphériques. La bande dessinée, la chanson, le roman graphique ou la poésie performée sont des langages à part entière, avec leurs codes, leurs puissances, leurs fulgurances. Ils disent le monde autrement, parfois avec plus de justesse, de liberté ou d’impertinence que les formes académiques. Les enseigner, c’est interroger la littérature autrement, par l’image, par le rythme, par la voix.
En tant qu’enseignante, j’essaie de transmettre cette curiosité-là à mes étudiants : ne pas enfermer la pensée, ne pas sacraliser les genres, cultiver les passages, les dialogues, les frottements. L’université devrait être un lieu de vivacité, de mouvement, de tremblements, pas un musée du savoir figé, un bloc monolithique cloisonné. La littérature, comme l’université, respire par ses marges, ses tremblements, ses entrelacements, ses débordements d’émotion et de sens.
Le Matin d’Algérie : Vous avez mis plusieurs années pour écrire chacun de vos livres. Que se passe-t-il en vous durant ces silences ou ces lenteurs de la création ?
Wafa Ghorbel : Il se passe beaucoup de choses dans ces silences. En apparence, je me tais, mais en réalité, je décante. J’écoute, j’observe, je rumine. L’écriture ne se limite pas au moment où la main trace les mots : elle commence bien avant, dans le chaos des émotions, des lectures, des rencontres. Je mets du temps à écrire parce que j’ai besoin que les choses infusent. Je ne cherche pas à produire, mais à laisser advenir. Il y a dans la lenteur une forme de fidélité à soi, une manière d’attendre le bon tempo intérieur.
Chaque livre me demande une mue. Et cette mue ne se fait pas dans le bruit ni dans l’urgence (même si mes impulsions d’écriture, mes jets, se font dans l’urgence). Elle exige du silence, de l’immobilité parfois, une écoute très fine de ce qui frémit en profondeur. Ces lenteurs sont les conditions de ma sincérité. Elles sont nécessaires. Je n’écris pas pour combler un vide, mais quand quelque chose s’impose. Il me faut du temps pour laisser fermenter les images, les voix, les histoires. Parfois, le silence est une forme d’écriture. Il prépare le sol. Il me permet de vivre, de lire, d’écouter, de m’égarer aussi. Et puis, un jour, une phrase frappe, une musique s’élève, et le texte recommence à couler.
L’écriture, chez moi, n’obéit pas à un emploi du temps. Je ne suis pas de ces écrivains organisés qui écrivent de cinq heures du matin à midi ou de minuit jusqu’à l’aube. Je suis une passionnée, et non une professionnelle de l’écriture. Mon écriture obéit plus à mes pulsions, à mes impulsions qu’à un devoir cérébral à accomplir.
Le Matin d’Algérie : Vos titres – Le Jasmin noir, Le Tango de la déesse des dunes et Fleurir – évoquent tous des tensions entre beauté, douleur, et mouvement. Comment les choisissez-vous, et que symbolisent-ils ?
Wafa Ghorbel : Je choisis mes titres comme on choisit un parfum : ils doivent condenser l’essence du livre, en suggérer l’effluve sans tout dire. Il s’agit de seuils, de promesses, d’indices à explorer. J’aime les titres qui portent en eux une tension et qui interpellent l’imaginaire. Le Jasmin noir, par exemple, est une image oxymorique qui réunit deux contraires : la fleur la plus immaculée et la couleur du deuil, disant une complexité, une beauté blessée, une enfance bafouée. Le Tango de la déesse des dunes métisse une danse occidentale et un paysage oriental. Il mêle la sensualité du mouvement à l’aridité du paysage intérieur. Quant à Fleurir, c’est un verbe à l’infinitif qui cherche à être conjugué et que chacun peut conjuguer (ou pas) à sa façon, au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel… Il m’a été inspiré par le mot espagnol floreo qui, dans le répertoire flamenco, « désigne ces figures travaillées des mains et des doigts, ces gestes qui imitent les mouvements des pétales d’une fleur, d’où l’appellation florale. » (Fleurir, p. 126). Ces titres sont des clés d’entrée. Ils donnent le ton, l’impulsion de chacun de mes romans. Je les entends souvent avant même d’avoir écrit le livre. Ils sont comme une musique inaugurale, une vibration première qui guide l’écriture. Ils sont parfois la matrice même du livre.
Le Matin d’Algérie : Fleurir s’impose par sa structure narrative très travaillée, presque musicale, où se croisent et se répondent les voix de Yasmine, d’Adam et de Yassine Ellil. Pourquoi avoir choisi cette construction polyphonique, et comment s’est imposée cette forme symphonique à votre écriture ?
Wafa Ghorbel : Dans Fleurir, il y a deux récits principaux : le récit encadrant narré par Adam et le récit encadré tenu par Yasmine dans son journal intime. D’autres mini-récits viennent s’enchâsser dans cette structure, comme ceux des migrants, pour me permettre d’aborder d’autres voix, d’autres réalités. Je voulais écrire une partition plus qu’un récit linéaire. Fleurir est né de cette polyphonie, de ce chœur intérieur. En écrivant, je n’entendais pas une seule voix, mais plusieurs, qui se répondaient, se contredisaient, s’interpellaient. Yasmine, Adam et Yassine Ellil ne sont pas seulement trois personnages : ce sont trois angles, trois prismes à travers lesquels une même histoire se déploie différemment. Chacun d’eux a vécu un traumatisme d’enfance qui l’a marqué à jamais.
Toutefois, leur façon d’y répondre est très différente : résignation, rébellion, sublimation ou suicide sont autant de réactions possibles face aux drames de la vie. La polyphonie est intéressante parce qu’elle complexifie le regard. Elle oblige le lecteur à composer lui aussi, à naviguer dans l’incertitude, à faire entendre en lui ce tumulte de vérités possibles. Et puis il y a dans cette structure quelque chose de musical. J’ai voulu que le texte respire comme un morceau, avec ses crescendos, ses silences, ses reprises. Chaque voix apporte sa couleur, son rythme, sa façon de faire. Écrire ainsi, c’était tenter une forme vivante, mouvante, qui ne s’enferme pas dans une logique causale, mais qui épouse les méandres et les soubresauts de l’âme et de la vie.
Le Matin d’Algérie : Le jeu d’échos, de reflets et de récits enchâssés dans Fleurir crée une architecture littéraire dense et mouvante. Peut-on dire que cette mise en récit multiple est une façon d’explorer les différentes facettes d’un même traumatisme, ou d’un même espoir ?
Wafa Ghorbel : Oui, tout à fait. Je l’ai un peu expliqué dans la question précédente. Cette mise en récit multiple est une manière d’explorer les strates d’un même traumatisme, mais aussi d’un même désir de vie. Chaque voix porte sa part d’ombre et de lumière, et c’est dans leur entrecroisement que quelque chose se révèle. Entre Yasmine, violée par son enseignant et mariée de force, Adam, noyé par son frère et devenu bègue, et Yassine à jamais piégé dans la culpabilité d’avoir été à l’origine du handicap de son jumeau, la tresse du drame est au complet. Yasmine se soumet d’abord aux lois patriarcales et finit par se livrer à un vent de révolte et de flamme de flamenco. Adam fait de son handicap sa force, son art. Yassine, quant à lui, tente d’affronter, mais la crue est insurmontable. Je crois, par ailleurs, que nous sommes tous faits de récits enchâssés, de couches superposées d’émotions, de regards croisés. En écrivant Fleurir, je voulais donner corps à cette complexité, sans simplifier, sans lisser. Au contraire, j’ai cherché à laisser émerger les contradictions, les frottements, les angles morts. Cette architecture mouvante offre plusieurs chemins vers un même centre : celui d’une blessure intime, mais aussi celui d’un élan vers l’avenir, vers la beauté, vers l’art.
Le Matin d’Algérie : Si vous pouviez glisser un mot, une phrase, dans un roman que lirait une jeune fille de treize ans, en Tunisie ou ailleurs, qu’aimeriez-vous lui dire ?
Wafa Ghorbel : Merci pour cette question essentielle. Voici la réponse, telle que je l’écrirais, en écho profond à Fleurir. Je lui dirais : « Tu n’es pas ce qu’on t’a fait. Tu es ce que tu choisis de devenir. » Yasmine a vécu le pire, pourtant elle ne s’est pas laissé faire : « C’est à ce moment que je découvre que vivre est une décision que seule moi peux prendre. Quand on touche le fond de l’abattement, quand on est plus bas que terre, plus bas que mer, plus bas que tout, il ne reste que deux alternatives : s’enliser, sombrer irrémédiablement, sans appel, s’anéantir et en finir… ou remonter, renaître de ses eaux, de ses cendres, de ses meurtrissures en feu, bourgeonner et fleurir. Et c’est la renaissance que je choisis. » (Fleurir, p. 123). Je voudrais qu’elle se dise : « Si Yasmine l’a fait, moi aussi je peux le faire ! Je peux renaître ! Je peux fleurir ! »
Et j’ajouterais peut-être : « Ton corps t’appartient. Ta voix aussi. Même si on a tenté de les éteindre, de les anéantir, ils sont là, en toi, vivants, résistants. » Je voudrais que cette jeune fille sache qu’elle n’est pas seule, que d’autres femmes ont connu l’abîme et qu’elles s’en sont relevées, parfois boiteuses, mais debout.
Je ne suis pas donneuse de leçons, c’est pour cela que je voudrais qu’elle lise dans mes romans, notamment dans Fleurir, non pas une leçon, mais un souffle, une promesse de floraison. Je voudrais qu’elle sache simplement que l’on peut refuser le récit imposé par les autres, qu’on peut écrire un jour sa propre histoire.
Merci du fond du cœur pour cette traversée attentive de mon univers romanesque, de ses éclaircies comme de ses ombres.
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Prix littéraires
2016 Prix Découverte des Comar d’or pour Le Jasmin noir
Prix de la Fête annuelle des écrivains de la région de Sfax pour Le Jasmin noir
2018 Prix Béchir-Khraïef de création littéraire dans le roman
Prix de la Foire internationale du livre de Tunis pour Le Tango de la déesse des dunes
Prix Zoubeida-Bchir – prix de la création littéraire en langue française du CREDIF pour Le Tango de la déesse des dunes
2024 Prix spécial du jury des Comar d’or pour Fleurir