Un petit archipel perdu au milieu de l’océan Indien, un peuple déraciné, une base militaire au cœur de la guerre froide : l’histoire des Chagos ressemble à une tragédie coloniale dont les échos résonnent encore aujourd’hui.
Plus d’un demi-siècle après leur expulsion, les Chagossiens poursuivent leur lutte pour le droit au retour et la reconnaissance de leur souveraineté. En août 2025, ils ont franchi une étape décisive en proclamant leur propre gouvernement de transition.
Un peuple effacé des cartes
Situé entre 4°54′ et 7°39′ Sud, et 70°14′ à 72°37′ Est, l’archipel des Chagos est composé d’atolls, d’îlots et de récifs coralliens. Ses habitants, les Chagossiens, sont issus d’un métissage ancien : esclaves malgaches, travailleurs indiens, navigateurs arabes et comoriens ont peuplé ces terres isolées. Dès 1784, une communauté stable s’y est implantée, soudée autour d’un créole spécifique, d’une culture insulaire et de liens familiaux profonds.
Tout bascule à la fin des années 1960. Entre 1968 et 1973, Londres décide, en accord avec Washington, de vider l’archipel de ses habitants pour installer une base militaire américaine sur Diego Garcia. Les maisons sont incendiées, les registres civils détruits, les chiens tués, les habitants embarqués de force vers Maurice et les Seychelles. Des milliers de vies sont brisées.
« Nous avons été traités comme des objets qu’on déplace », témoigne encore aujourd’hui une survivante de cette expulsion.
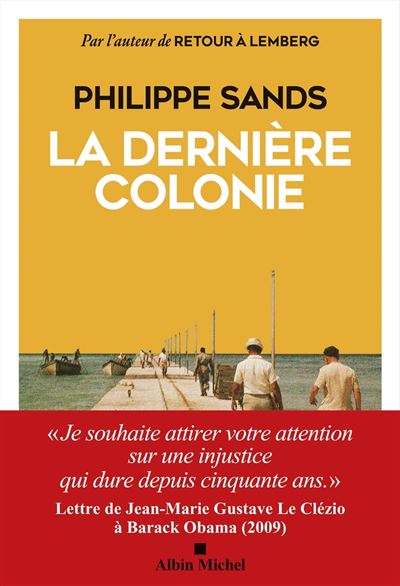
Un exil interminable
Depuis plus d’un demi-siècle, les Chagossiens survivent dans la diaspora. À Maurice et aux Seychelles, ils ont été relégués dans la pauvreté et la marginalisation. Au Royaume-Uni, certains ont pu obtenir la nationalité britannique, mais sans jamais retrouver leur terre. Beaucoup sont morts sans avoir pu revoir leur île natale, enterrés loin de leurs ancêtres.
Les recours juridiques n’ont pas manqué. Les tribunaux britanniques et européens ont été saisis à plusieurs reprises. Chaque fois, le droit au retour a été reconnu, mais systématiquement repoussé au nom de la « sécurité nationale ». Pourtant, la Cour internationale de Justice a jugé en 2019 que l’administration britannique de l’archipel est illégale, et l’ONU a exigé la fin de cette occupation. Sur le terrain, rien n’a changé.
Des droits bafoués
L’expulsion des Chagossiens constitue une violation flagrante du droit international. La Charte des Nations unies garantit le droit à l’autodétermination. Le Pacte international sur les droits civils et politiques protège la liberté de résidence.
La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones interdit les expulsions forcées. La Charte africaine reconnaît le droit au retour et à la dignité. Surtout, au moment de leur déplacement, les Chagossiens étaient citoyens britanniques. Leur déportation par leur propre État reste une anomalie juridique et morale.
Le sursaut de 2025
Le 19 juin 2025, un geste historique a redonné un souffle nouveau à la cause : la création du Gouvernement de Transition de la République de l’Archipel des Chagos (GTRAC). Pour ses initiateurs, il ne s’agit pas d’un simple symbole mais d’un acte fondateur.
Le GTRAC affirme représenter l’ensemble du peuple chagossien, en exil comme dans la diaspora. Il revendique toutes les îles, leurs eaux et leurs récifs. Sa mission : organiser le retour, restaurer la dignité, et relancer une culture menacée par l’oubli.
« Nous ne voulons plus attendre que d’autres décident pour nous. Notre avenir, nous l’écrivons nous-mêmes », proclame un membre du gouvernement de transition.
Une bataille juridique et mémorielle
La démarche des Chagossiens s’inscrit dans une longue tradition de luttes postcoloniales. Le juriste Philippe Sands, dans son essai La Dernière Colonie (2022), a montré comment la question des Chagos incarne la persistance de la logique coloniale. À travers ce livre, il souligne que la souveraineté n’est pas seulement une affaire de traités et de frontières, mais aussi de mémoire et de réparation.
Les Chagossiens, comme d’autres peuples déplacés, rappellent que la décolonisation n’est pas un processus clos. Elle reste inachevée tant que des communautés entières vivent déracinées, privées de leur sol et de leurs droits.
Un enjeu géopolitique
Au-delà du drame humain, l’affaire des Chagos illustre la puissance des intérêts stratégiques. La base de Diego Garcia reste un pivot militaire majeur pour les États-Unis dans l’océan Indien. Sa position, entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, en fait un atout incontournable. C’est cette dimension géopolitique qui explique en grande partie l’aveuglement persistant face aux droits des Chagossiens.
Mais le monde change. La montée des revendications autochtones, les débats sur la justice environnementale et la pression internationale obligent les grandes puissances à reconsidérer leur position.
Pour les Chagossiens, la lutte n’est pas seulement politique : elle est existentielle. Il s’agit de retrouver la terre des ancêtres, de reconstruire les villages, de préserver la langue et de réhabiliter les cimetières. La restitution est perçue comme la seule voie vers la guérison.
« La souveraineté, c’est une étape. Mais ce que nous voulons avant tout, c’est rentrer chez nous », résume un représentant chagossien.
Plus de cinquante ans après leur expulsion, les habitants des Chagos rappellent au monde qu’aucune base militaire, aucune raison d’État, ne peut effacer un peuple. Leur combat interroge non seulement la mémoire coloniale mais aussi la valeur réelle du droit international.
Mourad Benyahia

