
Lorsque, le 09 avril 1917, Henri-Robert Marcel Duchamp présentait, au Salon de la Society of İndependent Artists de New-York, un urinoir d’homme renversé dénommé Fontaine, il jetait ce jour-là dans l’espace scénique de la monstration rétinienne le gros pavé ébranlant les fondements perceptifs de l’expression du sensible, levait le rideau sur l’acte théâtral le plus subversif, déroutant et controversé de l’art moderne.
Bien que rejeté et retiré de l’exposition, car jugé d’emblée immoral et inapproprié, « l’appareil sanitaire » (sur la glaçure céramique blanche duquel des marques noires affichaient l’inscription « R. Mutt 1917 ») provoquait néanmoins un vote, instaurait par là-même chez l’une des instances de légitimation du goût l’intense perplexité de laquelle découleront les futures interrogations : « Qu’est-ce qu’une œuvre d’art, qui décide de son aura ? son auteur, les agents culturels, les conservateurs, les collectionneurs-acheteurs, les influenceurs argentés ou encore les historiens et critiques d’art ? »
Archétype de l’anticonformisme ou anti-vénération de l’œuvre, le plus célèbre des ready-mades (disparu du circuit puis remplacé par 17 copies réalisées et certifiées après 1964) soumettait une incertitude sur les normes en vigueur et les critères ou adjudications commerciales à entériner, contestait la doxa « Beaux-Arts » du courant mainstream et dépassait la production avant-gardiste qu’incarneront successivement les impressionnistes, fauves, postimpressionnistes, cubistes, surréalistes ou futuristes. Adoptée par les dadaïstes (pour lesquels le non-sens et l’irrationalité demeuraient le moteur de l’innovation), le fameux article du commun, impersonnel, « tout fait », déjà existant et prêt à l’emploi, incitait le regardeur à déchiffrer une intention, interprétation ou signification, lui disait en marge et substance que les visuels nés du travail manuel d’un peintre (adoubé ou non génie par les dénicheurs de la singularité ou rareté), n’étaient plus les seuls à pouvoir prétendre insuffler de la valeur et pertinence artistiques.
L’idée qu’une toile et sculpture ne soient plus à appréhender au titre de bien matériel né de la dextérité plastique d’un auteur, mais principalement en tant que concept ou affranchissement philosophique, n’étant à cette époque absolument pas audible ou admissible en Algérie, le geste anonyme et improbable de Marcel Duchamp provoqua une nette distance culturelle, voire une césure intellectuelle majeure (encore très prégnante aujourd’hui) entre les acteurs dissidents consacrés en France artistes-créateurs et ceux accaparés sur la rive sud de la Méditerranée à parfaire la vitrine acceptable de l’entreprise coloniale.
Sur ce terrain expérimental, la remise en cause de l’art et de ses définitions concernait uniquement l’anachronisme de chromos héliotropes prorogeant « (…) un orientalisme hors du temps » (Arsène Alexandre). Aussi, germera en zone barbaresque un néo ou post-orientalisme éprouvé dès 1907 chez les pensionnaires de la Villa Abd-el-Tif, une des trois institutions artistiques voulue par la France (au XVIII° siècle, la Villa Médicis à Rome et après la Première Guerre mondiale la Casa de Velasquez de Madrid). Élevé sur les flancs d’une colline dominant le Jardin d’essai (1832) et le prochain Musée national des Beaux-Arts (1930), cet ancien fort turc de style hispano-mauresque construit à la fin du XVIIIe siècle dans le quartier Mustapha supérieur fut la résidence secondaire de Sid Amoud Ben Abdeltif, un des dignitaires de la Régence d’Alger. Puis, délaissée par son négligeant propriétaire, elle servira en 1831 de cantonnement ou base de retrait aux convalescents de la Légion étrangère, cela avant que les Domaines se décident à la préempter sans pour autant lui confier de destination précise.
C’est donc une architecture à l’abandon que Victor Barrucand (antidreyfusard chroniqueur et propriétaire du journal Akhbar, l’un des premiers organes de presse en Algérie), Maxime Noiré (peintre pionnier établi en Algérie à partir des années 1890) et Arsène Alexandre (critique d’art) signaleront au Gouverneur de l’Algérie, Charles Jonnart. Celui-ci la rachètera au début du XXe siècle et financera à ses frais une restauration à laquelle participa le président de la Société des peintres orientalistes français (également directeur et conservateur du Musée du Luxembourg) Léonce Bénédite. Les deux parrains du Prix Abd-el- Tif soutiendront en 1906 (année de leur rencontre à l’Exposition coloniale de Marseille), le rapport « Réflexions sur les arts et les industries d’art en Algérie » que finalisait Arsène Alexandre. Le pourfendeur des vielles modélisations du harem (notamment de l’ancien et désuet orientalisme d’İngres) parlait en son sein d’une « (…) maison des artistes (qui) devrait exister à Alger, en dehors des musées (…). C’est la maison des Abb-el-Tif au-dessus du Jardin d’essai (…). Cette demeure (…) est placée de telle sorte que les plus bonnes leçons de la lumière et les plus belles richesses de la nature, s’y trouveraient en quelque sorte sous la maison des artistes qu’on y logerait, sa terrasse, sa colonnade, sa cour intérieure, encore décorée de brillantes céramiques, son entourage de luxuriante verdure en ferait un séjour enviable. La Maison des Abd-el-Tif (…) cette sorte de villa Médicis, ou Kunsterhaus d’Alger, deviendrait aussi célèbre qu’enviée ».
Sa concrétisation répondait et convenait justement aux aspirations d’un pouvoir colonial disposé à revivifier les représentations et impressions surannées de l’Orient. Pour rajeunir son image et rafraîchir aussi le cadre jauni de la présence française en Algérie, il fallait solliciter des artistes métropolitains, les convaincre à venir s’installer pour au moins deux années à Alger. Sélectionnés au concours par le jury de la Société des Peintres orientalistes français (fondée à Paris en 1893 dans le souci de soutenir le renouveau d’un orientaliste moderne), promus et chouchoutés, 87 boursiers (68 peintres et/ou graveurs, 18 sculpteurs et un architecte) y séjourneront de 1907 à 1962 (parfois quatre ans) sans aucune obligation de résultat vis-à-vis des tutelles culturelles et artistiques locales (le cahier des charges les contraignait uniquement à révéler leurs travaux lors de la monstration de la Société des peintres orientalistes ou bien au Salon des artistes français organisé pendant le Salon d’automne, aux Tuileries ou aux Beaux-Arts).
Non soumis à une réglementation stricte, libres de leurs mouvements et thématiques, ils réveilleront la vieille endormie, vagueront à leur guise sur les proches sentiers ou coteaux surplombant la baie d’Alger, fonctionneront en toute autonomie mais en relayant néanmoins les programmations officielles.
Ces assistés et protégés de l’administration auront, après dix mois d’hébergement, la permission de sillonner les régions les plus reculées ou désertiques du pays, emprunteront dès lors l’itinéraire évasif et intrépide de leurs prédécesseurs du XIXe mais s’écarteront des sentiers battus de l’héroïque ou épique art colonial. Ainsi, intégré au premier duo débarqué et accueilli chaque année, Paul Jouve (1878-1973), fils d’Auguste Jouve (médaillé d’or en 1899 lors de l’exposition universelle de Paris) s’éloignera très tôt de l’exotisme phantasmatique pour aller se perdre au milieu des dunes du Sahara (cela avant de configurer, en atelier, des sculptures animalières).
İl devançait les prochains lauréats Paul-Élie Dubois, Marius de Buzon, Charles Dufresne, André Hambourg, Jean Bouchaud, Marcel Damboise, Jean Launois. Charles Bigonet, Léon Cauvy, Charles Darrieux, Eugène Corneau et Maurice Bouviol (les quatre derniers peindront respectivement le jardin, les colonnades, la toiture et fontaine de la Villa).
Si quelques-uns bénéficieront de commandes de l’État, beaucoup livreront des études rehaussées de verts émeraudes et de bleus azurs, de rouges flamboyants et de mauves langoureux, égailleront leur palette de tons soutenus faisant vibrer la surface plane de tableaux que pasticheront de nombreux peintres algériens de la postindépendance.
Coupés du processus mental déclenché en écho à l’audace duchamptienne, et plus généralement du champ de l’art moderne français dans lequel se projetaient les mouvances de l’avant-garde transgressive, les « Abdeltifs » composaient le concrétude poético-lyrique d’une autre temporalité picturale qui conviendra à des ex-indigènes adeptes de toiles surchargées de diaprures outre-Méditerranée. Revisiter la tradition française de l’orientalisme débutée vers 1806 avec İngres (et prorogée par Delacroix, Fromentin et Chassériau), l’acclimater à de nouvelles forces esthétiques, vanter les ramifications d’un Orient véridique à faire connaître et apprécier, telle furent les réquisits de la feuille de route dévolue aux néo-peintres-voyageurs par Jean Alazard, le factotum invétéré de la Villa Abd-el-Tif.
Classée monument historique dès 1922, l’« (…) institution qui honore notre temps » maintiendra pendant plus de cinq décennies sa fonction initiale, celle de « former des élites d’artistes (capables de) se dépouiller des préférences antérieures afin d’aborder un travail nourri d’une réalité matérielle de la colonie » (Jean Alazard). Centrée sur les bienfaits civilisationnels de cette dernière, les institutions culturelles et artistiques retiendront les médiums d’individus censés régénérer un orientalisme endogène que couronnera annuellement le Grand prix artistique de l’Algérie. Cette contrée étant, de par la spécificité et diversité de ses paysages ou environnements, « (…) destinée à devenir pour les artistes un admirable répertoire de thèmes picturaux. » (Jean Alazard), les récipiendaires des atouts du « centre d’art vivant » diligenteront, via donc une version différenciée de l’orientalisme primaire, une identité artistique endogène dont le but avoué était d’accoutumer les Français de l’Hexagone aux velléités, prestigieuses et convenues, du Grand Empire. Puisqu’il s’agissait toujours de fondre le bel Orient indigène dans l’horizon progressiste de la France, les subventionnés « Abdeltifs » magnifieront la variété des nouveaux territoires à conquérir en s’alliant, pendant une soixantaine de jours, aux expéditionnaires des missions diplomatiques, scientifiques ou militaires.
Malgré l’achèvement (vers 1880) de la période dite de « Pacification » et de ses violences, ils continuaient à profiter de la protection d’officiers de haut rang qui avec l’aide des Affaires indigènes procuraient après le milieu du XIX° siècle des guides, logements ou ateliers de fortune aux artistes-voyageurs. L’un des premiers d’entre eux, Gustave Achille Guillaumet pu de la sorte accéder plus facilement à l’espace intime d’autochtones préservés du contact d’européen. En quête permanente d’ingénuités, il entreprendra, entre 1862 et 1884, une dizaine de séjours en Algérie, empruntera, du Tell au Sahara, les chemins de sa ruralité populaire et se fera ainsi l’observateur assidu de la domination coloniale, de spoliations et misères qu’il traduira en 1869 dans les toiles Le Labour (elle montre une femme, bébé sur le dos, conduisant péniblement un chameau attelé, soit la pauvreté de simples gens démunis et tentant de survivre) et La famine. De 1866 à 1868, la pénurie d’aliments décima un tiers d’Algériens tiraillés par la faim, touchés par une épidémie de typhus ou de choléra, rongés par les puces, aveuglés par les poussières que soulevait le chihili, vent chaud donnant soif alors que l’eau polluée ou infestée provoquait la chiasse. Visage emblématique de l’orientaliste- ethnographe, le peintre révolté et indigné extériorisait là une tragédie imputable à la sécheresse, à des méthodes agricoles fragiles et dépassées face aux intempéries, mais plus encore à la paupérisation générale de la paysannerie apparue suite à la confiscation des terres et aux razzias.
Appliquées à grande échelle depuis Bugeaud, ces expéditions punitives consistaient à piller jusqu’à la complète abdication des rebelles ; portées à un niveau de destruction supérieure, les laminages systématiques et dévastations stratégiques des bataillons français amplifieront de surcroît une catastrophe provoquée par l’absence de réserves de céréales et une hygiène publique sous-développée.
Exhibé au Salon de Juliette Adam, le tableau d’histoire interpellait le spectateur, l’incitait à s’éloigner de la vision aristocratique et à condamner le rêve du « royaume arabe » incorporateur, l’illusion d’un projet d’assimilation des peuples et des cultures. Seulement, envoyée à la face d’un exécutif persuadé que la Conquête était une entreprise émancipatrice, l’œuvre déplut aux amateurs et professionnels. La facture frontale de son exécution déroutera le public et une critique appréciant modérément une « trop grande soumission aux modèles romantiques ». Celles postérieures, Laghouat, Sahara algérien (1879), Laghouat (1879), La séguia, près de Biskra, Algérie (1884-85), La nativité de Bou Saâda, Tisseuses à Bou Saâda, L’Oued à Bou Saâda. Trois laveuses, Laveuses dans l’oued de Bou Saâda et Jeunes filles dans l’oued de Bou Saâda (1882-83) témoigneront quant à elles d’un attachement sincère envers des populations vivant en zones arides. Soucieux de rendre la vérité des biotopes et la quintessence de ses « poseuses », le domicilié du quartier de « La Nouvelle Athènes » (9ème arrondissement de Paris) se concentrera dès lors sur une peinture de genre captant, sans aucun artifice, misérabilisme ou voyeurisme, le profil humain d’oasiennes laborieuses, de fellahs dépossédés (au profit des colons) des meilleures parcelles, non consultés au sujet des projets de diversification du Sahara ou de l’intensification des itinérances touristiques. Spectateur des accomplissements de l’Algérie de peuplement, Guillaumet assumera de moins en moins ses constants allers et retours entre le désert saharien et les salons feutrés de la capitale où il s’éteindra le 14 mars 1887.
Érigé sur sa tombe du cimetière Montmartre, le monument funéraire (réalisé par Louis-Ernest Barrias) La Jeune fille de Bou Saâda rendra hommage à la noblesse prude d’adolescentes interdites de franchir les périmètres d’une steppe desséchée, d’un ksar de boues décomposées et à l’intérêt si limité que les autorités françaises le classeront « impropre à la colonisation ». Le peintre-photographe Georges Gasté s’y implantera néanmoins de 1894 à 1898, cela suite à ses rencontres avec Étienne Dinet et Léonce Bénédite. İl en fera le refuge de ses expériences artistiques, y concevra les toiles Jeune fille de Bou Saâda et Portrait de jeune femme de Bou Saâda puis les clichés lointains de silhouettes féminines, d’ombres voilées fuyant les terrasses, sortant d’un souk aux étales vides ou des ruines de la « Cité du malheur » que l’éden-mirage et enchanteur de Dinet maquilla en « Cité du bonheur ».
Pour dessiner sur le tas les portraits et ambiances du Grand Sud, les usages et comportements des natifs du Hoggar ou du M’Zab, les « Abdeltifs » fouleront également les ruelles ou venelles de Bou Saâda, comme du reste celles de Biskra, Ghardaïa, Laghouat, Ouargla ou Touggourt, atteindront les oasis de Tamanrasset et Timimoune, arpenteront les versants du Tassili n’Ajjer, côtoieront les nomades, Touaregs ou Ouled Naïl qu’Étienne Dinet habillera de robes aguicheuses et de chatoyants bijoux. Chez ces néo-ethnographes, la femme musulmane sera couramment montrée en train de marcher au milieu d’une rue, voire d’un marché, ou bien assise près d’une tente de sa tribu. Sujet de prédilection, les visages bruns burinés de soleil accentueront une espèce de primitivisme champêtre prisé par les collectionneurs colons ; ces afficionados défileront devant les cimaises des musées et galeries où s’exhiberont, pareillement de façon répétitive, les minarets éclairés, corps cachés ou caravansérails de l’Algérie orientalo-méditerranéenne. Convaincu que des vocations pouvaient parfaitement naître au contact de la nature environnante, Jean Alazard promulguait, dans la revue Art et décoration du mois de septembre 1923, des « Abdeltifs » en mesure de nous débarrasser « de l’Orient conventionnel (en) ne recherchant que la vérité des tons et des attitudes ».
Abandonnant les décors étoffés du pittoresque clinquant au profit de « l’âme des habitants », ils pencheront, selon les autres observateurs du moment, en faveur d’une objectivité plus dense qu’une chronique du numéro Beaux-Arts du 20 novembre 1930 synthétisera en « souci de sincérité et d’exactitude ».
Souvent accolés à la rhétorique humaniste de l’Empire français, ces deux vocables (sincérité et exactitude) connotaient d’une part l’interprétation vouée aux toiles d’Étienne Dinet et s’appliquaient d’autre part à la mission historico-symbolique dévolue aux architectes ou décorateurs du Palais des colonies. Lieu central et durable de l’Exposition coloniale internationale ouverte le 06 mai 1931 au Bois de Vincennes, d’une manifestation d’envergure destinée à prophétiser les bienfaits de l’impérialisme cocardier et à inciter les métropolitains à investir dans l’essor économico-civilisateur de la « Plus Grande France », l’actuel Musée national de l’Histoire de l’immigration (ex-Musée des arts d’Afrique et d’Océanie dont les collectionnions sont au Musée du quai Branly) matérialisait dès son inauguration (la première pierre fut posée en 1928, sous l’œil bienveillant du président Gaston Doumergue) le mémorial de l’impérialisme triomphant, rien de moins que la volonté manifeste d’exalter ou promouvoir la puissance technologique et l’influence territoriale d’une république voulue irréprochable. Jonction de divers styles, il témoigne d’ailleurs toujours de l’attrait cumulé pour l’exotisme et le rationalisme esthétiques des formes (soit l’héritage culturel occidental combiné à la monumentalité des temples antiques), du soin apporté par Albert Laprade et Léon Jaussely, les maîtres d’œuvre d’un éclectisme en rupture avec la tradition néo-classique que prônait encore dans les années trente l’École des Beaux-Arts de Paris. Confié au sculpteur Alfred- Auguste Janniot, le bas-relief de sa façade (une vaste parure de pierres) exhibe faune et flore exotiques, délivre un message didactique, idéologique et commémoratif immédiatement discernable. Rythmée par des allégories, cette longue circonvolution narrative illustre les richesses coloniales, les apports de l’Empire à la métropole, les produits de régions et ethnies soigneusement détaillées et arbore sur sa partie latérale gauche une liste de personnalités conquérantes.
À l’intérieur d’un bâtiment à vocation propagandiste (puisque divulguant des idéaux politico-protecteurs), la fresque de Ducos de la Haille relate d’une perspective évolutionniste (les missionnaires-colonisateurs apportent des valeurs civilisationnelles à des sauvages bénéficiant de leur allocentrisme), primitiviste (l’univers colonial est dépeint comme un olympe où les humains vivraient en harmonie avec la nature et les animaux, où les peuples ou races inférieures restés à l’aube de l’humanité, ou hors du continuum historique, évolueront au contact de philanthropes) et différentialiste. Situé en dehors de la modernité et à fortiori non perverti par elle, le « bon sauvage » privé des structurations de l’histoire avait à approuver la suzeraineté d’occidentaux disposés à admettre la variété des cultures mais dans le cadre communautaro-colonial d’une hiérarchisation des races.
C’était là, la pensée suprématiste du Maréchal Lyautey, principal organisateur de l’Exposition coloniale internationale, événement au sujet duquel Paul Reynaud, le ministre des Colonies, dira qu’il « aura atteint son but si (…) beaucoup de jeunes visiteurs sentent naître en eux la vocation des colonies ». Favorables à la consolidation d’une France universaliste, à ses possessions d’outre-mer et à leurs consécrations spécifiques, les populations hexagonales feuilletteront un « magnifique livre d’images ». Ayant l’impression de parcourir « le tour du monde en un jour », elles adhéreront aux vertueuses célébrations de l’expansion coloniale. Celle effective en Algérie profitait aux « Abdeltifs », artistes prêts à poursuivre les intrépidités de Gustave Achille Guillaumet et le périple d’Alphonse-Étienne Dinet, maître-conseiller qu’il était autrefois de bon ton d’aller voir pour saisir au plus près les véracités de son réalisme et savoir comment atteindre une notoriété sans forcément draguer la bonne société parisienne.
Après des études à l’École des Beaux-Arts de la capitale française (au sein de l’atelier de l’ornemaniste Pierre-Victor Galland) et une formation picturale accentuée grâce au cours que dispensaient à l’Académie Julian Adolphe William Bouguereau (représentant d’un académisme focalisé sur des sujets classiques, thèmes mythologiques et le corps féminin) et Tony Robert-Fleury (adepte de vastes compositions historiques, scènes de genre et portraits), le futur mentor de Mohamed Racim, passionné d’une Bretagne encore rudimentaire, exposa pour la première fois à l’âge de 21 ans au Salon des artistes français de 1882. Bénéficiaire d’une bourse l’autorisant à suivre en Algérie une équipe de naturalistes, il y découvrira en 1884 des peuplades sahariennes et, à travers elles, la culture Naili, ira quelques mois plus tard à Laghouat puis au M’zab afin de parfaire les tableaux Sur les terrasses de Laghouat et L’Oued M’Sila après l’orage. Dès 1887, l’amoureux du Grand sud béotien effectua cette fois une coupure de six mois de laquelle naîtra la production que retiendra le galeriste Georges Petit.
Également présent à l’exposition universelle de 1889, Dinet rejoindra les membres fondateurs (Puvis de Chavannes, Auguste Rodin, Ernest Meissonier, Charles Cottet et Charles Auguste Émile Durant) de la Société nationale des Beaux-Arts puis, en 1893, de la Société des peintres orientalistes français. À l’orée du XX° siècle, le désormais Chevalier de la Légion d’honneur (obtenue en 1896) agrémentait (en 1898) de 132 planches le livre Antar (le plus ancien récit épique de la littérature arabe précédant la prédication de l’İslam) de l’éditeur d’art Henri Piazza. Dès lors, il quittait plus longuement le milieu bourgeois dont il est issu, campait (vers 1900) à Biskra avant de s’installer au cœur de l’oasis de Bou Saâda. C’est là, en bordure du désert, que l’exilé parisien affinera son apprentissage de la langue arabe, engrangera une monacale relation avec les préceptes de l’İslam, se convertira à cette religion tout en composant, à l’écart des chamboulements plastiques de l’époque, les nus licencieux et litigieux de baigneuses échappées du quartier des Ouled Naïl, nom attribué à une coalition de plusieurs tribus occupant une région s’étendant de Laghouat à Bou Saâda. Les « Naïliates » ou grisettes (filles de joie), qui appartiennent à l’une de ses fractions, deviendront ses modèles d’inspiration.
Contrastant avec les femmes affublées du traditionnel « bouaouina » (drap blanc occultant entièrement le corps et ne laissant voir qu’un œil), ces nubiles ou « alouettes naïves » faisaient commerce de leurs atouts physiques et poseront dans le plus simple appareil.
Elles exerçaient une véritable attraction sur un peintre les représentant en train de rire aux éclats, à gorge déployée ou à pleines dents, de se trémousser auprès de prétendants, de marivauder, seins pointus et poitrine offerte, sous les rayons ardents d’un soleil radieux. Son érotisation débridée falsifiait le vécu tragique de péripatéticiennes sacrifiées à la consommation cadencée de la chair, les transposait au sein d’un paradis orgasmique, d’un décorum surnaturel planté de végétaux chlorophylliens, nourrissait une vision picturale idyllique teintée de roses bonbons, de pourpres et d’indigos. Comparées à des muses extatiques, les libertines à la tête couronnée d’or étaient pour la plupart atteintes de maladies vénériennes (puisque « consommées » par des soldats ou soulards sans retenues) et leur « Cité du bonheur » ressemblait davantage à « une vaste cour rectangulaire, sale et boueuse, close de grands murs (…) sans luxe, sans raffinement ». İl s’agissait en effet plutôt d’un « cloître primitif, d’une écurie et d’un caravansérail (…) où nul ne s’attarde, où rapidement on débat les prix, on conclut le marché, et d’où l’on s’éloigne les sens apaisés », écrivait en 1899 le maire d’Alger, Charles de Galland, à la suite de sa visite de la maison des « Filles de la douceur ». Vers la fin de la décennie 30, l’affluence touristique de Bou Saâda poussa à y introduire une danse nue vulgarisée par les excentricités du désinhibé Étienne Dinet.
Selon François Pouillon, directeur de recherches à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), il préparait, sur sa terrasse illuminée, des soirées « animées par des putains nues et des couples d’amoureux se livrant à des bacchanales dignes des Romains de la décadence ».
Quatre décennies plus tard, ce ne sont pas ses pratiques illicites et triviales, ses gonzesses débraillées se baignant lascivement au milieu de l’oued que retiendront les gestionnaires du « socialisme spécifique » mais des mises en scène exotico-passéistes en complet décalage avec les mouvements avant-gardistes, voire de pieuses iconographies revendiquées comme éminemment nationales puisque son auteur avait en son temps entrepris le pèlerinage à la Mecque.
Si des plénipotentiaires du culte musulman (imams ou le cheïkh de la zaouïa d’El Hamel) assisteront aux funérailles (préparés après le 24 décembre 1929, date du décès) du marginal Hadj Nasr-eddine (prénom signifiant en arabe victoire de la religion), le préfet d’Alger Pierre Bordes puis l’ex-gouverneur général de l’Algérie (1925-1927), et prochain ministre d’État, Maurice Violette, voudront le récupérer en signalant successivement que « La conversion musulmane de Dinet ne touchait en rien sa foi patriotique (…), le grand ami de l’islam demeurait un fils de la France.», tant il « n’avait rien eu à sacrifier de cette patrie française qui avait nourri et formé son génie ». Cette vertu démiurgique n’aurait par conséquent pour atavisme que la patrie de naissance à laquelle sera rendu le prosélyte. Demeuré le « Sawar roumi », le peintre français imbu de sensualités hédonistes, le célibataire endurci faussement imprégné de spiritualités religieuses, ne sera, en son temps, jamais vraiment accepté au titre de citoyen d’honneur. Si le Musée national de Bou Saâda porte aujourd’hui son nom, c’est probablement parce que seule sa conversion algéroise à l’İslam l’a maintenu à flot, la sauver d’une excommunication posthume entrevue par l’anthropologue François Pouillon qui dans son texte « Échange agonistique et marché des valeurs artistiques : situation de la peinture en Algérie » assertait que « L’Orientalisme devrait faire tôt ou tard l’objet d’une récusation radicale ».
Or, c’est au contraire sa recrudescence que subissent actuellement les créateurs algériens désirant inscrire leur production au sein du paysage international de l’art contemporain, une locution appréhendée de manière spécifique et anachronique en Algérie. İl nous faut donc désormais saisir les tenants de ce décrochage diachronique et temporel aux dommageables conséquences.
Délaissé par les collectionneurs de peintures modernes se détournant du classicisme romantique et de l’académisme rococo, les œuvres de l’adulé Dinet tombaient après 1930 dans les oubliettes de l’histoire de l’art français mais se retrouveront, après l’İndépendance algérienne, paradoxalement sur des timbres-poste. Cette curieuse mise en exergue, qui hausse l’orientaliste au stade de figure majeure du patrimoine et du patriotisme algériens, a d’abord pour corollaire un prétendu anticolonialisme dénonçant les injustices et dérives de l’administration coloniale, interventionnisme émis en faveur de combattants musulmans morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale et à inhumer conformément au rite islamique. Si le peintre de Bou Saâda dessinera par ailleurs les stèles de leurs carrés militaires et publiera, dans la foulée, la première biographie du prophète écrite en français (La vie de Mohammed, Prophète d’Allah), ses reproches à l’égard du système oppresseur ne stipulaient pas obligatoirement une ferme et systématique réprobation de la colonisation mais plutôt sa rectification progressive, cela de la même façon que Mikhaïl Gorbatchev souhaitait corriger de l’intérieur le communisme avec l’espérance tacite de le faire perdurer.
Laissant tout autant croire avoir rompu avec l’orientalisme conquérant (marqué par le traditionalisme du métier et l’effusion de charmes extra-occidentaux), le récupéré de l’heure cumulait, aux yeux des redresseurs d’une révolution dévoyée par Ben Bella, la légitimité révolutionnaire et religieuse, deux crédos primordiaux pour qu’une production de l’orientalisme tardif puisse personnifier l’image d’antan de l’Algérie, pour que plusieurs générations de jeunes peintres influencés par le discours ambiant sur la sauvegarde du patrimoine ancien s’attèlent à copier ou reproduire les chromos du « mélo-peintre des amours bédouines, dont l’espèce de réalisme-socialiste-du-rahat-loukoum va nous empoisonner nos cimaises pendant plusieurs décades », avertissait déjà en 1963 le poète Jean Sénac dans son article « La peinture Algérienne en hélicoptère » (publié dans la revue Atlas du vendredi 12 avril).
Considérant les disciples de Dinet tels des « (…) bâtards de l’Orient (qui) vont nous gaver de roses et d’oranges à en perdre les yeux », ou les « indécrottables pasticheurs » de trompe-l’œil en porte-à-faux avec l’art dit « D’investigation de soi » (celui en phase avec les traditions populaires), l’auteur de Le soleil sous les armes (1957), Matinale de mon peuple (1961), Aux héros purs (1962) et Citoyens de beauté (1967) n’avait de faveurs que pour les « (…) insurgés contre les séductions mensongères et le tape-à-l’œil ». İl trouvait chez eux des affinités avec les « (…) expressions de la peinture « parisienne » » qu’il avait eu le temps d’apprécier pendant un détour français de huit années (entre 1954 et 1962). Jugeant, en introduction à son essai « La peinture Algérienne en hélicoptère », que, résultant d’un brassage « (…) Africains, Carthaginois, Berbères, Romains, Arabes, Turcs, Français », le champ pictural algérien était doté de plusieurs tendances esthétiques, il préconisait aux peintres informels d’opérer un retour aux sources, tropisme via lequel les abstraits Abdelkader Guermaz, Abdellah Benanteur, Mohamed Khadda, Denis Martinez et Choukri Mesli trouveront les racines ou clefs de leur propre trajectoire artistique.
En quête d’origines immémoriales, la plupart suivront ses préconisations et exploiteront parallèlement la plongée archétypale que traçait, dans son opus phare Les Damnés de la terre, le psychanalyste Frantz Fanon. L’esprit irrigué de sources ontologiques et militantes, ils passeront aisément le cap d’une voute d’intelligibilité menant aux abysses immanentes du jaillissement porteur d’affirmation ou reconnaissance de soi (que souhaitaient ponctuer et moduler tous les créateurs nouvellement décolonisés) puis harponneront le wagon international de l’art moderne (le feront avant eux les pieds-noirs Maria Manton, et Louis Nallard) en fréquentant les autres peintres exilés de la seconde « École de Paris ». Venus également amplifier le cosmopolitisme de la capitale française, les graphistes de l’ « École du Signe ou du Noûn » intégraient cependant tardivement les partisans européens d’une abstraction jugée à la fin de la décennie 50 académique car dépassée par le néo-dadaïsme, l’İnternationale situationniste, Fluxus, l’art cinétique et luministe ou les Nouveaux réalistes.
Désaxant les catégories de peinture et sculpture, bousculant plus intensément encore les modes tactiles et perceptifs, ces mouvements de la dématérialisation de l’objet œuvre d’art n’avaient pas encore de correspondances ou leurs équivalents dans l’Algérie de l’avant et de l’après 1962, année de la rétrospective du Museum of Modern Art de New York, The Art of Assemblage. Les collages des cubistes et performances des futuristes étaient ringardisés par les infractions agissantes des néo-dadaïstes qui intronisaient un large éventail de styles, formes, pratiques, démarches mais surtout de matériaux et de techniques jusque-là jamais utilisés avec autant d’outrecuidances.
Au début des années soixante, des artistes américains associaient des objets (drapeaux avec Jaspers Johns) et des images en sérigraphie (Robert Rauschenberg) empruntées aux médias où à l’histoire de l’art.
Chez eux, la photographie prenait sa place de médium, révélait une diversité de ton, une banalité de l’urbain, un sens visuel de la culture-masse avec des bandes dessinées (Roy Lichtenstein), des processus de reproduction souvent vides d’émotions mais de grande précision car imitant la trame des techniques d’impression. Andy Warhol éprouvait le principe de la répétition pour relater d’une société occidentale de plus en plus inondée d’images. İl parlait en 1963 de son obsession pour celles montrant des catastrophes comme les accidents de la route, l’assassinat de Kennedy ou le suicide de Marilyn Monroe. Si les thèmes du Pop art ne reflétaient pas obligatoirement une dégénérescence de la notion de « Beaux-Arts » ou d’art pur, ne remettaient pas directement en péril les critères de la peinture-peinture, voire même de l’expressionnisme abstrait, les notions de happening, de minimalisme, de performance et d’installation ou les mouvements proches du Land Art et Body art dessillaient la vision historique défendu par l’américain Clement Greenberg. Pour l’influent critique d’art, les étapes successives allant de l’impressionnisme jusqu’à l’expressionnisme abstrait (en passant par le cubisme) pouvaient être envisagées comme une mutation interne propre aux qualités réflexives du modernisme pictural. Sa perspective formaliste prorogeait le jugement du « Beau » de Kant, préservait l’aspect « Beaux-Arts » et l’intérêt du Pop art pour les objets de la vie courante ou les matériaux de récupération en faisait une partie étendue du réalisme, terme servant à distinguer l’art figuratif et les différentes abstractions représentatives des années d’Après-guerre.
Pendant ce temps-là, les peintres algériens poursuivaient leurs interrogations personnelles et collectives d’identité ou de culture sous couvert d’un unanimisme collégial neutralisant les tensions entre opérateurs des différents styles. Sur le long terme, cela aura pour conséquence le gel du concept de rupture, l’impossibilité de dissocier, comme en Europe, le genre moderne et contemporain, ce dernier restant rattaché en Algérie à la pratique des « Beaux-Arts » et à des « qualités esthétiques » confondues avec les préciosités orientalistes.
Obnubilés par le besoin, pour ainsi dire frénétique et épidermique, de trouver les référents de leur plénitude esthétique, les figuratifs et abstraits algériens ignoreront les valeurs ajoutées des Nouveaux réalistes, groupe réunissant en mai 1960 à la galerie « Apollinaire » de Milan Raymond Hains, Jacques Villeglé, Jean Tinguely, François Dufrêne, Armand Fernandez (dit Arman) et Yves Klein. C’est dans l’appartement parisien de celui-ci que sera officialisé un collectif que ralliaient cinq mois plus tard, soit le 27 octobre 1960, Daniel Spoerri et Martial Raysse. Tous signaient avec le critique d’art Pierre Restany un manifeste assertant la mort de la peinture de chevalet. İntroduite en Algérie par des vulgarisateurs de guerre accompagnant les militaires français sur les champs de bataille de la Conquête coloniale, elle fut le dispositif légué aux musulmans désirant sortir de leur condition sociale ou du statut d’indigènes.
De Mohamed Racim à Bachir Yelles Chaouche, ceux prétendants en Algérie à la notoriété artistique vulgariseront des techniques classiques principalement transmises par les néo-orientalistes. Après Juillet 1962, le savoir-faire académico-réaliste mobilisait les figuratifs mais aussi des convertis idéologiques prêts à imager les slogans déterministes du « socialisme- spécifique », des mots d’ordre qu’ils enrichissaient sur de vastes fresques publiques plantées au bord des routes ou scellées sur les axes passants des villes.
Parmi les abstraits de l’ « École du Signe », seul Denis Martinez pouvait prétendre appartenir au genre contemporain, grâce notamment à la mise en tension d’éléments triviaux (planches, grillages, ficelles, tissus ou morceaux de roseaux visibles à l’arrière d’ossements) arrachés à leur prédestination première.
En bousculant de la sorte le concept « Beaux-Arts », le Blidéen reniait l’assimilation à une certaine praxis picturale, démystifiait les canons de la belle plastique rassurante. En 1966, une serpillère collait d’ailleurs à la toile À l’année prochaine si nous sommes vivants pour mieux dénoncer sa condition sociale ou situation financière du moment. Devenus aussi les syntagmes d’une épreuve existentielle et d’un enjeu mémoriel, des nasses apparaissaient avec Li Kanou, Li Rahou, Li Yakounou. Touchant aux résurgences tribales, participatives et cérémonielles, cette œuvre de 1967 détournait des éléments extérieurs et figurait cette année- là à la monstration (agencée le 17 mars au 07 avenue Pasteur à Alger) d’une communauté restreinte de poètes et peintres baptisée Aouchem (tatouage).
Leur volonté d’invoquer un art « d’investigation archétypale » sera aussi relayée par un manifeste arguant en prolégomènes que le tatouage « (…) est né il y a des millénaires, sur les parois d’une grotte du Tassili », que le fonds antédiluvien de l’Anastase produisait de la fluidité sémantique. Convoquant le pré-monde ou arrière-monde, la déclamation polémiste renvoyait aux ténèbres de l’ignorance, en quelque sorte à un univers laissé en jachère et qu’il s’agissait d’investir, c’est-à-dire de thésauriser de manière à composer une interprétation plus vaste et exponentielle du retour vers ou à l’ancêtre.
Seulement, si le manifeste Aouchémite (conçu au domicile de Choukri Mesli) soumettait un élargissement de l’affirmation ou reconnaisse de soi, une voie transversale de réciprocité de laquelle sortirait les flux polysémiques d’une mémoire vive, elle se focalisait au final sur des invasions culturelles (antérieures et successives) caractérisées comme profanations d’un « signe-tatouage » à sacraliser, reconduisait les vindictes d’une identité intégrale et sans partage, les réflexes du retranchement tribal et fœtal. Les intonations vindicatives et protectionnistes du document attestaient que l’art en Algérie n’était concevable que si son discours se déplaçait sur le territoire grammatical de l’anti-impérialisme ; comprise en tant que participation holistique, cette dimension éthico-révolutionnaire ou symbolico- humaniste inhibait la possibilité d’envelopper le « signe-tatouage » d’un substrat spirituel ou de l’élévation cosmique agissant au cœur d’une abstraction occidentale qui, surfant sur la vague japonisante de la fin du XIXe siècle, pu s’auréoler d’une mystique orientale. La proclamation des néo-Tatoueurs sollicitait de la pureté originelle et sacrificielle quand celle des Nouveaux réalistes (rédigée par Pierre Restany) déclarait d’autres « approches perceptives du réel » ou établissait « la passionnante aventure du réel perçu en soi » (Pierre Restany, in Manifeste des Nouveaux réalistes, 1960, Paris).
Opposés à une abstraction lyrique « À bout de souffle » ou narguant la volubilité de l’expressionnisme abstrait de Hans Hartung et Georges Mathieu (en vogue à la fin de la décennie 50), ses membres se positionneront en faveur d’un retour à la réalité mais sans virer vers une figuration de type soviétique. Réaffirmant être au centre de la création, avoir le privilège de prononcer comment et quand désigner un objet en tant qu’œuvre d’art, ils partageaient, à l’instar de Fluxus et des Situationnistes, la mentalité dadaïste, préconisaient l’utilisation de rebuts arrachés aux vécus de leur quotidien, prorogeaient de facto l’accaparement-détournement liminaire de Marcel Duchamp.
Du reste, l’auteur de Nu descendant un escalier N°2 (janvier 1912) avouera en 1966 au critique d’art Pierre Cabanne (échange que le journal Le Monde du 24 octobre 2005 rapporta via l’article de Philippe Dagen « L’archéologie du Nouveau Réalisme »,) qu’il pouvait fort bien passer pour le principal inspirateur de Tinguely, Spoerri, Raysse et Arman. Si le principe d’entassement, d’agrégat ou d’amoncellement rapprochera davantage ce dernier à Duchamp, son mode d’accumulation ne se contentera pas conscientiser un objet manufacturé.
En le dupliquant à outrance par le truchement d’assemblages, le Niçois dépassait largement le geste sismique de 1917. İl particularisait en cela une affiliation, rejetait concomitamment « la carence et la fatigue des peintures hédonistes et des peintures gestuelles » (extrait d’un texte d’Arman daté de juillet 1960 et que Philippe Dagen reprendra dans le périodique Le Monde précédemment cité) et soumettait l’intervention directe de l’artiste dans la finalisation de l’œuvre.
Plus que la simple version hexagonale du pop art américain, le Nouveau réalisme (que parachèveront ensuite César Baldaccini, dit César, Mimmo Rotella, Gérard Deschamps et Niki de Saint Phalle) gagna sa légitimité historique en s’enrôlant donc au sein des excentricités du dadaïsme (qu’il outrepassa avec l’exposition de mai 1961, 40° au-dessus de Dada) et de l’extensivité conceptuelle que Marcel Duchamp inculqua via ses ready-mades.
En « posant un regard neuf sur le monde et en rendant compte de la nouvelle société urbaine de consommation», il situe dès lors en France la naissance de l’art contemporain, genre à la diversification duquel ne participeront pas les peintres officiant en Algérie. Synonyme de savoir-faire, l’habileté manuelle y restait en effet la signature primordiale faisant admettre, à l’intérieur du champ culturel officiel, la présence de tel ou tel aspirant à la visibilité. Pour cela, il ne fallait surtout pas sortir des cadres idéologiques préétablis, mais au contraire se dissoudre de façon impersonnelle dans le moule d’une éthique de communauté, c’est-à-dire des sacro-saintes constantes nationales empêchant d’étiqueter sur le fronton de la création disruptive la singularité agissante de précurseurs capables d’inoculer de la plus-value esthétique dans le déjà-là de l’abstraction, voir au cœur du sillon envahissant de l’orientaliste tardif.
Le catalogue de l’exposition L’exotisme au quotidien (montée du 07 février au 05 avril 1987 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi) contient le chapitre « Un visage de l’exotisme au XX° siècle : du Musée des colonies au musée de la France d’Outre-Mer à Paris », chapitre dans lequel Catherine Bouché écrivait au sujet des néo-orientalistes que « Tous appartiennent à la tradition figurative et reste étrangers aux mouvements avant-gardistes qui se déchaînent en France à partir du début du siècle ». Leur dédain vis-à-vis des théories intellectuelles affectant les artistes algériens de la pré et postindépendance, ceux-ci prorogeront cette indifférence. İls le feront au départ en vertu d’un certain mimétisme pictural puis après 1962 au nom d’une intégrité identitaire à préserver ou à implémenter, de là donc cette dommageable double distanciation temporelle qui a constamment éloigné les acteurs locaux des grandes monstrations internationales de l’art moderne puis contemporain. Seuls ceux naturalisés français ou anglais (comme par exemple Zineb Sedira, Adel Abdessemed et Mohamed Bourouissa) à la suite d’une installation pérenne en Europe ont pu entrer dans le jeu et je séquencés de la notoriété parce que leur mode singulier de fabrication agrémente les champs de vision de l’art mondial.
Depuis maintenant plus de deux décennies, moment correspondant à la Concorde civile de l’année 2000, l’État algérien s’applique à intensifier la politique de patrimonialisation qu’impulsa dès sa prise de fonction le ministre de l’İnformation et de la Culture, Ahmed Taleb-İbrahimi (1970-1977). La taxinomie de ce néo-conservateur, fils adoptif de Bachir İbrahimi, cheikh réformiste proche d’Abdelhamid İbn Ben Badis et co- fondateur de l’Association des Oulémas musulmans algériens, mettait à l’époque en avant le miniaturiste Mohamed Racim (devenu son conseiller pour les affaires artistiques) et le post- orientaliste Étienne Dinet. İl faisait d’eux les chantres de la nation parce que le traditionalisme du premier et la conversion à l’islam du second assuraient un cachet notoirement national à la peinture algérienne.
François Pouillon a précédemment rappelé qu’en cataloguant Dinet « Père de la peinture algérienne», l’activité éditoriale de Taleb-İbrahimi infléchira pour plusieurs décennies les regards et accoutumances de néophytes emportés aujourd’hui dans une putative dynamique de légitimation patrimoniale destinée à consolider l’intégrité d’une Algérie homogénéifiée en vertu du latent anti-cosmopolitisme décrété en Juillet 1962.
Suspectée de contaminer l’Homme nouveau, la notion de brassage culturel, de diversité ou porosité ethnique, que répercutait l’Algérie du peuplement colonial, devait disparaître dans l’incubation identitaire d’une « algérité » ou « algérianité » minimale purifiée de toutes souillures externes. Ce diktat officiel laissait penser que les peintres de la « Plongée fanonienne » et/ou du contournement de l’exotisme folklorisant allaient logiquement être adoubés chefs de file de l’art algérien. Mais, accusés de véhiculer une modernité dégénérée, d’avoir transposé sur le sol ensanglanté de la patrie de l’Émir Abd el Kader les reliquats évanescents d’une picturalité ne parlant pas suffisamment à une société majoritairement analphabète, ils seront relégués au second plan, la place centrale revenant donc (hormis Mohamed Racim) d’abord à Étienne Dinet. Sa réhabilitation rassurait les orchestrateurs des slogans « Un seul héros le peuple » et « Non au culte de la personnalité », des signifiants maîtres conformes à l’éthique de communauté et à la réfutation du génie créateur défiant la morale politico-religieuse et modifiant de fond en comble les canons figuratifs et registres old schools du métier de peintre. Plus que l’illisibilité de l’abstraction lyrique ou expressionniste, c’est le processus mental de l’art contemporain, tel que celui-ci s’est constitué en Europe à l’encontre des doxas esthétiques, politiques et religieuses, qu’exécraient les gardiens du temple et du phantasme de l’Un. İls substitueront à son entendement et excentricités le corpus des convainquant indices de l’art national. Ces pièces à conviction que sont les toiles des peintres- voyageurs inversaient la charge de la preuve et accentuaient le faussé creusé au début du XX° siècle entre l’art déconcertant des avant-gardes et celui plus présentables des « Abdeltifs ». Repères tutélaires, les toiles caricaturales, pittoresques et hyper-kitschs d’Étienne Dinet répondaient aux critères de légitimation, objectivaient le recours à une espèce de passéisme de véracité, fournissaient le miroir stéréotypé de la réification collective. La réintégration ou réincorporation patrimoniale du peintre de Bou Saâda participe d’un retournement du stigmate, d’un recadrage iconique, d’une présence identificatoire focalisant la prise de conscience de soi sur des images d’Epinal, d’une ethnographie visuelle mobilisant une poignée d’initiés.
Parmi eux, le milliardaire Djillali Mehri dont la fièvre collectiviste commença en 1963 à Oran lorsqu’il vu, sur le mur du bureau d’un fonctionnaire FLN, une œuvre d’Étienne Dinet. İnstantanément épris par une toile réfléchissant de lointaines réminiscences, le nostalgique d’El-Oued, ville saharienne de ses descendants bédouins, reconnaitra alors en elle le monde de son enfance. Aussi, s’apprêtera-t-il à en acquérir d’autres auprès de pieds-noirs, galeristes et commissaires-priseurs. Ce collectionneur quasi monopolistique du peintre de Bou Saâda ouvrait, vers la fin de la décennie 80, au 30 rue de Lisbonne à Paris, l’espace baptisé « Étienne Dinet ». S’il envisageait de montrer sur les deux niveaux de 300M² le travail des artistes confirmés du monde arabe et les émergents d’Afrique du Nord, les médiums d’Abdellah Benanteur, Malek Lahoussine, Fouad Bellamine, Abderrahmane Ould Mohand et Fayçal Samra, d’offrir, sous les hospices du mécénat privé, le cadre convivial d’un centre d’accueil et de documentation (librairie et bibliothèque), le projet philanthropique tournera court et c’est la production de Maxime Noiré, Étienne Dinet, Eugène Deshayes, Antoine Gadan et Eugène Girardet qui occupera le plus souvent le lieu jusqu’à sa fermeture définitive. En 2003, des tableaux de la collection de Mehri seront accrochés chez Artcurial puis au Musée des Beaux- Arts de Nantes lors de la Saison culturelle L’Année de l’Algérie en France.
L’homme d’affaires contribuera au retour en vogue de la peinture orientaliste, à l’envolée de sa cote en salle des ventes (particulièrement de celles des pays du Golfe) et capitalisera sur le filon Étienne Dinet, figure de proue magnifié du 16 septembre 2023 au 14 janvier 2024 (monstration prolongée jusqu’au 15 septembre 2024) à l’İnstitut du monde arabe (İMA). Le catalogue de la rétrospective (la première depuis 1930) interrogeait, à travers 80 œuvres, une Passion algérienne, soit l’indulgence envers une sorte de gourou qui échappe « au reproche d’exotisme et au procès fait au regard colonial » parce qu’il « (…) peint des fragments de réalité (…), ne fantasme pas un orient qu’il n’a pas vu. Tout est vrai dans sa peinture. Le moindre détail, la moindre grimace, le moindre tissu, couleur, position, a été observé par lui ». Encensé et délaissé, revendiqué et rejeté, le principal pourvoyeur de l’identité visuelle de l’Algérie indépendante aurait très tôt ressenti l’urgence de mémoriser ce qui allait bientôt disparaître et, armé de cette bienveillante conviction, peindra « en ethnologue pour documenter et garder une trace de la beauté algérienne. Une beauté qu’il retrouve autant dans les corps dénudés, que dans les paysages ou les appels à la prière », assertait encore le commissaire Mario Choueiry. Selon lui, « perçu à Bou Saâda (…) comme un juste », l’inspirateur a accouché d’une iconographie à traduire comme « (…) trait d’union des mémoires (…), signe de paix et d’amour et d’intimité entre la France et l’Algérie », ajoutait au journal Arabnews un professeur d’histoire de l’art souhaitant le rapprochement de deux pays en pleine crise diplomatique. Depuis l’annonce, fin juillet 2024, d’un soutien de la France au plan d’autonomie marocain du Sahara occidental, l’Algérie a fait de l’ex- colonisateur le réceptacle de rancunes, rancœurs et animosités étalées au sein des tribunes et colonnes de la presse algérienne.
Les contentieux et tensions entre les deux pays bouillonnant de toutes parts, le journal L’Expression, rampe de lancement des hostilités du pouvoir algérien, parlait le 14 août 2025 du « rôle compromettant de l’İnstitut français en Algérie », d’agents d’influence avançant « masqués derrière des projets culturels, ciblant souvent les plus jeunes, parfois sortis de l’adolescence pour en faire des relais dociles », mettait en doute la mission pédagogique de l’institution en posant la question : « Centre culturels ou nids d’espions ? ». İl laissait de la sorte supposer que dans les couloirs « des instituts français se profilerait l’ombre de la DGSE
», rien de moins que les services secrets de l’Hexagone, qu’ils favoriseraient « la collecte de renseignements et la diffusion de fausse informations », des points de transmission fonctionnant parfois avec la complicité, tacite ou non, de « collabos algériens ».
İl s’agirait donc là de « jeunes sans repères (…) choisis pour leur naïveté et vulnérabilité » et auxquels on promettrait « un avenir radieux, un visa rapide, une carrière internationale », on ferait tellement croire que « l’herbe est plus forte ailleurs », qu’ils finiraient par « céder à la tentation, quitte à brader l’indépendance du pays du million et un demi-million de martyrs ». Le but de toutes ces manœuvres interlopes serait de soutirer des dociles recrutés « les informations transmises directement à Paris », de semer le trouble, de « porter atteinte à la cohésion nationale », de l’affaiblir car, encore « poussée par les nostalgiques d’une époque bien révolue », cette France dopée d’arrogances et de certitudes active malicieusement ses intérêts stratégiques, « rêve toujours d’influencer le destin de ses anciennes colonies (…), n’a pas renoncé à ses ambitions de domination, même lorsqu’elle se pare des atours séduisants de la coopération culturelle ». Derrière les conviviaux salamalecs et discours conciliants, s’affuterait le pernicieux mélange entre « coopération culturelle et infiltrations politiques », un savant calcul manipulateur cherchant à torpiller l’unité et la souveraineté nationales.
Saâdi-Leray Farid, sociologue de l’art et de la culture




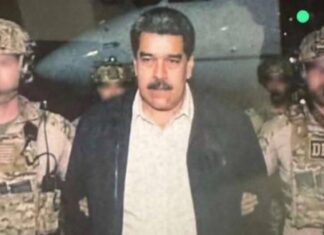





Le terme´Orient’ est une hérésie, une arnaque. Il montre combien, dans un pays des moins urbanisés de Méditerranée, la ville a phagocyté les campagnes.
La ville en Afrique du Nord est, en effet, à les attributs de l’Orient. Elle est gouvernée par un sultan, prie son dieu unique et confie les problèmes du monde et du quotidien, compliqués, à la providence via sa poste restante sur terre, le sultan. Le passage des Turcs n’a pas arrangé es choses: il a accentué le trait.
Or, il suffit de franchir les enceintes des rares villes du pays pour retrouver un monde organisé à l’ancienne, sur le mode citoyen, un occident oublié. Dans ces vastes territoires (habités par 90% des indigènes), il n’est pas impossible de trouver la religion anciennes dans toutes ses manifestations rythmer la vie paysanne.
En Occident européen la ville a connu pour des siècles le sort de sa vis à vis nord africaines. Mais eu la chance de sauvegarder une tradition écrite latine et la langue latine et même grecque. Elle a ainsi pu faire la jonction avec l’Occident, classique (pas géographique), via la Renaissance, mettant ainsi fin à la féodalité, à l’Orient au fond.
En Algérie coloniale, les manieurs de pinceau qui cherchaient Bagdad à Alger, éblouis par ailleurs par les lumières de la rive sud de la Méditerranée, ont simplement pris le dessus sur les archéologues, les anthropologues et les historiens. Les autorités coloniales (qui prenaient en charge les manieurs de pinceau aiguillés comme des girouettes vers l’est) s’accommodaient parfaitement du capitulard Abdelkader, des imams et zawiyards et des reliquats de la tukitude, ces symboles de l’Orient. Ces autorités non aucun intérêt à chercher, encore moins à promouvoir, ce qui anime les résistances à mort des campagnes: la citoyenneté, l’Occident, encore ancien; celui pour qui être vaincu signifiait tomber dans la servitude au sens propre du mot, à l’antique.
Alors les manieurs de pinceaux ont couvert de peinture orientale l’Occident ancien.