Boussad Berrichi est écrivain, universitaire et chercheur en littératures francophones comparées. Il a enseigné en Algérie, en France et au Canada, et poursuit une œuvre marquée par un fort engagement en faveur de la reconnaissance des cultures et littératures amazighes.
Il est notamment l’auteur de Amusnaw (Séguier, 2009), une biographie intellectuelle de Mouloud Mammeri, ainsi que de l’édition critique monumentale en deux volumes Mouloud Mammeri. Écrits et paroles (CNRPAH, 2008), aujourd’hui considérée comme une référence incontournable. À travers ces travaux, il s’attache à restituer la richesse, la complexité et l’actualité de la pensée mammerienne. Berrichi a également dirigé Tamazgha francophone au féminin, un ouvrage collectif consacré à l’expression littéraire des femmes amazighes.
Son parcours intellectuel transfrontalier témoigne d’un souci constant de transmission, de dialogue entre héritages culturels et linguistiques, et de mise en lumière des voix longtemps marginalisées par les récits dominants.
Dans cet entretien, Boussad Berrichi, figure majeure des études francophones et amazighes, revient sur les multiples dimensions de l’œuvre de Mouloud Mammeri, à laquelle il a consacré plusieurs années de recherches rigoureuses et passionnées. Entre biographie intellectuelle, édition critique et entreprise de réhabilitation, il s’attache à restituer toute la complexité d’un auteur encore trop souvent réduit à quelques clichés littéraires ou identitaires.
Titulaire d’un doctorat en littératures comparées francophones, Berrichi mène une carrière transnationale entre l’Algérie, la France et le Canada, où il enseigne aujourd’hui à l’Université d’Ottawa. Son parcours, à l’image de ses travaux, s’ancre dans un double héritage — universitaire et militant — et se nourrit d’une volonté constante de transmission. Son œuvre, exigeante et engagée, interroge les conditions de visibilité des voix minorées, les enjeux de mémoire postcoloniale, ainsi que la place des langues et cultures amazighes dans l’espace francophone.
Au fil de cet échange, il éclaire des aspects parfois méconnus de Mouloud Mammeri : son rôle discret mais actif pendant la guerre d’indépendance algérienne, son immense contribution à la formation d’une génération de chercheurs au sein du CNRPAH, son engagement pionnier pour l’enseignement du tamazight dès les années 1960, ainsi que ses travaux pour le théâtre et le cinéma.
Plus qu’un simple hommage, cet entretien propose une lecture critique, vivante et documentée de l’héritage mammerien, à travers le regard d’un intellectuel dont le travail participe activement à la préservation, à la diffusion et à la réactivation de ce patrimoine culturel et littéraire.
Le Matin d’Algérie : Vous avez consacré une part importante de votre œuvre à Mouloud Mammeri. Pourquoi cette figure vous semble-t-elle si centrale, voire indispensable, dans la mémoire littéraire et intellectuelle nord-africaine ?
Boussad Berrichi : Relire et enseigner les travaux de Mouloud Mammeri est indispensable pour transcender notre mémoire intellectuelle car tout peuple ou nation a besoin d’une mémoire intellectuelle, voire d’une mémoire collective. Ainsi, l’œuvre et la pensée de Mammeri font partie de cette mémoire qui est omniprésente.
L’œuvre romanesque de Mammeri couronne l’histoire de sa société avec ses aspects sociologiques, anthropologiques, culturels, linguistiques, etc. Ses romans retracent quatre périodes déterminantes, à savoir : La Colline Oubliée (écrit en 1939-40 et publié en 1952) montre une société sous le régime colonial dont la misère de la population est à fleur de peau. Cette misère produite par la colonisation est dénoncée dans les discours des habitants de Tasga et c’est cette génération qui connaîtra les massacres du 8 mai 1945.
Quant au deuxième roman, « Le Sommeil du Juste », c’est la transcendance d’une conscience nationale et l’évolution intellectuelle d’une certaine élite dans le processus de la décolonisation. Et L’Opium et le bâton, raconte la Guerre de libération sous un double regard : de l’intérieur et de l’extérieur. Aussi, le dévoilement des mécanismes de la colonisation et de la décolonisation.
Enfin, La Traversée, c’est l’après indépendance jusqu’à la fin des années 1970, entre espoir et désillusion. Au-delà de ces œuvres littéraires (romans, nouvelles, pièces de théâtres, etc.), ses travaux anthropologiques constituent l’âme et le souffle de sa société.
Aussi, ses travaux sur la langue tamazight incarnent les voix de sa société millénaire avec sa langue qui reste de nos jours l’une des plus vieilles langues, avec son écriture tifinagh, dans l’histoire de l’humanité.
Le Matin d’Algérie : Votre ouvrage Amusnaw propose une réhabilitation intellectuelle de Mammeri. En quoi cette « réhabilitation » était-elle nécessaire, et que révèle-t-elle sur la manière dont les intellectuels d’Afrique du Nord sont perçus dans les champs littéraire et académique francophones ?
Boussad Berrichi : L’ouvrage Mouloud Mammeri Amusnaw paru en 2009 est la base de mes années de recherche sur Mammeri dont les deux tomes Écrits et paroles publiés au CNRPAH d’Alger. Ainsi, la première mouture du manuscrit Amusnaw est une volumineuse biographie intellectuelle de Mammeri suivie d’une bibliographie de lui et sur son œuvre depuis 1917 à 2009. Or, en raison des contraintes de l’édition, j’ai dû publier une version plus courte du manuscrit qui est une sorte de guide pour les étudiants et les chercheurs dans les domaines des arts et des sciences sociales selon les normes de la recherche et de la rédaction universitaires. En effet, le livre participe à la réhabilitation d’un intellectuel de dimension internationale qu’est Mouloud Mammeri. À ce propos, il suffit de parcourir la bibliographie des travaux sur son œuvre à travers le monde et dans plusieurs langues pour en constater cette dimension transfrontalière de son œuvre et de sa pensée.
De plus, cette réhabilitation est une remise en cause de certaines lectures idéologiques sur son œuvre depuis le dénigrement de sa propre personne et de son roman La Colline oubliée par certains « partisans d’un nationalisme étroit » en 1953 par le biais d’un pseudo-journal tendancieux et médiocre du nom Le Jeune musulman. De plus, les articles en question eurent l’objectif d’imposer une autocensure à Mammeri quant à son amazighité voire sa kabylité. Or, depuis son premier article publié en 1938, Mouloud Mammeri n’a jamais trahi ses idées et ses engagements et resta fidèle, durant toute sa vie, à la fois aux voies et voix des ancêtres.
Certains de ses détracteurs reconnurent, tard dans leur vie, leurs « erreurs » sous les bouts des lèvres. Malheureusement, le mal qui a été fait depuis 1953 a eu des conséquences néfastes après 1962 jusqu’à récemment sur la réception des œuvres littéraires, mais pas uniquement.
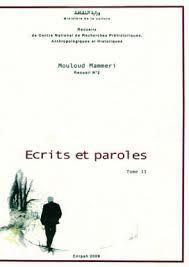
Le Matin d’Algérie : Vous avez travaillé à la collecte, à l’édition et à l’annotation de plus de 74 textes de Mammeri dans les deux volumes Écrits et paroles. Quelles ont été les principales difficultés – intellectuelles, matérielles ou politiques – rencontrées dans ce projet d’une telle ampleur ?
Boussad Berrichi : Les deux tomes Écrits et paroles s’inscrivent dans une série de projets pour recenser, collecter et annoter des documents de nombreux écrivain-e-s de la génération de Mammeri et la suivante. Ces deux tomes ont connu plusieurs étapes. En effet, la première étape est le recensement de toutes les références sur l’auteur, à savoir faire le dépouillement de milliers de fiches dans les bibliothèques, les centres de recherche et culturels, les universités.
Ensuite, l’étape de la collecte de tous les documents de l’auteur, sur son œuvre qui se trouvent dans plusieurs pays, dans les bibliothèques, les archives des radios et autres médias en général, ou chez les personnes qui ont connu ou interviewé Mammeri. En parallèle, j’ai interviewé plusieurs individus sur l’auteur et son œuvre. Avec toute cette riche documentation j’ai pu retracer la vie intellectuelle de Mammeri dont son rôle pendant les périodes charnières de sa société voire au-delà.
Enfin, le recueil Écrits et paroles regroupe des documents méconnus ou inédits (études scientifiques, articles, scénarii, interviews, entretien et entrevues radiophoniques, conférences…) de l’auteur dans différentes langues (kabyle-tamazight, français, allemand, anglais et espagnol) qui permettent un autre regard perspectif sur l’œuvre, la lucidité et le cheminement de la recherche permanente à laquelle s’est livré Mammeri durant toute sa vie et à travers lui sa société.
Le Matin d’Algérie : Comment percevez-vous aujourd’hui l’impact de Mammeri – et de votre propre travail autour de lui – sur les nouvelles générations d’écrivains, de chercheurs ou de militants culturels, notamment au sein de la diaspora amazighe ?
Boussad Berrichi : L’impact de la pensée et de l’œuvre de Mammeri est considérable. De nos jours encore en Afrique du Nord et à l’international, on évoque Mammeri par Da Lmulud, c’est-à-dire Grand-Frère respecté. Il incarne à la fois la lucidité, la sagesse, la droiture, voire taqvaylit tamazight pour Imazighen en général. Mes travaux s’inscrivent dans la pérennité de Tamusni de Da Lmulud et à travers lui, celle de toute la société dans un transvasement avec les autres. Ainsi, Mammeri reste une référence identitaire kabyle voire amazighe et il représente un symbole de l’Amusnaw par excellence.
Depuis des décennies, on parle de l’écriture Tamaamrit et non de caractères latins de tamazight car la transcription de tamazight avec l’adaptation des caractères dits latins a été stabilisée par Mouloud Mammeri avec ses divers travaux.
Cette dénomination de la transcription en Tamaamrit incarne grandement le poids et la place de Mammeri dans la conscience amazighe à travers l’Afrique du nord et à l’international. Ainsi, il est plus judicieux de parler de tamaamrit que de caractères latins pour tamazight. La transcription d’autres langues avec des caractères dits latins est mondiale et les dénominations de ces transcriptions sont multiples telle que celle du chinois appelée Pinyin.
Le Matin d’Algérie : Votre parcours est profondément transfrontalier : Algérie, France, Canada. Comment ces différents espaces influencent-ils votre approche critique de la littérature, et votre engagement pour les identités plurielles ?
Boussad Berrichi : Mon parcours sur les trois continents a cheminé vers une cosmogonie transculturelle, à savoir transfrontalière loin de la binarité étouffante. Mon expérience entre les deux rives de la Méditerranée m’a marqué à l’image de l’expression du poète-artiste Slimane Azem : « Mi d-nusa nevgha annughal, mi nughal nevgha ad nass » (Quand nous arrivons, nous voulons repartir, quand nous sommes repartis, nous voulons revenir). Et ce qui nous anime profondément, c’est tamurt imawlan. Tamurt, nous la chérissons, nous la portons, nous l’habitons même étant « canadianisé ». Également, tamurt nous habite car nous rêvons nous écrivons, nous dansons, nous chantons, etc., tout avec tamurt même à distance.
Ne dit-on pas en kabyle « nezdagh tamurt, tamurt tez-dghagh ». Encore aujourd’hui, je me rappelle comme si c’était hier, durant les vacances scolaires, je lisais des tas de livres (littérature, philosophie, histoire, etc.) sous un olivier ou un frêne, tout en surveillant une vache ou une chèvre et ses petits, sur les hauteurs du Djurdjura à plus de mille mètres d’altitudes. Ce n’est pas du tout de la nostalgie, mais plutôt la vie d’un jeune montagnard aux fins de la Kabylie qui se nourrissait, comme d’autres, de sa culture primaire vécue en même temps à l’écoute des autres par le biais des livres, mais pas seulement, dans une société attachée et jalouse de sa terre (pour paraphraser Frantz Fanon).
Ensuite, il y a lieu de conjuguer les deux rives de la Méditerranée, le Nord de l’Afrique et le Sud de l’Europe, à savoir l’Algérie et la France dont certaines similitudes sont frappantes. Deux systèmes politiques centralisateurs avec une dose de la pensée linéaire productrice de l’idéologie binaire. Ceci dit, il y a lieu de repenser ce qui est positif des deux côtés de la Méditerranée car étant au Canada, il y a plus de recul et de distance vis-à-vis de certaines questions socio-politiques-économiques afin de saisir la nuance et faire une critique plus objective possible et préconiser des approches plus inclusives et humaines notamment dans le domaine de la culture spécifiquement la littérature.
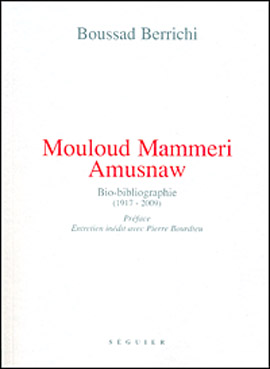
Enfin, le Canada. Un « pays-continent » avec un « climat exigeant » notamment dans le Grand Nord ou Nuna (comme disent les Inuit). Son système décentralisé avec l’autonomie de ces dix provinces et trois territoires incarne le creuset de son dynamisme dans plusieurs domaines notamment celui des Universités et de la recherche scientifique.
De nombreux éléments de ce système canadien viennent de certains savoirs autochtones ce qui explique l’enracinement d’une certaine cosmogonie canadienne. De plus, cette décentralité des pouvoirs y compris celles des Universités (qui dépendent des provinces et non de l’État fédéral) alimente une synergie de la diversité et une certaine sérénité productrice de sens.
Au-delà de mes expériences passées en Algérie et en France, qui sont globalement fructueuses sur certains points, le milieu universitaire qui me convient le mieux comme professeur depuis plusieurs années est celui à l’Université d’Ottawa (UOttawa). À ce propos, l’Université d’Ottawa est située dans la capitale fédérale et c’est la plus grande université bilingue au monde. Et chaque année, elle attire des milliers d’étudiants canadiens et internationaux de toutes les origines car ses programmes sont très demandés et répondent aux exigences et complexités du monde actuel. De plus, c’est une université où l’enseignement et la recherche se conjuguent au pluriel ce qui fait son dynamisme dans la pluralité. Comme l’UOttawa est interdisciplinaire avec ses diverses facultés, je saisi cette opportunité de connexion interdisciplinaire afin d’élargir mes champs d’enseignement et de recherche en arts, éducations et sciences sociales à la lumière des études comparées.
À travers les acquis pédagogiques pluridisciplinaires et les expériences de terrain dans les trois continents, il y a lieu d’offrir à nos étudiant(e)s des occasions de s’ouvrir à la diversité qui peuple le monde. Aussi, les introduire à la richesse cosmopolitique par laquelle les champs d’études littéraires, éducatives, historiques, politiques, anthropologiques, etc., participent à l’histoire de l’humanité. Enfin, il y a lieu de partager le résultat des recherches à travers colloques et congrès nationaux et internationaux et de nouer des collaborations entre collègues et universités des quatre coins de la planète pour cheminer vers un humanisme des savoirs critiques.
Si tout ça c’est un engagement pour des identités plurielles, alors on ne peut que l’assumer.
Le Matin d’Algérie : Vous avez également mis en lumière des voix féminines amazighes et francophones, comme dans Tamazgha francophone au féminin. Quels sont, selon vous, les apports spécifiques des femmes à la construction d’une mémoire littéraire décoloniale ?
Boussad Berrichi : Le collectif Tamazgha – Afrique du nord – francophone au féminin est le fruit des Actes augmentés d’une séance dans le cadre du Colloque International organisé par le CELAT (Centre interuniversitaire d’Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions) de l’Université Laval. Cet ouvrage collectif – que j’ai initié et dirigé ensuite publié – réunis les travaux de dix-huit universitaires femmes de plusieurs pays (Algérie, Allemagne, Canada, France, Maroc, Nouvelle Calédonie, Tunisie) dans plusieurs disciplines (anthropologie, ethnologie, histoire, linguistique, littérature et poésie). Les travaux abordent plusieurs sujets et thématiques d’hier et d’aujourd’hui. Pourquoi au féminin ? Parce qu’il y a des « perspectives au féminin » non exploré en profondeur dans le champ de la recherche en arts et en sciences sociales. Les textes dans ce collectif constituent de nouvelles approches sur la pluralité de l’Afrique du nord au niveau historique, littéraire, anthropologique, linguistique, etc.
De nombreux travaux collectifs ont été publiés dans le passé sous une vision linéaire et le cloisonnement des approches alors qu’il y a lieu d’étudier les littératures voire les arts sous diverses approches et c’est ce que le collectif Tamazgha a tenté de préconiser.
Le Matin d’Algérie : On connaît Mouloud Mammeri écrivain et intellectuel, mais beaucoup moins son rôle pendant la guerre d’indépendance. Que peut-on dire de son engagement durant la guerre de 1954-1962, et comment cela se reflète-t-il dans ses écrits clandestins ?
Boussad Berrichi : Mammeri a été, avant l’heure, un militant de la décolonisation, d’abord à Paris en tant qu’étudiant au Lycée Louis-le-Grand et à la Sorbonne. Durant ces années d’études, il rédigea les communiqués de l’union des étudiants nord-africains à Paris qui lutta pour l’indépendance des peuples colonisés d’Afrique notamment d’Afrique du nord. E
n 1956, Mammeri fonda, avec certains de ses amis, L’Espoir Algérie, journal anti-colonial qui porta en sous-titre « Expression des libéraux d’Algérie » et signa les éditoriaux sous le pseudonyme Brahim Bouakkaz. Ensuite, sous un autre pseudonyme, Kaddour en 1957, il rédigea un volumineux Rapport pour la délégation du FLN à l’ONU sur les tortures, les exactions et les viols perpétrées par l’armée coloniale. De son vivant, Mammeri refusa d’évoquer son passé durant la Guerre sauf dans l’entretien avec Tahar Djaout de 1987 car il considéra son engagement et son nationalisme comme un devoir.
À ce propos, lors d’une interview à Alger, M’hamed Yazid (représentant du FLN à l’ONU durant les années 1950), me relata et me confirma avec précisions le rôle déterminant du Rapport de Mammeri aux sessions de l’ONU.
De même, dans son livre Si Smail (1981), Tahar Oussedik raconta les détails en ces termes « Chargé de rédiger un rapport relatant les exactions de l’armée française, Si Bouakkaz recueillit, tout d’abord, la presque totalité des tracts distribués par les autorités d’occupation. Puis il s’attacha à sa rédaction et, lorsqu’il l’eut achevé, les divers feuillets furent répartis dans les enveloppes […] Le transport de ce courrier destiné à l’ONU fut assuré par Si Smaïl et Makhlouf Mammeri qui exerça alors la fonction d’inspecteur de la sûreté. »
Son engagement durant la Guerre a été sans faille, avec la rédaction du Rapport pour les sessions de l’ONU, son implication dans le journal L’Espoir Algérie et son action durant la bataille d’Alger dont il composa une pièce de théâtre Le Fœhn mais contraint de détruire son manuscrit, mais aussi il cacha chez lui à Alger des militants et combattant-e-s nationalistes. Ainsi, pour toutes ces raisons, voire d’autres, Mammeri est traqué et menacé de mort par les parachutistes de Bigeard.
Lors de la traque, Mammeri se cacha quelques jours chez un Français à Alger, ensuite se réfugia au Maroc mais continua son militantisme notamment la finalisation du Rapport pour l’ONU. À ce propos, les médias de l’époque rapportèrent la traque de Mammeri par les sanguinaires de Bigeard dont Franc-Tireur (6 avril 1957) titra « L’écrivain Mouloud Mammeri (sic) aurait été arrêté à Alger le 15 avril.», de même France-Soir publia la dépêche « On est toujours sans nouvelles de l’écrivain algérien Mouloud Mammeri… » et le journal Les lettres françaises (du 18 au 24 avril 1957) s’interrogea « Mais que signifie la recherche, par les parachutistes, à son domicile algérien, d’un écrivain qu’on déclare officiellement se trouver au Maroc ? ».
Enfin, il y a lieu de re-lire le dossier « Mouloud Mammeri dans la guerre de libération » dans le tome 1 de Écrits et paroles (éditions CNRPAH, Alger, 2008) mais son roman L’Opium et le bâton pour mesurer le rôle crucial de Mammeri et ses semblables durant cette guerre effroyable.
Le Matin d’Algérie : Entre 1969 et 1979, Mammeri a dirigé le CNRPAH à Alger, formant une véritable école de chercheurs. En quoi ce travail institutionnel a-t-il été déterminant pour les études amazighes et plus largement pour la recherche en sciences humaines en Algérie ?
Boussad Berrichi : Tout à fait, Mouloud Mammeri dirigea le CRAPE (Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques, devenu CNRPAH) à Alger de 1969 à 1979 et plusieurs travaux de recherches en sciences humaines et sociales ainsi que des périodiques scientifiques, Libyca et Bulletin intérieur du CRAPE au sein du même centre.
Lors de la prise de la direction du Centre, plusieurs problèmes s’imposèrent dont le manque de chercheurs et l’absence d’une orientation à donner à un centre de recherche pluridisciplinaire. Ainsi, la tâche fut titanesque. Or, en très peu de temps, Mammeri releva les défis par un plan novateur, à savoir former une nouvelle génération de chercheurs et initier de nouvelles approches scientifiques notamment l’anthropologie et l’ethnologie car de nombreuses questions épistémologiques s’imposèrent.
La situation fut la suivante : aux indépendances des années 1960, il y eu dénonciation de l’instrumentalisation de l’anthropologie par le colonialisme et remise en cause de l’anthropologue par les régimes politiques des États nouvellement nés des indépendances.
Ainsi, une interrogation s’imposa : Que se passe-t-il lorsque des Africains, par exemple, entreprennent d’étudier leur propre société et/ou leur propre culture? De plus, l’anthropologue africain, qui n’eut pas déconstruit la question épistémologique, se regarda lui-même avec les yeux des autres, se faisant, le plus naturellement, le chantre de sa propre différence. Donc, son analyse sur sa culture se présenta doublement problématique : exotique (voire du chauvinisme) ou réductrice.
Et durant les années 1960-70 en Afrique, la recherche en anthropologie (en particulier) connut une évolution comme suit : la remise en cause de l’épistémologie avec l’ethnologie évolutionniste qui fut instrumentalisée durant la nuit coloniale; l’émergence de nouvelles approches anthropologiques qui s’opposèrent à l’uniformisation culturelle qu’impliqua la mondialisation en montrant la diversité et la richesse des cultures et des langues africaines.
Quelques anthropologues africains incarnèrent cette nouvelle anthropologie parmi eux, citons Mouloud Mammeri, Amadou Hampaté Ba, Cheikh Anta Diop, et bien d’autres. Avec leurs travaux novateurs, ces anthropologues africains inaugurèrent « l’anthropologie pratique ».
À ce propos, dans son étude (publiée dans Awal, n.5), Mammeri exposa les soucis méthodologiques suivants : de nombreux travaux d’anthropologues « étrangers » sur les sociétés colonisées, d’avant les indépendances, furent des regards majoritairement extérieurs voir incomplets parfois exotiques ou réducteurs. Et pour les anthropologues africains, un double risque de la partialité se présenta comme suit : une discipline (telle que l’anthropologie) dont ils sont à la fois juges et parties, ajoutant leur familiarité avec les données dont ils sont issus ainsi que de leur culture.
Aussi, la non-reconnaissance de l’anthropologie (surtout de l’ethnologie) par les régimes post-indépendance : condamnation éthique de l’anthropologie comme science coloniale. De plus, la science fut perçue comme danger scientifique et cette idéologie politique sur l’orientation scientifique des universités entrava durablement la recherche. Malgré toutes les embuches, Mammeri orienta le CRAPE sur une voie prometteuse voire futuriste dont il préconisa de faire de l’anthropologie à la fois « une science et un instrument de libération » (je paraphrase Mammeri). Ainsi, c’est sur cette base qu’il forma une génération de chercheurs en anthropologie, voire en sciences sociales et humaines, en leur créant un cadre et un lieu adéquat à la recherche par excellence dans ce haut lieu de la recherche de dimension internationale que fut le CRAPE sous sa direction. Des bourses de recherches, des publications soutenues et de qualité, des expéditions sur le terrain, l’encouragement et l’encadrement de jeunes chercheurs propulsèrent les savoirs et les connaissances Bref, Mammeri fut la cheville ouvrière de toute une génération, donc le pionnier de l’anthropologie pratique.
Le Matin d’Algérie : Dès les années 1960, Mouloud Mammeri a commencé à enseigner le tamazight à Alger, dans un contexte où cette langue était encore largement marginalisée. En quoi cette initiative précoce a-t-elle marqué l’histoire de la transmission de tamazight, et quel en a été l’impact sur la formation d’une génération de spécialistes et militants de la langue amazighe ?
Boussad Berrichi : L’apport de Mammeri est considérable quant aux bases de tamazight. De nos jours, on parle de Tamaamrit, donc c’est tout une école.
Il y a lieu de rappeler que durant les années 1950, Mammeri demanda, à plusieurs reprises, à enseigner tamazight au lycée de Ben Aknoun et les autorités lui refusèrent alors que dans le même lycée à Alger et, dans d’autres écoles d’Algérie de l’époque, l’arabe était enseigné officiellement et régulièrement.
De plus, à la même période, Mammeri demanda à enseigner tamazight à la Faculté d’Alger, il essuya plusieurs refus.
Après son retour d’exil à l’automne 1962, Mouloud Mammeri devint professeur d’ethnographie à l’université d’Alger et enseigna tamazight (un cours informel), bien qu’aucun texte officiel n’autorisât ce cours et qu’aucun texte ne l’interdît, « on » y mit cependant fin en 1973.
De plus, son cours attira de plus en plus d’étudiants dans un immense amphithéâtre. Certains de ces étudiants devinrent plus tard des chercheurs, militants, écrivains, politiques, etc., et formèrent à leur tour d’autres générations d’enseignants de tamazight mais aussi dans d’autres domaines.
Suite à l’interdiction de son cours en 1973, Mammeri s’adressa, plusieurs fois, au ministère et n’eut aucune réponse. L’exclusion de ce cours de tamazight marqua durablement Mammeri, mais il ne cessa de revendiquer, par ses écrits et ses conférences, tamazight langue nationale et officielle et langue d’État pour son pays et ceux de l’Afrique du nord. Pour lui, la pérennité de tamazight passe par la généralisation de son enseignement dans toutes les écoles et les institutions de l’État.
Malgré l’interdiction de son cours dans son propre pays, Mammeri s’attela avec abnégation et conviction dans la préservation et le développement de tamazight. Ainsi, par son travail minutieux et son érudition, dès 1967, il publia Précis de grammaire berbère (kabyle), suivi de Lexique français-touareg, dialecte de l’Ahaggar (avec Jean Marie Cortade). Et, en 1973, avec certains de ses étudiants et collaborateurs, il édita Amawal : Tamaziγt-Tafransist, Tafransist-Tamaziγt – Lexique berbère-français, français-berbère. Enfin, en 1976, il élabora un manuel de grammaire tamazight sous le titre Tajerrumt n Tmaziγt (Tantala taqbaylit) qui décrocha le prix de la typographie.
Ainsi, toute sa vie durant, Mammeri milita avec lucidité pour la sauvegarde, la promotion, le développement et la transmission de tamazight, par son enseignement, ses publications, ses conférences, sa formation de chercheurs. Aujourd’hui, quand on parle de son œuvre et de sa pensée on dit « Da Lmulud », terme de respect et d’affection pour un Amusnaw.
Le Matin d’Algérie : Mammeri était aussi scénariste, dramaturge et anthropologue. Comment ces différentes facettes – parfois négligées – enrichissent-elles notre compréhension de son œuvre globale et de son approche de l’amazighité ?
Boussad Berrichi : Il y a chez Mammeri une autre activité peu connue et c’est celle de l’écriture de scénarii. Il est, en effet, l’auteur de six scénarii dont Le village incendié (1963), premier long métrage qui relate la destruction par l’armée coloniale d’un village en Kabylie pendant la Guerre d’indépendance 1954-62. Il a également écrit des textes pour d’autres films : L’Aube des damnés (1965) qui s’inscrit dans les approches postcoloniales genre cinéma documentaire ; Morte la longue nuit (1979) fait le constat sur la situation de certains peuples dans l’histoire humaine depuis les fausses découvertes des Amériques jusqu’aux années 1970 et la dialectique des puissances durant la guerre froide.
Par ces scénarii, Mouloud Mammeri déconstruit le revisionnisme historique que prônent certains groupes voire mouvements ou régimes politiques dans leur discours trompeur et colonial. Enfin, La dernière caravane est un scenario inédit écrit par Mammeri qu’allait porter à l’écran par l’infatigable Abderrahmane Bouguermouh, éminent réalisateur du film Tawrirt Ittwattun (La Colline oubliée). Il y a aussi d’autres scénarii inédits dont l’un sur Si Mohand Ou-Mhand.
À rappeler aussi, que Mammeri est auteur de plusieurs nouvelles et pièces de théâtres. À ce propos, il a écrit Le Fœhn (dont la première mouture a été détruite durant la bataille d’Alger en 1957) et a repris son écriture après 1962 et a été jouée au TNA en 1967. Également, auteur de Le Banquet, suivi de La mort absurde des Aztèques, une pièce de théâtre assortie d’un essai philosophico-historique – qui est à la fois la dénonciation des crimes contre l’humanité du passé et la mise en garde de leurs reproductions au présent et dans le futur. Dans son texte, Mammeri a déconstruit la « fausse découverte » des Amériques.
Et il consacra plusieurs travaux anthropologiques depuis son premier essai sur la « Société berbère », publié dans la revue Aguedal en 1938-39, jusqu’à son dernier livre Inna yas Cix Muhend (Les Dits de Cheikh Mohend). Ainsi, il publia plusieurs essais qui font autorité à l’heure actuelle en « anthropologie pratique » dont ses études sur « L’évolution de la poésie kabyle » (Revue Africaine, 1950), Les Isefra, poèmes de Si Mohand ou M’hand (1969) ; Poèmes kabyles anciens (1980) ; L’Ahellil du Gourara (1985). Par ses travaux, Mammeri fut fermement convaincu que « l’âme d’un peuple peut s’exprimer dans la musique et le chant, dans la pierre ou les mythes. Celle des Kabyles a choisi le Verbe. La parole – Awal a valeur fondamentale. Et le poème dit à valeur imminente » (Mammeri). A ce propos, en 1985, il fonda le CERAM (centre de recherche amazigh) à Paris faute de pouvoir le faire dans son pays natal. Avec le CERAM, il créa Awal (Cahiers d’études berbères) revue scientifique internationale à l’image de Libyca qu’il dirigea au CRAPE devenue une revue de référence internationale en sciences humaines et sociales.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Boussad Berrichi : Avec mon activité d’enseignant à l’Université, certains manuscrits souffrent dans le tiroir faute de temps, mais ils feront objet de publication. Parmi ces projets, il y a ceux sur certains écrivain-e-s et intellectiel-le-s dont le pédagogue-écrivain humaniste Mouloud Feraoun et Mohand Arkoun. Donc, les deux manuscrits, celui de/sur Feraoun et sur Arkoun ainsi que Mouloud Mammeri Amusnaw (revu et augmenté) seront proposés pour publication cette année ou en 2026.
En ce moment, je suis sur la finalisation de deux essais interdisciplinaires concernant le Canada à la fois sur les Autochtones et le Canada dans sa mondialité et sa place dans le monde. Les deux essais couronnent mes années d’enseignement universitaires sur le Canada.
Ensuite, d’autres projets feront objet de publication tels que les documents oraux collectés durant les années 1990. Ces documents de l’oralitude (poésie, devinette, contes, légendes, etc.) datent des étés de cette période quand je sillonnais, avec mon petit enregistreur audio et mon carnet de notes, certains villages du Djurdjura et de l’Akfadou pour collecter des textes oraux chez des personnes âgées avant que la mort ne les happe.
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Boussad Berrichi : À la fin de mes cours, je dis souvent à mes étudiants « Pour ne pas conclure » car il n’y aura pas jamais de conclusion ni de dernier mot (rire). À ce propos, je cite Mammeri : « Si les mots n’étaient que ce qu’ils veulent dire, ce serait la fin de toute littérature ».
Entretien réalisé par Brahim Saci


Merci, pour un STEAK non-merite’. Je vais donc me reposer un peu de mes provocations languagieres – a la recherche de reactions(jus) dans les divers sujets traite’s sur LMA. On peut dire que Dda Lmulud a vecu.
Non… pas vraiment. Une petite pour Boussad:
En souvenir a la citation suivante, la prochaine fois que je serai en France, je leur servirai leur salam de france, a gogo. Quels araw lahram-de-france ces frog-cafards!(excuse my french).
« Il y a lieu de rappeler que durant les années 1950, Mammeri demanda, à plusieurs reprises, à enseigner tamazight au lycée de Ben Aknoun et les autorités lui refusèrent alors que dans le même lycée à Alger et, dans d’autres écoles d’Algérie de l’époque, l’arabe était enseigné officiellement et régulièrement.«
La recherche et travaux universitaires sont indispensables. La diffusion-vulgarisation, c’est ce qui manque le plus aujourd’hui normal et depuis la disparition de la paysannerie.
Le défi est d’autant plus gigantesque l’école joue bien son rôle de destructeur de masse de notre patrimoine et identité.
Tanemirt ihi i mas Berrichi akk d Brahim Saci n weghmis n Matin