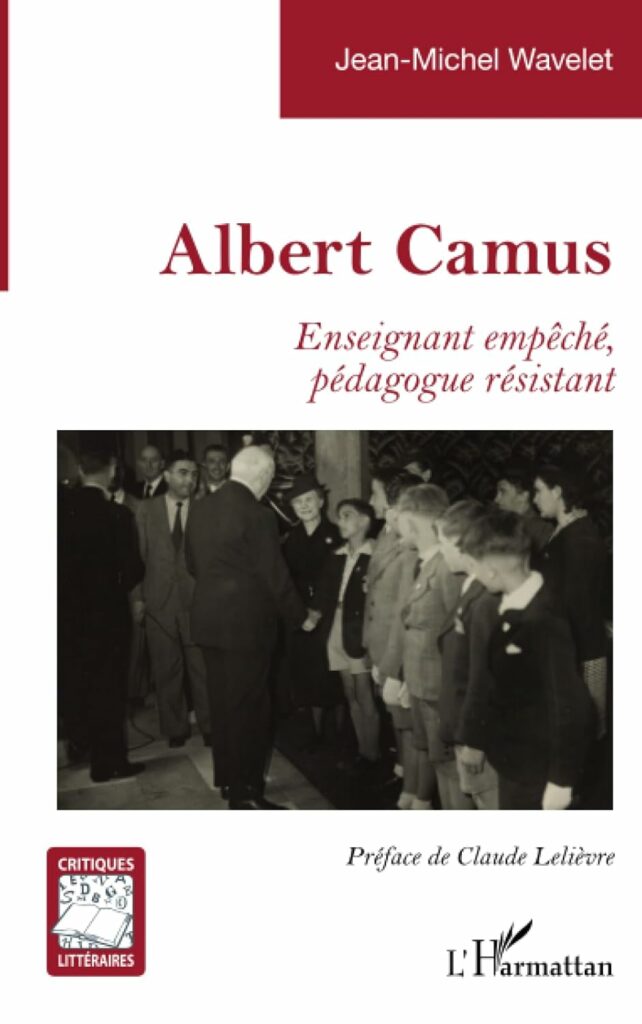Au-delà de l’écrivain, le pédagogue. Le travail de Jean-Michel Wavelet dans son essai « Albert Camus : Enseignant empêché, pédagogue résistant » lève le voile sur une dimension longtemps ignorée de l’œuvre et de la vie du Prix Nobel : sa pensée éducative.
En dévoilant la « blessure secrète » de Camus, son exclusion de l’enseignement pour cause de maladie, l’ouvrage démontre de manière percutante comment cet empêchement a paradoxalement catalysé une réflexion humaniste et critique sur l’école, faisant de l’auteur de L’Étranger un « pédagogue résistant » dont le message sur les valeurs et la justice résonne puissamment dans la crise éducative contemporaine.
Le livre de Jean-Michel Wavelet, « Albert Camus : Enseignant empêché, pédagogue résistant », publié aux éditions L’Harmattan, s’impose comme une contribution essentielle et opportune aux études camusiennes en s’attaquant à un angle mort de la critique : le rapport intime et complexe de l’auteur de La Peste à l’éducation et à la pédagogie. Il est remarquable que les exégètes aient si longtemps négligé cette dimension, alors même que Camus a exercé, bien qu’intermittente, une activité professorale non négligeable.
L’auteur, déjà reconnu pour avoir éclairé d’autres aspects de l’œuvre, notamment ses recherches sur Gaston Bachelard et sa lecture précise de la thématique de la pauvreté chez Camus, vise à dissoudre « l’énigme du silence » qui entoure cette période de sa vie. Ce silence est d’autant plus frappant que l’engagement de Camus dans l’enseignement, incluant des cours de philosophie et des sessions collectives, s’est étendu sur près de huit années.
C’est d’ailleurs ce silence que Camus cultive lui-même avec force, répondant d’un « Jamais » catégorique à une journaliste qui l’interroge sur une activité professorale en 1945. Jean-Michel Wavelet initie son travail en pointant l’incohérence entre la durée de cette implication et son absence quasi-totale dans les analyses approfondies. En s’attaquant à cette lacune, l’essai ne cherche pas seulement à rétablir une vérité biographique, mais à prouver que cette expérience d’enseignant, et, crucialement, l’empêchement qui en a découlé, est constitutive de la pensée camusienne, de ses valeurs humanistes et de son engagement en faveur de la justice sociale.
L’auteur révèle de surcroît l’énigme d’une exclusion non uniquement médicale pour l’agrégation en 1938, maintenue malgré les avis médicaux de guérison, questionnant ainsi l’influence du climat politique hostile de l’Algérie française. L’introduction prépare ainsi le terrain pour la révélation centrale de l’ouvrage : le rôle déterminant d’une « blessure secrète » dans la cristallisation de la vision pédagogique de l’écrivain.
L’apport fondamental de l’ouvrage de Jean-Michel Wavelet réside dans la révélation et l’élucidation du « mystère » qui entourait l’activité d’enseignement de Camus. Jean-Michel Wavelet ne se contente pas de signaler la lacune historiographique ; il en découvre l’origine traumatique : la « blessure secrète » d’Albert Camus. L’auteur met au jour le lien direct entre le silence de l’écrivain et son exclusion douloureuse du milieu enseignant, une double humiliation professionnelle, le refus d’un poste d’instituteur puis l’impossibilité de se présenter à l’agrégation, toutes deux causées par la tuberculose, une maladie que Camus lui-même stigmatisait comme la « maladie des pauvres ». C’est là que l’analyse atteint toute sa force paradoxale : cette mise à l’écart forcée, loin de l’éloigner du sujet, a servi de catalyseur à l’élaboration d’une pensée éducative d’une profondeur insoupçonnée.
Son engagement en tant que « pédagogue résistant » est d’ailleurs illustré par son action concrète en Algérie de février 1941 à février 1942, où il a enseigné aux enfants et adolescents juifs exclus de l’enseignement public par les mesures antisémites du régime de Vichy. Jean-Michel Wavelet démontre que cette réflexion est omniprésente, non pas sous forme de traités théoriques, mais « à l’arrière-plan des textes, dans les interstices des récits », se manifestant comme une véritable éthique de l’éducation. Camus n’est pas présenté comme un théoricien systématique, mais comme un pédagogue réflexif s’inscrivant dans la lignée de la tradition libertaire, dont la figure de Ferrer est explicitement mentionnée. Sa pensée n’est pas axée sur des doctrines ou des méthodes, mais sur l’importance cruciale des valeurs, la justice, la vérité, la fraternité, comme fondement de toute transmission.
Cette perspective est indissociable du parcours personnel de Camus : l’enfant pauvre, issu d’une lignée d’analphabètes, dont l’ascension intellectuelle fut entièrement tributaire de l’école républicaine et de figures emblématiques comme son maître Louis Germain, à qui il rendit un hommage poignant lors de son discours de Stockholm. Jean-Michel Wavelet érige l’éducation chez Camus en une véritable quête de justice et de dignité, montrant comment l’écrivain, privé de la transmission directe, a reporté son idéal pédagogique dans l’acte d’écrire, faisant de son œuvre le prolongement de son ambition d’éducateur.
L’impact de l’étude de Jean-Michel Wavelet est profondément novateur et se déploie sur deux niveaux essentiels. D’une part, pour les études camusiennes, l’ouvrage comble une lacune historiographique persistante en offrant une grille de lecture absolument inédite. En réintégrant la dimension pédagogique au cœur de l’humanisme camusien, Jean-Michel Wavelet éclaire sous un jour nouveau des textes fondamentaux, notamment l’ultime roman inachevé, Le Premier Homme, dont le thème central est précisément l’éducation et la transmission. La souffrance de l’« enseignant empêché » devient ainsi la source d’une éthique littéraire : le rôle de l’écrivain est de faire ce que l’instituteur n’a pu faire. D’autre part, l’essai injecte une matière riche et essentielle dans la réflexion pédagogique contemporaine.
L’œuvre de Camus, relue à travers le prisme de l’éducation, se révèle porteuse d’une critique radicale et étonnamment actuelle du système éducatif. L’auteur d’Alger dénonçait un modèle jugé inadapté au monde à venir, coupable de préparer les enfants à vivre dans un monde obsolète, et non à affronter les réalités complexes de leur temps. Pour Camus, la mission de l’enseignement devait être un « style de vie » et non plus des connaissances générales, cherchant avant tout « d’accroître la somme de liberté et de responsabilité qui est dans chaque homme ». En articulant sa critique virulente, nourrie par son expérience de la pauvreté et de l’exclusion, avec une éthique forte de l’engagement et de la résistance, Camus force le lecteur et le pédagogue à reconsidérer le rôle de l’école. Son œuvre devient une source de questionnement sur la finalité de l’enseignement : l’école doit-elle former des citoyens dociles ou des hommes capables de justice, de révolte contre l’injustice et d’autonomie morale face aux urgences du monde moderne ? L’étude de Jean-Michel Wavelet rend ainsi à la pensée de Camus une actualité brûlante dans le débat sur l’avenir de l’école.
Le travail d’exégèse mené par Jean-Michel Wavelet dans son essai est à la fois une réhabilitation et une démonstration de force. Il établit de manière définitive que l’empêchement professionnel subi par Albert Camus, cet interdit d’enseigner lié à la maladie, loin d’être un point d’arrêt, a paradoxalement fécondé et nourri une pensée éducative et humaniste qui infuse l’intégralité de son œuvre.
Le livre prouve que la frustration du maître empêché a été sublimée en une mission d’écrivain : transmettre les valeurs et l’expérience. Cette pensée, intrinsèquement liée à la condition de l’enfant pauvre, témoigne avec une force renouvelée, face à l’injustice sociale et à la misère, des exigences impérieuses de justice et de fraternité. Elle se dresse en rempart contre les fatalités et les systèmes qui aliènent l’individu. Jean-Michel Wavelet parvient ainsi à confirmer l’écrivain comme un véritable « pédagogue résistant » qui, n’ayant pu enseigner sur l’estrade, a choisi la voie de l’écriture pour délivrer son message. L’éducation morale et existentielle de l’homme n’a jamais cessé d’être sa préoccupation majeure, comme en atteste de manière poignante son ultime roman inachevé, Le Premier Homme, qui demeure, dans cette perspective, son testament pédagogique le plus précieux et le plus éloquent.
Brahim Saci
Albert Camus : Enseignant empêché, pédagogue résistant, Éditions l’Harmattan