Soixante-trois ans après la fin de la domination coloniale, l’Algérie continue d’entretenir une relation paradoxale avec le changement. Rarement l’expression tirée du roman Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa – « Il faut que tout change pour que rien ne change » – n’aura aussi bien résumé une trajectoire politique. Si les apparences de transformation sont régulièrement mises en scène, les structures profondes du pouvoir, elles, restent largement intactes.
Depuis 1962, le pays a connu plusieurs réformes constitutionnelles, des alternances institutionnelles et de nombreux discours sur le renouveau. Mais à chaque tournant annoncé, la promesse d’un changement profond s’est diluée dans les pratiques d’un pouvoir centralisé, résistant à toute redistribution réelle des leviers décisionnels. Le système politique algérien, en constante mutation formelle, semble avoir perfectionné l’art d’absorber les crises sans jamais se réformer en profondeur.
Cette mécanique du changement sans rupture a été une nouvelle fois illustrée à l’occasion de la célébration du 5 Juillet, fête de l’indépendance. P
lusieurs partis d’opposition et personnalités politiques ont dressé un constat sévère de l’état du pays. Le Parti des travailleurs, par la voix de Louisa Hanoune, a appelé à des mesures d’apaisement urgentes : libération des détenus politiques, fin des poursuites pour opinion, et rétablissement effectif des libertés syndicales, politiques et médiatiques. Le Front des forces socialistes, quant à lui, a mis en garde contre l’enlisement dans une logique d’exclusion, où les questions publiques sont réduites à une gestion sécuritaire ou administrative, marginalisant les forces vives de la nation.
Même tonalité du côté du RCD, qui dénonce la « persistance du déni de la pluralité » et l’étouffement du débat public. Pour son président Othmane Mazouz, la relance du pays passe par la libération des énergies sociales et le retour des jeunes au centre de la reconstruction démocratique. Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid, a pour sa part plaidé pour une transition vers une « Seconde République », marquée par l’élargissement des libertés et la refondation des institutions.
L’ancien ministre Abdelaziz Rahabi a quant à lui souligné, dans une analyse politique, le paradoxe d’une vie politique vidée de sa substance, avec des partis marginalisés et une société civile sous pression. Il y voit les signes inquiétants d’une régression vers une ère de désengagement similaire à celle vécue sous le règne d’Abdelaziz Bouteflika, où le sentiment d’inutilité de l’action politique s’était largement installé.
Saïd Sadi est sorti de sa réserve aussi pour livrer une analyse implacable de la situation du pays en mettant en avant notamment l’islamisme à la turque qui a pris le contrôle du pays.
Même indignation de la part de Mohcine Belabbas et Karim Tabbou, qui ont, à maintes reprises, dénoncé le coma politico-économique qui ronge le pays et l’arbitraire imposé comme moyen de tenir au silence le peuple.
Face à ces critiques, la présidence algérienne a tenté d’opposer sa propre lecture du bilan. Dans un communiqué diffusé à la veille des célébrations, elle affirme que le président Abdelmadjid Tebboune a « sorti l’Algérie de sa léthargie institutionnelle » en lançant des réformes, en dissolvant le Parlement, en organisant des législatives anticipées, et en intégrant davantage les jeunes dans la vie publique. Des affirmations qui peinent à convaincre les opposants, pour qui les mécanismes fondamentaux de verrouillage du champ politique restent intacts.
Car au-delà des gestes institutionnels et des promesses de renouvellement, c’est bien l’essence du système qui reste inchangée. Un système qui privilégie l’apparence de mouvement pour maintenir l’ordre existant. Une stratégie de préservation qui, à défaut d’anticiper les attentes d’une société de plus en plus consciente et connectée, pourrait alimenter frustrations et ruptures.
La commémoration du 5 Juillet ne fait ainsi que renforcer ce double constat : celui d’un peuple en quête de dignité, de liberté donc et d’un régime replié sur lui-même, convaincu de sa légitimité historique, mais encore profondément réfractaire à toute réforme de fond. En Algérie, tout semble bouger, mais, en réalité, rien ne change véritablement. C’est dire qu’on est face à une situation particulièrement abrasive.
Samia Naït Iqbal




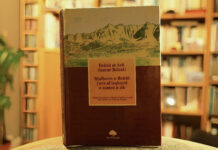


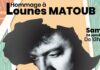



Malheureusement c’est l’image d’un grand pays avec une population jeune poussée à l’exil par un régime autiste mais droit dans ses bottes qui s’impose à un peuple qui ne le supporte plus. D’où cette situation de blocage qui dure et qui devient insupportable pour beaucoup d’Algériennes et d’Algériens surtout ces jeunes diplômés dont l’horizon est bouché. Mais la solution n’est pas ailleurs, elle est en Algérie même et la clef pour débloquer tout ça est entre les mains d’autistes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s’en servir. Pour comprendre la « logique » des autiste il faut être psy et ce n’est pas donné à tout le monde malheureusement!!!
Comment certains peuvent ils encore prétendre que l’Algérie est une démocratie qui peut donner des leçons au monde entier et particulièrement à la France comme le fait Tebboune avec un président élu avec 84,30 % des voix et seulement 46,08 % de votants ,notons au passage que pour être éligible en Algérie il faut être de confession musulmane
La dictature par la force s’appele Une Tyrannie.
Article à charge, à mon avis !
N’est ce pas l’ânejiri troisième économie du monde ?
N’est-ce pas l’ânejiri qui a créé la démocratie, dixit le berzidan 5%?
N’est-ce pas l’ânejiri qui dispose du meilleur système de santé d’Afrique et du monde arabe ?
N’est-ce pas l’ânejiri qui a la justice la plus indépendante du monde ?
N’est ce pas l’ânejiri, seul pays au monde, où il n’y’à pas de pauvres ?
N’est ce pas l’ânejiri qui a la population là plus polyglotte du monde ?
On peut continuer comme cela pendant des heures.
Malheureusement, ils ont même détruit ce que le colon nous a laissé, mais pas grave ils nous reste alahouakbar,alahghaleb et machalah, et c’est cela l’essentiel. Nous avons la chance de pouvoir compter sur le paradis pour nous rattraper avec les houris, et le st- éstephe coulant dans les rivières et des tapas aux cochons halal bien sûr.