Le destin a voulu que la vie du grand homme doive s’arrêter aux portes de l’Algérie indépendante. C’était comme pour signifier que l’incarnation de la culture et de l’espoir n’y avait plus sa place dans ce nouveau monde qui lui aurait tourné le dos tant il est l’opposé de ce qu’il fut.
Mouloud Feraoun, avant de se pencher sur sa dimension politique, fut celui qui a donné par son célèbre roman Le fils du pauvre la définition de la réussite par le mérite. Tout y était, le monde extérieur et celui de ses racines profondes.
Né en 1913, Feraoun nait en Kabylie, dans le village de Tizi Hibel sous le nom de sa communauté des Ait Chabane. Il n’a pas été épargné par l’obligation d’une attribution d’un nom choisi par les administrateurs des Affaires indigènes pour un recensement des populations et de leur état civil en Kabylie comme dans de nombreux villages isolés en Algérie.
L’écolier aux pieds nus se révèle être un excellent élève. Comme pour Albert Camus, il doit à son maître de poursuivre ses études au cours complémentaire de Tizi Ouzou après son certificat d’études. Un diplôme qui était déjà une étape très improbable pour la quasi-majorité des « indigènes » dont seulement dix pour cent bénéficiaient d’une instruction scolaire.
Par son excellence et acharnement à progresser il passe le concours des bourses qu’il réussit, ce qui lui permet d’accéder à un cursus qui va l’amener jusqu’au brevet élémentaire puis au prestigieux concours de l’Ecole normale d’instituteurs qui fut ouvert aux indigènes depuis 1928.
Mouloud Feraoun est ainsi l’exemple de la parfaite assimilation dans les deux cultures dans un équilibre parfait. Il est resté l’enfant de la culture de sa terre natale aussi bien que celui de la culture française.
Dans le premier volet de sa célèbre trilogie, Le fils du pauvre, personne mieux que lui n’avait décrit aussi justement la situation d’un petit enfant de famille très modeste qui se hisse au sommet de la littérature par la force de son acharnement à y arriver. Le fils du pauvre, un titre qui est devenu l’hymne à l’espoir et la preuve que rien n’est prédéterminé si on veut y mettre sa farouche volonté.
La terre et le sang, second volet de la trilogie, va au-delà de son assimilation aux deux cultures qui vont le forger et faire apparaitre encore plus clairement sa thématique fondamentale, celle qui traverse son œuvre, celle à laquelle il aspirait, le lien entre toutes les cultures et religions.
Dans ce roman il témoigne du drame que subissent tous ceux qui sont au carrefour de toutes les humanités. Il fut le premier écrivain à aborder la délicate question de l’intercommunicabilité, le premier à oser briser le tabou en clamant que seuls ceux qui doutent ou ne ressentent pas leurs racines ont peur de la différence, de l’autre.
Dans le troisième volet, Les chemins qui montent, le jeune homme Amer revient de France vers son village natal et tombe amoureux d’une orpheline convertie au christianisme par les Sœurs qui l’avaient recueillie. Son rival, autant amoureux de la jeune fille, devient son ennemi.
Il continue ainsi dans la souffrance de l’écartèlement entre les cultures. Cette fois-ci le personnage est un jeune homme qui revient dans son village natal accompagné par une femme française. On imagine ce qu’il en adviendra face à la stupéfaction d’une communauté qui reste fermée à une telle initiative d’ouverture d’esprit
Avec cette personnalité si forte et assumée qui s’est confrontée à tant de barrières, il restera pourtant toujours le gentil fils du pauvre. Parmi tous les commentaires qui ont été rédigés à propos de sa personne, j’en ai retrouvé deux particulièrement significatifs.
La premier est l’éloge de la grande résistante française et ethnologue reconnue, Germaine Tillon qui dans un article publié dans Le Monde dit “Cet honnête homme, cet homme bon, cet homme qui n’avait jamais fait de tort à quiconque, qui avait dévoué sa vie au bien public, qui était l’un des plus grands écrivains de l’Algérie, a été assassiné.”
Puis celui de Jean Daniel, écrivain et éditorialiste né en Algérie, “Il était de ces êtres comme Camus les aimait : silencieux, fins et solides, accordés à la vie.”
Mouloud Feraoun écrira plus tard que la période essentielle dans sa vie aura été celle des trois années passées à l’école normale. Il fera la connaissance de celui qui restera son ami, un Oranais, d’origine presque aussi pauvre, fils d’ouvrier, Emmanuel Roblès. De plus en plus inséré et admiratif de la culture française c’est à ce moment qu’il découvre la politique avec un autre de ses camarades, Ahmed Smaïli, qui dirigeait une section du parti communiste à l’école normale. Ce dernier animait le journal interne La lutte sociale. L’activité militante de ce dernier lui a valu un renvoi.
Et voilà Mouloud Feraoun piqué au virus de la politique en étant le disciple de son camarade. Devenu instituteur et marié, un second événement entre beaucoup d’autres va marquer son parcours, celui de sa lecture d’un reportage d’Albert Camus dans Alger républicain sous le titre « Misère de la Kabylie ». Il fut très critique envers le grand écrivain car il estimait que celui-ci passait sous silence les événements d’Algérie. Il lui écrivit en manifestant ce sentiment de déception.
Mais Mouloud Feraoun s’est lui aussi mis en situation d’être critiqué pour son attentisme. Les chemins qui montent vont effacer le doute sur son sentiment nationaliste face à la colonisation. Je pense personnellement que son profond attachement et admiration de la culture française n’était pas étranger à cette hésitation des débuts. Si ce n’est pour la conviction, certainement déjà présente dans son réveil précédent à la politique, au moins pour la modestie de son engagement.
En 1955, il dirige secrètement un journal dans lequel il dénonce la répression de la colonisation mais aussi celle du FLN auquel il n’adhère pas. C’est donc dans une position de relative neutralité qu’il aborde ce combat même s’il est désormais définitivement rallié à l’idée d’une Algérie indépendante.
C’est lui-même qui déclarait en novembre 1958, « Je ne veux pas faire de politique. Jamais je n’en ferai. Ce n’est pas dans mes cordes ». En réalité tout son militantisme assumé prouve que c’était plus une position médiane que neutre. Elle était probablement, selon mon opinion, le résultat de son éternel désir d’alliance entre ses deux identités. J’en conclus qu’il voulait éviter la rupture des liens culturels tout en voulant la rupture du lien politique.
Dans cet état d’esprit, il fut très optimiste après la déclaration d’intention du Général de Gaulle. « La sagesse refusera l’intégration, comme on refuse une duperie, la sagesse accordera l’indépendance pour confondre toutes les folies, réparer toutes les erreurs, faire oublier tous les crimes. De Gaulle est un sage. Ça, je le crois. » Ce qui ne laisse encore une fois aucun doute sur son sentiment politique tout en accordant une chance au maintien des liens.
Il refuse ensuite un poste au Quai d’Orsay puis collabore avec Germaine Tillon dont nous avons déjà fait référence pour une implication dans des centres sociaux.
Ce qui est arrivé devait se produire, la suspicion a été à l’égale de son parcours d’intellectuel et militant, il sera accusé des deux côtés, lui qui a voué toute sa vie à la communion des cultures.
Le fils du pauvre sera assassiné par des sicaires de l’OAS le 15 mars 1962 alors qu’il venait d’accéder à la dignité d’inspecteur des centres sociaux. Sa mort le fera accéder à plus haut, le Panthéon algérien des grands hommes.
Boumediene Sid Lakhdar



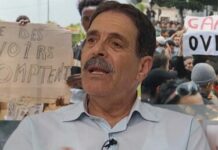







Je ne puis réprimer un sentiment de colère quand on me rappelle ces écrivains des deux rives aux mains propres , qui avaient adopté une posture esthétique pendant que d’autres pas forcément moins doués qu’eux se « salissaient les mains » , pour paraphraser Sartre.
J’ai été ado et j’ai lu Feraoun sans être captivé par son écriture. Si on disait de Camus que c’est un écrivain pour collégiens, Feraoun était un écrivain pour écolier. On reconnait son style de composition comme si Feraoun voulait écrire un poème à Camus, sur le drame qui se déroule devant eux.
Bien sûr Feraoun n’était en rien responsable de ce qui s’y déroulait et il ne le cautionnait pas non plus. Mais moi à sa place ce n’est pas des regrets et encore moins de la sympathie que j’aurais exprimée à Camus mais de la rage, car le colonialisme, comme l’avait rappelé Kichi sur l’autre fil, n’était pas une amourette entre deux pays mais un viol.
Je lis cette lettre de Feraoun avec beaucoup d’étonnement. Connaissant l’histoire, cette lettre de Feraoun à Camus ressemble à une correspondance entre deux frères dont l’un est le produit d’un viol. C’est ce lien de sang qui les rattache et qui les empêche de s’entretuer.
Tandis que la majorité des intellectuels algériens avait déjà fini par basculer du coté de la guerre contre l’occupant Feraoun, lui, a choisi la voie épistolaire pour faire son Roméo à Camus comme si des malfaisants leur avaient gâché leur idylle.
Le bilan, 63 ans après, des fruits de la guerre d’indépendance donne raison à Feraoun et à Camus, leur position médiane était la seule qui pouvait faire évoluer la situation coloniale vers une réconciliation des communautés, une identité méditerranéenne plurielle et originale. Une occasion manquée. En lieu et place, nous héritons de cette monstrueuse hydre à trois tête, militaro-arabo-islamique qui achève la destruction des fondements identitaires, culturels et linguistiques de l’Afrique du nord.
NB: Jean-Jacques Brochier » Camus, philosophe pour classes terminales »
Le FLN portait en lui la violence et le totalitarisme qui structure le régime depuis l’assassinat de Abbane jusqu’au système carcéral et répressif de Tebboune- Chengriha, en passant par le putsch contre le GPRA, le coups d’État de juin 1965, la répression d’avril 1980, d’Octobre 1988, le putsch de Janvier 1992, la Décennie noire, Le printemps Noir, la destruction des peuples berbères.
Ghandi discutait avec un fonctionnaire britannique avant l’indépendance de l’Inde. Le foncionnaie britannique lui dit: « Mais pourquoi donc cherchez-vous à devenir indépendants ? Vous savez bien que tout ce que vous obtiendrez sera l’anarchie et le chaos. »
Réponse de Ghandi : « Ça se peut bien, mais ce sera NOTRE anarchie et NOTRE chaos. »
Salut, Dda Hend. Je me rappelle le jour où l’OAS a tué Mouloud Feraoun. J’étais petit et je ne savais pas qui il était, seulement que mon père avait resseni une vive émotion en apprenant la nouvelle.
Pour la relation entre lui et Camus dans le contexte de la colonisation, il me vient trois possibilités à l’esprit, mais pas nécessairement les seules : l’éléphant dans la pièce, le scotome, l’hypocrisie.
– L’éléphant dans la pièce: les deux hommes étaient pleinement concients de la situation affreuse de la colonisation mais évitaient de l’évoquer en termes clairs et crus par « pudeur » l’un envers l’autre, pudeur déplacée pour dire le moins.
– Le scotome: Même chose que l’éléphant dans la pièce mais de façon plus ou moins inconsciente. Difficile à croire.
– L’hypocrisie: ni Camus ni Feraoun n’exprimaient leurs sentiments profonds réels. Feraoun au moins en partie par une peur tout à fait fondée pour sa vie et son statut, Camus pour toute la réalité de sa vie de fils de parasite – pas sa faute, bien sûr – vivant sur le corps de Feraoun.
A la place de l’un ou de l’autre qu’aurais-je fait moi-même? Je n’en sais rien.
Azul a yamdakul,
J’irais encore plus loin que l’hypocrisie, c’est ce que j’évoque dans ma lettre à Camus sur l’autre fil. Quand j’étais mioche, notre voisin d’en face était un colon. Il avait des enfants de mon âge mais nous n’avions aucune relation. Il avait un garçon et une fille de mon âge avec laquelle je désirais jouer mais Malgré toutes mes avances je n’essuyais que mépris. Nous n’avions pas plus de relations entre familles ou entre voisins. Et la guerre est venue aggraver la situation. Voilà pourquoi je trouve la lettre de Feraoun à Camus pour le moins incongrue.
Tu sais, sans vouloir offenser l’immensité du talent d’écrivain de Feraoun et encore moins la ferveur que lui vouent ses lecteurs , j’ai toujours trouvé son écriture comme une écriture naïve et sa lettre à Camus est dans le même jus.
Comment ya Boureb on peut écrire ça en pleine guerre ? Je l’aurais compris s’il s’agissait d’un parti-pris romanesque, un choix de style provocateur. Mais Feraoun était plutôt un consentant. Fafa lui a fait une faveur de l’avoir instruit , il lui devait une sorte de respect. C’est le revers du butin-de-guerrisme, l’arme de guerre des autres.
Je ne dirais pour sa défense qu’une chose : Feraoun ne pouvait pas échapper à ses conditionnements de Kabyle et de « cultivé ». ET cette lettre à Camus au lieu d’être une synthèse une sorte d’apothéose de cette union est au contraire une chimère monstrueuse.
Les deux hommes ne pouvaient pourtant ignorer cet éléphant dans la pièce: ils étaient tous deux nés en 1913, donc en tant qu’enfants, adolescents et même comme jeunes adultes ils ont très certainement connu personnellement des vieillards qui ont participé à la conquête finale de la Kabylie en 1957 et la « confiscation » des bonnes terres un peu plus tard, comme si le mot confiscation pouvait masquer le vol pur et simple par la force brutale. Une armée professionnelle, bien nourrie, bien équipée, venue de l’autre côté de la mer attaquer de misérables paysans qui ne leur avaient rien fait pour leur enlever tout ce qu’ils avaient et les « soumettre ».
Mais bien sûr qu’ils n’ignoraient rien de tout cela ! Fanon et Sartre ( B. Traven) étaient-il des criminels ou des bandits pour avoir pris leur parti pris sur cette question coloniale. Je n’évoquerais pas le matérialisme dialectique ou historique mais Ils ne pouvaient tout de même pas ignorer que l’histoire s’écrivait autrement.
Les travaux des ethnologues ont permis de sauvegarder des informations, fragmentaires certes, sur la société kabyle et par extension nord-africaine des 19e et premières partie du 20e siècle. C’es témoignages qui émanent néanmoins de regards extérieurs, le plus souvent condescendants.
Avec Mouloud Feraoun et Fadhma Amrouche notamment, par le truchement de la fiction et de l’autobiographie, ces éléments interagissent, se meuvent et reprennent vie et sous un regard des premiers concernés.
Au train où vont les choses, ces travaux et ces œuvres littéraires deviendraient les seuls liens avec l’héritage classique. Il est craindre alors qu’il ne resterait pas grand chose de la civilisation nord africaine ancienne. Un peu comme les écrits de Tite -Live, Polybe, Salluste et d’autres références fragmentaires sont les seuls témoignages de notre histoire classique.
Sil il était vivant au semblant d’indépendance que nous vivons il serait probablement assassiné par les tenants du pouvoir actuel ou il serait en exil. Je ne pense pas qu’il aurait vécu dans une Algérie uniquement arabo- islamique excluant le Kabyle et le Français.. Aujourd’hui encore à six pieds sous terre on le salit, lui qui à payé de sa vie une Algérie Algérienne tolérante et ouverte à toutes les communautés. Quel beau pays ça aurait été si son rêve s’était réalisé. Par contre on fleuris sa tombe avec le drapeau d’Algérie actuel. Lui qui a dit: » Vos ennemis de demain seront pires que ceux d’aujourd’hui. »
Il doit se retourner dans sa tombe. C’est toujours avec plaisir que je relis souvent les œuvres de ce grand écrivain. Mais l’Algérie actuel ignore ces écrivains talentueux, et préfère les assassiner comme le regretté -Tahar Djaout.
Faites-moi savoir quand les enfants et jeunes d’aujourd’hui vous interesseraient.
Il y a, a peu-pres, 1000 visiteurs reguliers sur LMA – quelle structure sense’e mettons-nous sur pieds qui puisse les inspirer et surtout les dicipliner. Quand a faire parler les morts . . . ca me depasse.
Il ne serait pas mort sous les balles assassines de l’OAS, il l’aurait été sous les lames tranchantes de Haddam, Belhadj, Madani and Co,… 30 ans plus tard.