Plus de soixante ans après l’indépendance de l’Algérie, les relations entre Paris et Alger restent marquées par une histoire douloureuse et une série de tensions récurrentes. Entre gestes d’apaisement et crises à répétition, la relation bilatérale avance à pas hésitants, sans jamais parvenir à se départir totalement du poids du passé.
Est-ce le dénouement ? Sommes-nous tentés de nous demander. Depuis 1962, la mémoire de la guerre d’indépendance algérienne reste au cœur du débat politique en Algérie. Les pouvoirs politiques successifs dominés par les nationalistes du FLN s’en servent comme fondement de leur légitimité. Le discours anti-français s’est aussi étendu à l’opposition islamiste, usant du slogan « du parti de la France » pour brocarder les partis laïcs et les élites francophones.
L’exigence d’une reconnaissance explicite des crimes coloniaux est souvent brandie par Alger comme condition d’un véritable rapprochement avec Paris.
La France, quant à elle, par pragmatisme et realpolitik, s’efforce de maintenir un lien privilégié avec son ancienne colonie, notamment en raison de la forte communauté algérienne présente sur son sol.
Les années 2000 : l’espoir contrarié du rapprochement
Une dynamique prometteuse paraît, à l’orée des années 2000. Sous les présidences de Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika, les échanges s’intensifient. La Déclaration d’Alger de 2003, l’Année de l’Algérie en France et la reconnaissance de la guerre d’indépendance par Paris témoignent d’un début de réconciliation. Mais cette volonté est rapidement mise à mal. Les révélations sur la torture, la loi française de 2005 vantant les « bienfaits » de la colonisation, puis l’abandon du traité d’amitié nourrissent les crispations. L’arrivée de Nicolas Sarkozy, fermement opposé à toute repentance, referme la parenthèse. De nouveaux différends émergent, comme l’affaire des moines de Tibhirine ou l’inscription de l’Algérie sur la liste française des pays à risque.
Macron : entre ouverture mémorielle et turbulences diplomatiques
Avec l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, un vent de renouveau semble souffler sur les relations bilatérales. Le chef de l’État frappe fort dès sa première visite à Alger, en qualifiant la colonisation de « crime contre l’humanité ». Cette déclaration est suivie de plusieurs initiatives concrètes : mise en place d’un fonds d’investissement, accords sur la coopération judiciaire et sur la mobilité des jeunes.
Mais la lune de miel est de courte durée. En 2021, Macron relance la polémique en évoquant une « rente mémorielle » entretenue par le régime algérien, tout en qualifiant le système politique d’Alger de « fatigué ». La riposte ne se fait pas attendre : rappel de l’ambassadeur, interdiction de survol du territoire par les avions militaires français. La crise s’amplifie avec la réduction du nombre de visas, conséquence du refus algérien de délivrer des laissez-passer consulaires pour le retour des ressortissants algériens résidant illégalement en France.
Une relation en dents de scie
Les tensions s’intensifient en 2023 avec l’affaire Amira Bouraoui, une militante exfiltrée vers la France, puis avec les critiques répétées du régime algérien envers France 24. Le survol de l’espace aérien algérien est une nouvelle fois interdit aux avions militaires français, dans le contexte du coup d’État au Niger.
Mais c’est en 2024 qu’un nouveau cap est franchi. La reconnaissance par Paris du plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental provoque la colère d’Alger, qui y voit une trahison de ses intérêts géopolitiques. Résultat : ambassadeur rappelé, visite officielle du président Tebboune en France annulée, et déclarations virulentes dénonçant une « soumission humiliante » à Rabat.
Vers un dégel prudent ?
Au début de l’année 2025, le dialogue entre les deux pays est au point mort. Après l’arrestation en Algérie de l’écrivain Boualem Sansal, la situation s’envenime. Le refus d’accueillir des ressortissants algériensindésirables en France et les accusations croisées entre médias finissent de pourrir des relations chaotique, installant un climat de méfiance qui faisait planer le risque d’une rupture définitive. La coopération bilatérale est réduite à sa portion congrue — notamment dans le domaine énergétique, avec les importations françaises de gaz algérien.
Pourtant, un signe d’apaisement a émergé depuis la visite à Alger, le 6 avril 2025, du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La rencontre du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avec le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune et son homologue algérien, Ahmed Attaf pourrait inaugurer une nouvelle phase de dialogue, après huit mois de gel diplomatique et de crispations répétées. Mais entre contentieux historiques et désaccords stratégiques, la route vers une normalisation durable reste semée d’embûches.
Samia Naït Iqbal


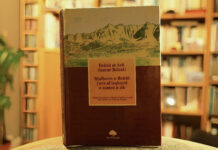








Incroyable, des la 1ere demi-phrase, et je ne vais pas aller plus loin. « Plus de soixante ans après l’indépendance de l’Algérie… »
et qui est independent de qui?
Quand vous ecrivez la France, un lecteur enttend un Pays, une Republique – c.a.d. un territoire, une population, une langue, une monnaie, un Etat, un gouvernement, un parlement, des elus partout et donc des elections partout…
Que faut-il comprendre quand on lit « l’Algerie? » Ou faut-il faire semblant?