Historien, romancier et helléniste, Saber Mansouri vit aujourd’hui en Bretagne après avoir passé un quart de siècle à Paris. Il a enseigné à l’École pratique des hautes études ainsi qu’à l’Institut catholique de Paris. En 2003, il fonde sa propre collection aux éditions Fayard.
Son double regard – ancré entre Méditerranée, antiquité et modernité – irrigue une œuvre dense, à la croisée de l’histoire et de la littérature. Dans Quand la France perd le Sud et les siens et Un printemps sans le peuple (éditions Passés composés), il interroge aussi bien les angles morts du récit républicain français que les désillusions des révoltes tunisiennes.
Dans cet entretien accordé à Le Matin d’Algérie, il revient sur la marginalisation des périphéries, le poids des mots, la confiscation du langage révolutionnaire et la nécessité de rouvrir les archives pour retisser un lien entre mémoire et justice.
Le Matin d’Algérie : Vous semblez chercher l’histoire non pas au centre, mais dans ses marges. Pourquoi ce choix méthodologique et politique d’écrire depuis la périphérie ?
Saber Mansouri : Chercher la lumière dans la nuit, la vérité dans la marge, n’est ni un choix méthodologique ni un choix politique, c’est une vérité première que certains esprits éclairés, des élus donc, ont saisie. Dostoïevski a cette phrase lumineuse : l’histoire ne révèle sa propre essence qu’à ceux qu’elle a au préalable exclus d’elle-même. Ce sont souvent les « vies minuscules » et la périphérie qui nous racontent la grande histoire et le centre. Je ne sais plus quel écrivain français a cette formule assez juste : l’Internationale des snobs n’est pas l’univers.
Le Matin d’Algérie : Dans vos deux ouvrages, on retrouve un même fil conducteur : donner voix à ceux qui ne l’ont pas. Est-ce une manière de réhabiliter l’idée d’un peuple oublié, en France comme en Tunisie ?
Saber Mansouri : Dans les démocraties du temps présent, on a tendance à gouverner sans le peuple, voire contre lui. La démocratie est un mot en caoutchouc, dit Auguste Blanqui. J’ai une haute opinion de la politique, je crois qu’il faut estimer son pays et son peuple pour gouverner. Je considère que l’estime des siens est une valeur plus précieuse que la démocratie.
Le Matin d’Algérie : Vous parlez des “sans verbe”, de ceux qui ne peuvent pas nommer leur propre condition. Peut-on faire révolution sans mot, sans récit propre ?
Saber Mansouri : La révolution advient aussi par le verbe. Nommer l’événement de 2011, « le printemps arabe », la « révolution du jasmin », dans la langue arabe, voilà ce qui a manqué. La révolution advient aussi grâce à un processus d’auto-institution et d’autotransformation, deux mots chers à Cornelius Castoriadis. Malheureusement, les pays arabes ne sont pas encore entrés dans ce processus.
Le Matin d’Algérie : Le titre de votre livre évoque une double perte : celle d’un territoire (“le Sud”) et celle de ses enfants (“les siens”). Qu’entendez-vous exactement par là ?
Saber Mansouri : Ce livre couvre une période allant de 1870 à 2024, du décret Crémieux jusqu’à aujourd’hui. Après avoir perdu le Sud, l’Afrique, ses colonies, la France perd les siens, une partie de ses propres citoyens habitant la banlieue, les cités, la marge de la République, des citoyens considérés par certains idéologues et politiques comme des corps politiques imparfaits, difficiles à intégrer, à ramener à la raison républicaine, parce qu’ils sont musulmans. « Il est dangereux de faire citoyen un individu dont le cœur est ailleurs », dit-on, sauf que le gouvernement des cœurs peut engendrer le désastre – l’exemple de l’Inquisition est là pour nous le rappeler.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi avoir choisi d’ancrer votre réflexion dans des lieux bien précis comme Clichy-sous-Bois, La Courneuve ou Vaulx-en-Velin ? Que disent ces territoires de la République française contemporaine ?
Saber Mansouri : Ces lieux périphériques nous racontent la France : la République a créé les conditions de ce que Maxime Rodinson appelle la « peste communautaire ». Mettre à l’écart du centre une partie du corps civique, c’est admettre de facto que « cette population » n’est pas « intégrable ». Dans ces cités, on va à la mosquée pour apprendre l’arabe et non à l’école de la République. L’idéologue et le politique, pressés de gouverner la France, disent qu’enseigner l’arabe à l’école, c’est islamiser le pays.
Le Matin d’Algérie : Dans votre livre, deux personnages – l’ancêtre et le petit-fils – semblent porter une même altérité. Pourquoi les dites-vous “soumis à l’islam”, donc difficiles à assimiler ?
Saber Mansouri : Ces deux êtres, l’ancêtre et le petit-fils, ont un cœur soumis à l’islam, ce sont deux corps politiques étrangers, donc difficiles à assimiler.
Le Matin d’Algérie : Quels leviers faudrait-il activer pour que la France intègre réellement ses marges et répare son lien à ces citoyens ?
Saber Mansouri : Pour que la France réussisse à intégrer ses marges, il faut que les intellectuels qui pensent et les politiques qui gouvernent comprennent le sens de l’histoire pour rendre la République plus républicaine. Et pour que cette République rassemble les siens autour d’un bien commun partagé, il faut ouvrir les archives aux historiens pour solder les maux du passé et apaiser les mémoires. Aussi, l’enseignement de l’arabe à l’école et une histoire qui n’exclut pas contribueront à se libérer de la « peste communautaire ».
Le Matin d’Algérie : En Tunisie, diriez-vous que la révolution a échoué aussi par défaut de langage ?
Saber Mansouri : Oui, cette révolution a échoué (en partie) faute de langage : ne pas pouvoir nommer ce qui nous arrive dans notre propre langue consolide l’idée de la défaite. C’est le Nord malin, fabricant de concepts, de théories, d’armes, de cartes, etc., qui a gratifié la Tunisie de « printemps arabe » et de « révolution du jasmin ». Nommer les choses dans notre propre langue, c’est aussi s’affranchir de la corruption du langage et de la contrebande des mots, deux maux qui font querelle au réel et à la vérité.
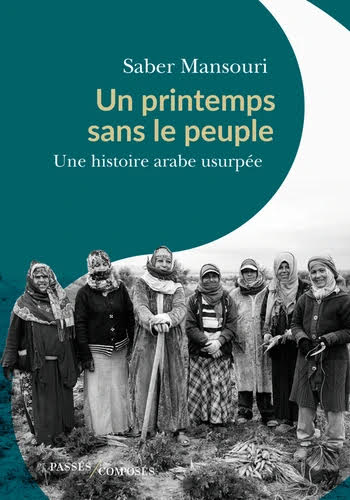
Le Matin d’Algérie : Vous critiquez le récit dominant autour du « printemps arabe ». Est-ce aussi une manière de dénoncer une confiscation du sens ?
Saber Mansouri : Je n’oppose pas le récit occidental de la transition démocratique au silence du peuple, je dis tout simplement qu’on peut penser à côté du peuple, voire contre lui, en corrompant le langage et l’événement. Je pense que ce qu’on appelle le « printemps arabe » est mort à l’instant même où on a bombardé la Libye. La démocratie ne s’offre pas par la guerre, ne s’impose pas par la force. Pour revenir à la Tunisie, au peuple tunisien, je le redis : l’estime des nôtres, la justice sociale, une éducation publique qui élève ses enfants et prépare l’avenir du pays, une santé accessible à tous, sont les clés pour redonner au peuple sa dignité et sa souveraineté.
Le Matin d’Algérie : Est-ce le peuple ou les élites qui font l’histoire ?
Saber Mansouri : Les dirigeants changent et les philosophes de la question politique s’inspirent ou se querellent, alors que le peuple est toujours le même (depuis que l’homme est devenu un animal politique). On a essayé plusieurs régimes politiques pour le gouverner : royauté, aristocratie, oligarchie, tyrannie et démocratie. Un pays n’appartient ni à une oligarchie ni à une élite, c’est un bien commun qui appartient à ce peuple qu’on essaie de gouverner, et ce peuple ne demande qu’une chose : être estimé.
Le Matin d’Algérie : Peut-on réconcilier les mémoires entre la France et le Maghreb sans un travail sur les archives ?
Saber Mansouri : Réinventer l’histoire, c’est être à la hauteur du passé, c’est regarder en face ses grandeurs et ses bassesses, et seule l’ouverture des archives peut aider à la réconciliation et à une certaine fraternité de destin entre les deux rives de la Méditerranée.
Le Matin d’Algérie : À quoi sert la littérature, selon vous, dans ces combats ?
Saber Mansouri : Un écrivain écrit pour être à hauteur du réel, de la vérité, des siens et de la guerre des hommes. Une phrase peut changer le destin d’un homme en le remettant devant son propre miroir : dans Nedjma, Kateb Yacine commence son roman ainsi : « Lakhdar s’est échappé de sa cellule. » Miracle de la littérature : non seulement l’Arabe, l’Algérien, a un prénom, une identité, il a aussi réussi à se libérer. Il est devenu visible et fier de l’être.
Le Matin d’Algérie : Vous avez une belle formule sur Ulysse. Pouvez-vous nous la rappeler ?
Saber Mansouri : Je me dis qu’avec une police des frontières et la douane d’aujourd’hui, Ulysse n’aurait pas pu accomplir son voyage de retour à Ithaque et retrouver son royaume et son épouse. Mais pour revenir au réel, en France, certains politiques pressés de gouverner et des idéologues alimentant l’opinion au quotidien continuent de parler de vagues migratoires et de grand remplacement, alors que le désir de s’installer en France s’éteint de plus en plus. Et comme le disait justement l’helléniste Nicole Loraux, il vaut mieux être un métèque à Athènes qu’étranger en France aujourd’hui.
Le Matin d’Algérie : Enfin, vous dites : “Dis-moi comment tu parles de l’autre, je te dirai qui tu es.” Que signifie cette phrase pour vous ?
Saber Mansouri : « Dis-moi comment tu parles de l’autre, je te dirai qui tu es », cette phrase, la mienne, figure dans un de mes livres. Elle dit la grandeur de fabriquer son propre miroir, de s’affranchir des vieilles représentations de l’Arabe, du musulman, de l’indigène, et de cet autre qu’on continue de clouer au mur. Tel un artisan, un écrivain travaille sa phrase, ne corrompt pas le langage, essaie d’être à la hauteur des siens, du passé et de la guerre des hommes.
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Principaux ouvrages De Saber Mansouri
Essais
La Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ?, André Versaille
L’Islam confisqué : manifeste pour un sujet libéré, Actes Sud
Athènes vue par ses métèques (Ve – IVe siècle av. J.-C.), Éditions Tallandier
Tu deviendras un Français accompli : oracle, Éditions Tallandier
La France est à refaire : histoire d’une renaissance qui vient, Passés Composés
Un printemps sans le peuple : une histoire arabe usurpée, Passés Composés
Quand la France perd le Sud et les siens, Passés Composés
Romans
Je suis né huit fois, Éditions du Seuil
Une femme sans écriture, Éditions du Seuil


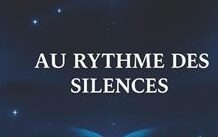
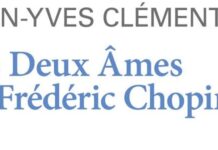







J’espere ne pas etre charcute’encore une fois. Vous avez un sacre’ boucher en interne, probablement un illumine’… du 7eme ciel.
Je cite: « Saber Mansouri : Dans les démocraties du temps présent, on a tendance à gouverner sans le peuple, voire contre lui. La démocratie est un mot en caoutchouc, dit Auguste Blanqui. J’ai une haute opinion de la politique, je crois qu’il faut estimer son pays et son peuple pour gouverner. Je considère que l’estime des siens est une valeur plus précieuse que la démocratie. »
Democratie et estime. Il y a en fait toute une de pense’e de droite, qui pense qu’une autre condition ou 3eme pied est necessaire pour realiser le potentiel d’un Peuple, son peuple. Entre estime et democratie, c.a.d. respect de la volonte’ populaire, il y a un equilibre a trouver. S’enguager dans la politique de son peuple, c.a.d. tous les aspects de sa vie de groupe, c’est rechercher cet equilibre-la dans le debat Libre. Ce qui suggere une ECOUTE et donc une ATTENTION – Ce qui a son tour requiert RESPECT. Une condition elementaire mais capitale pour ce respect est l’APPARTENANCE a ce Peuple-la. Cela suggere ou assume que le politique qui s’enguage dans cette aventure a un MINIMUM DE SELF-ESTIME, faute de quoi il y a defaut.
Une des qualite’s morales recherche’es chez cette droite est la CAPACITE’ de se remettre en cause et celle d’aller, parfois, contre l’opinion, la croyance voir l’interet de son peuple pour le guider ou le sauver de l’echec – de realiser son potentiel –
D’ou la question « quel comportement et quel discour sont indicateurs de zel, voir absence de respect, au point de geler la democratie faute d’exprimer le mepris envers ce peuple-la en termes sinon crus, menacants – au non du peuple?
Il y a tout de même un immense hiatus géographique et générationnel entre les enfants d’émigrés et ceux qui sont restés au pays.
Déjà que les petits fils n’ont rien de la culture et de la personnalité des grands parents. C’est un autre peuple qu’on là.
Et ne me demande comment ´Nommer les choses dans notre propre langue’ (comprendre, probablement, celle que les h’jeunes des banlieues apprennent à la mosqueé), ‘c’est aussi s’affranchir de la corruption du langage et de la contrebande des mots, …’
Baptiser la révolution tunisienne d’un de ces mots sentant la naphtaline de la fus’ha, pas plus qu’en français, ne fera pas les tunisiens des gens plus investis dans leurs révolution. La raison est qu’ils parlent tunisien, dardja, qui ne s’apprend pas dans les mosquées de banlieue.
A l’évidence, beaucoup d’intellectuel confondent la culture officielle matraquée par les media des pays d’origine avec les cultures des peuples des dits pays.