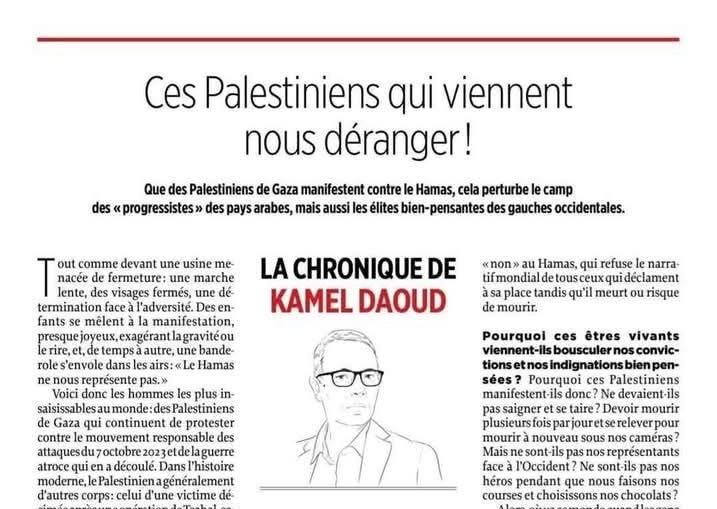Dans le fracas de cette douleur partagée, nos cœurs battent au rythme brisé de Gaza. Les mères palestiniennes versent des larmes salées qui coulent jusqu’en Méditerranée, et chaque tombe creusée résonne comme un cri universel.
Kamel Daoud, l’écrivain franco-algérien au regard de flamme, a pris la parole dans ce tumulte : ses mots incendiaires ont réveillé des colères.
Derrière son combat pour la liberté ― ce flambeau qu’il brandit haut contre les ténèbres des autocraties ― il y a une blessure intime, un amour passionné de l’humain qui vacille entre la colère et la compassion. Pourtant, dans son élan sincère, sa plume parfois malhabile a heurté des sensibilités profondément meurtries.
La réaction du monde arabo-musulman à ses propos a été un torrent de hurlements et de reproches. Dans les rues enfiévrées et les salons feutrés, on l’a traité « d’infidèle », de « traître à la cause » en le renvoyant dos à dos avec ceux qui refusent la paix.
On a crié qu’il méprisait la mémoire des enfants tombés sous les bombes, qu’il foulait aux pieds le deuil des nôtres, parce que les Palestiniens sont les nôtres. Cette fureur, ce rejet sont l’expression d’un chagrin immense : des voix qui se protègent avec l’indignation pour atténuer la douleur. Les critiques pleuvaient, aussi âpres qu’un orage d’hiver : « Tu n’as pas de cœur ! » comme si chaque mot de Kamel Daoud leur crevait un peu plus l’âme.
Pourtant, au-delà des éclats de voix, une tristesse plus silencieuse se fait sentir. Nous savons, au fond, que ces réactions véhémentes trahissent une détresse profonde. Les hommes en noir au bord du chemin de fer, les soldats gominés d’un régime, tous ont érigé la haine en musée de la mémoire, et l’on sacrifie souvent la liberté sur l’autel de la colère.
Dans cette transe guerrière, le bon sens s’efface : nos poètes obscurcissent nos esprits avec des vers guerriers, et nos savants entretiennent la fascination morbide pour la mort en héros.
Le peuple, lui, marche en masse, les poings levés, ivre de ferveur, comme hypnotisé par les martyrs en vitrine. Parfois, il semble oublier que la vie, même brisée, est plus précieuse que la mort exultée.
Et pourtant, ces Palestiniens de Gaza qui osent défier le Hamas sont là pour nous déranger, comme l’a dénoncé Daoud : ils crient leur ras-le-bol, ils refusent de vouloir la guerre qu’on leur impose.
Il faut du courage pour le dire ― et une douleur aiguë pour le ressentir. Kamel Daoud, dans ses textes, n’a jamais caché qu’il plaide avant tout pour la dignité de l’être humain, au-delà des appartenances. Sa boussole morale est plantée dans la liberté, ce désert où tous ― hommes et femmes ― doivent marcher un jour, malgré les mirages autoritaires qui veulent les retenir. Son engagement pour les libertés civiles et l’émancipation en terre arabo-musulmane est noble et constant : il a combattu l’obscurantisme où qu’il se cache.
Mais comment trouver les mots justes quand tant de vies sont brisées ? Parfois ses phrases, tranchantes comme une lame, ont blessé des camarades d’infortune. Sa guerre contre la pensée unique l’a rendu impitoyable ― parfois il broie avec ses mots ceux qu’il voulait secourir. Il a parlé de solidarité piégée et de foules en transe, et dans ce miroir ses compatriotes ont vu un reflet trop cru.
Contre le spectacle des veillées d’os et des collectes de deuil, il s’est élevé, affirmant que l’homme doit être plus que la somme de ses martyrs. Mais cette affirmation, pour certains, est tombée comme une gifle : comment murmurer à quelqu’un de pleurer moins fort, quand chaque souffle semble un au revoir d’espoir ?
Le monde arabo-musulman, alors, a répondu avec passion et peur mêlées. Il a soulevé des doutes sur la fidélité de Daoud à la cause, jugeant qu’un fils de l’Algérie n’a pas à critiquer sa sœur palestinienne. Cette réaction violente, ce rejet de l’étranger au rang de frère, montre à quel point la raison s’effrite face à l’émotion.
Chacun se cramponne à ses certitudes : certains délient des fouets de paroles sacrées, d’autres n’ouvrent même plus la fenêtre de leur âme de peur d’être surpris par la liberté d’autrui. Dans cette joute de mots et de slogans, l’humanité se perd parfois ― ou se gagne, qui sait.
Malgré tout, on sent que la mer des souffrances unit les cœurs au-delà des orages. Il suffit d’une larme pour relier les drames, et Daoud, lui-même, porte au fond de ses yeux la colère de ceux qu’il trouve trop faibles. Il a connu la prison de l’histoire, les promesses brisées, la révolution trahie par ses propres enfants.
Son cri contre la fascination pour la mort résonne comme celui d’un témoin qui voudrait ranimer la flamme vacillante du bon sens. Il ne craint pas de secouer les consciences endormies, même si cela le laisse parfois seul, la nuit, à n’avoir que le silence pour répondre à ses questions.
Ce texte mêle la rage et la compassion : il est parfois rance d’amertume, parfois doux d’espoir. Il rappelle que la solidarité ne doit pas se nourrir du sacrifice de nos voisins comme d’une gloire, et qu’en ces heures noires, la liberté est le dernier rempart contre le désespoir. Entre le refus indigne de certains de voir la vérité en face, et la passion aveuglante de beaucoup pour l’héroïsme et la vengeance, s’étend un chemin étroit : c’est celui où se tiennent, penchés sur les tombes mais tournés vers le ciel, les cœurs honnêtes et douloureux. Parmi eux, Kamel Daoud tente de tracer sa route, imparfaite peut-être, mais fidèle à ce qu’il croit être juste.
Dans cette époque de ténèbres, il y a chez ceux qui l’écoutent une lueur fragile : celle qui, malgré les maladresses du discours, entend résonner l’appel à l’humanité. Alors, au milieu des cris et des silences, on reconnaît l’urgence d’un seul cri qui manque souvent encore : « Assez de morts ! » Que naisse enfin cette prière partagée, que la folie guerrière cède au souffle de la raison – et que puisse s’écrire, en lettres d’espérance, un lendemain où l’on se souviendra des vivants.
Kamel Bencheikh