Mahieddine Khelifa, ancien avocat au barreau d’Alger et passionné de recherches historiques, fait partie de cette rare catégorie d’auteurs capables de s’affranchir des cadres académiques classiques pour proposer une vision originale, parfois dérangeante, de l’histoire. Avec L’épopée berbère – Des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides, publié en 2023 aux éditions Arabesques à Tunis, il signe un ouvrage qui se lit autant comme une enquête minutieuse que comme une fresque ambitieuse.
Le but de Mahieddine Khelifa : replacer les peuples amazighs au centre du récit historique méditerranéen et africain. Une entreprise audacieuse, puisqu’elle retrace un fil continu partant de la préhistoire maghrébine, traversant les bouleversements climatiques du Paléolithique final et du Néolithique, pour aboutir aux fondations mêmes de l’Égypte antique.
Ce livre est d’autant plus remarquable qu’il est préfacé par Ginette Aumassip, éminente spécialiste de l’Égypte ancienne et ancienne directrice de recherche au CNRS. La préface de cette figure reconnue des études berbères apporte un soutien intellectuel majeur à la thèse de Khelifa, soulignant la pertinence et l’audace de sa démarche. L’appui d’une experte de cette envergure confère à l’ouvrage une crédibilité renforcée et témoigne de la qualité scientifique du propos, en particulier dans la relecture des liens entre les civilisations amazighes et égyptiennes.
Pour construire son propos, Khelifa s’appuie sur un vaste corpus d’indices : traces archéologiques, reconstitutions des migrations humaines, études climatiques, et surtout un travail patient sur la toponymie et la linguistique comparée. À ses yeux, l’histoire de l’Afrique du Nord ne commence pas avec Carthage, Rome ou l’islamisation du Maghreb, mais plonge bien plus profondément dans un passé antérieur aux grandes civilisations écrites. À cette époque lointaine, les chasseurs-cueilleurs de Tamazgha centrale vivaient au rythme des cycles de l’eau et des ressources naturelles. La fin du Paléolithique, marquée par une aridification progressive et la réduction des zones habitables, aurait poussé ces populations à migrer vers l’est, le long du futur couloir saharien menant à la vallée du Nil.
C’est précisément dans ce contexte que Khelifa avance une thèse qui bouscule l’historiographie dominante : les premiers bâtisseurs de l’Égypte antique porteraient en eux une part significative d’héritage culturel et linguistique amazigh. Contrairement à la vision classique, qui place le rapprochement entre Imazighens et Égyptiens autour du Xe siècle av. J.-C. avec la dynastie libyenne de Sheshnaq, l’auteur situe cette connexion dès 13 000 ans avant notre ère.
En somme, les racines berbères de l’Égypte ne seraient pas une branche tardive, mais un élément constitutif, présent dès les premières structures sociales et religieuses.
Pour étayer ses affirmations, Khelifa déploie une méthode d’analyse des noms anciens qui surprend par sa cohérence interne. Des toponymes tels que Misra, Amen’as, Siwa, Assouan ou Thinis se voient reliés à des racines amazighes, ouvrant ainsi une relecture linguistique qui révèle des correspondances longtemps négligées. Ce travail ne relève en rien d’un simple jeu étymologique : il s’inscrit dans une démarche globale visant à démontrer la continuité d’une matrice culturelle amazighe, présente non seulement dans l’espace nord-africain, mais aussi dans l’imaginaire et les institutions de la vallée du Nil.
L’ouvrage ne fuit pas la confrontation avec les paradigmes établis. Il propose des interprétations qui, si elles ne font pas l’unanimité, obligent pourtant le lecteur à reconsidérer la manière dont l’histoire est écrite. Dans la presse algérienne, L’épopée berbère a été salué comme un essai « renversant », capable de faire vaciller certaines certitudes solidement ancrées dans les manuels scolaires et la vulgarisation historique. À l’étranger, notamment aux États-Unis, le livre a suscité l’intérêt d’un lectorat curieux, intrigué par cette proposition qui replace le Maghreb préhistorique au cœur des grands mouvements fondateurs des civilisations.
Ce qui frappe au-delà des thèses avancées, c’est la posture intellectuelle de Khelifa. Sans appartenir à une institution universitaire, il revendique une liberté de ton et une capacité à croiser les disciplines que les cadres académiques cloisonnent souvent. Son texte, nourri de sources variées, se situe à la croisée de l’essai scientifique, du récit historique et de la méditation sur la mémoire des peuples. Il ne s’agit pas seulement de replacer les Amazighs dans le passé, mais surtout de questionner les filtres à travers lesquels ce passé nous est transmis : choix des dates repères, hiérarchie des influences culturelles, et place accordée aux traditions orales.
Au final, L’épopée berbère n’est pas une conclusion figée, mais une invitation à un voyage dans le temps long. Que l’on adhère ou non à toutes ses démonstrations, l’ouvrage a le mérite d’ouvrir des portes : celles d’une histoire qui ne se contente pas de raconter la succession des empires, mais qui interroge les continuités profondes, parfois invisibles, entre les peuples et les territoires.
Dans cette perspective, Mahieddine Khelifa apporte un regard neuf et un souffle narratif qui dépassent largement le simple exercice d’érudition. Son propos n’est pas seulement une question de dates déplacées ou de correspondances linguistiques mises en lumière, mais une véritable réhabilitation historique qui restitue aux Amazighs leur rôle d’acteurs majeurs dans l’épopée humaine. Là où beaucoup de récits traditionnels cantonnent l’histoire berbère à une zone périphérique, à un rôle secondaire ou tardif, Khelifa Mahieddine dessine une fresque où ces populations occupent le centre de la scène, traversant les millénaires avec une continuité culturelle remarquable.
Il rappelle que ces hommes et femmes préhistoriques du Maghreb, bien avant l’écriture des annales pharaoniques, avaient déjà parcouru d’immenses distances, franchi les étendues arides du Sahara, et porté avec eux savoirs, mythes et langues. Ces migrations, souvent stimulées par les bouleversements climatiques, ne furent pas de simples déplacements de survie, mais des vecteurs d’échanges, de métissages et de transmissions qui ont profondément marqué les civilisations naissantes.
Arrivés sur les rives fertiles du Nil, ces groupes amazighs n’étaient pas de simples visiteurs ou mercenaires, mais des contributeurs essentiels à la structuration sociale, religieuse et politique de l’Égypte antique. Khelifa voit dans leurs apports linguistiques, certaines pratiques agricoles et des éléments de l’organisation communautaire, les traces d’une influence ancienne, diffuse mais décisive. En proposant cette lecture, il recompose un puzzle où l’Afrique du Nord et la vallée du Nil ne sont plus séparées par des frontières culturelles, mais unies par des passerelles humaines tissées dans la profondeur des âges.
Ce regard transforme profondément la perception même de l’histoire.
Les Amazighs ne sont plus un peuple en marge de la grande aventure humaine, mais l’un de ses fils conducteurs, un trait d’union entre les mondes sahariens, méditerranéens et nilotiques.
Dans cette vision, l’épopée berbère cesse d’être une simple anecdote régionale pour devenir une composante majeure d’un récit global, celui de la formation des premières sociétés complexes et de leur rayonnement.
En redonnant à cette histoire sa densité et sa continuité, Khelifa Mahieddine invite à envisager la Méditerranée et l’Afrique non comme des mosaïques cloisonnées, mais comme un espace vivant, traversé depuis toujours par des circulations et des convergences créatrices.
Dans cet entretien, Mahieddine Khelifa nous livre un éclairage inédit sur les racines profondes des peuples amazighs et leur rôle fondamental dans l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord et de la vallée du Nil.
Avec passion et rigueur, il partage les découvertes qui ont nourri son ouvrage L’épopée berbère, tout en évoquant les enjeux contemporains liés à l’identité, à la mémoire collective et à la construction des sociétés nord-africaines. Au fil de la conversation, il nous invite à dépasser les cadres traditionnels pour envisager une histoire plus ouverte, inclusive et porteuse d’espoir, capable de réconcilier passé et présent dans un dialogue fécond.
Le Matin d’Algérie : Vous êtes avocat de formation. Qu’est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l’histoire ancienne et à entreprendre des recherches aussi approfondies sur les origines amazighes ?
Mahieddine Khelifa : Pour ma part, je reste convaincu qu’un avocat doit avoir une culture générale, au sens large du terme, pour mieux appréhender les problèmes auxquels sont confrontés les gens dans la société. Il sera ainsi mieux armé pour les défendre. J’étais et suis toujours un passionné d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais le déclic dans mes recherches sur les origines amazigh de l’Afrique du Nord a été l’ouvrage d’Arthur Pellegrin intitulé : « Etymologie des noms de lieux d’Algérie et de Tunisie ». Cette étude a été en même temps sa thèse de doctorat soutenue à Tunis en 1949. Ce déclic a été complété par la lecture des écrits de Jean François Champollion qui a eu l’intuition et l’intelligence de comprendre que le mot « Mice » avait un rapport avec la filiation. Mais ne connaissant pas le berbère, il n’a pas fait le lien avec cette langue
Le Matin d’Algérie : Dans L’épopée berbère – Des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides, vous avancez que les liens entre les Amazighs et l’Égypte antique remontent à près de 13 000 ans avant notre ère. Quel événement ou quelle découverte a été le point de départ de cette hypothèse ?
Mahieddine Khelifa : Mes recherches m’ont amené à connaître la découverte de 61 squelettes à la frontière égypto-soudanaise au lieu-dit Djebel Sahaba par une équipe américano-finlandaise. Ces fossiles ont été datés de 13 400 ans avant notre ère et se trouvent actuellement au British Muséum. Ce sont les témoins de nombreuses luttes violentes pour l’appropriation de la ressource en eaux. La majeure partie des chercheurs soutient que la population de l’Egypte antique est venue d’Orient.
J’ai considéré, pour ma part, que ce sont les tribus de chasseurs cueilleurs amazigh qui ont quitté le Maghreb et Sahara centrales (principalement l’Algérie) pour migrer vers la grande rivière située à l’Est suite aux graves crises climatiques survenues à la fin du paléolithique entre 25 000 et 10 000 ans avant notre ère.
Le fait que la quasi-totalité des noms de lieux et de personnages de l’Egypte antique sont des noms à consonance et signification amazighes nous permet de déduire que c’est l’élément amazigh qui a pris le dessus vis-à-vis des tribus sub-sahariennes. Ce qui va à l’encontre de la théorie de Cheikh Anta Diop.
Le Matin d’Algérie : Votre recherche accorde une importance majeure à la toponymie et à la linguistique. Sur quels critères avez-vous choisi les noms anciens que vous analysez, et comment en avez-vous tiré des arguments pour étayer votre thèse ?
Mahieddine Khelifa : Avant la linguistique et la toponymie il y a la géographie. Aucune frontière naturelle ne sépare les régions allant de l’Atlantique à la mer Rouge. Cet élément n’a pas été pris en considération par les égyptologues et orientalistes qui ont érigé une frontière imaginaire, pour ne pas dire dogmatique, entre l’Egypte antique et le reste de l’Afrique du Nord. L’étude réalisée par Arthur Pellegrin constitue une mine d’or dans la mesure où l’enquête de cet auteur a été effectuée auprès des anciens (Imgharen) des villages pour connaitre l’étymologie des noms de lieux d’Algérie et de Tunisie.
Dans cette étude minutieuse, on trouve la signification de Djer, Djer-Djer (Djurdjura) grand géant, Amjer (comme un géant) dans le Tassili, Il, Ilel cours d’eau, Nil, que j’ai décomposé en N’il, diminutif de Nath-il , ceux de la rivière ; Ténès ou Tunis, campement bivouac en berbère ancien, qui a donné Thinis, Tanis dans l’Egypte antique.
Mon intérêt pour l’histoire de l’Egypte antique m’a permis de faire les rapprochements et les liens entre Mn-Fr (Amen Effer à l’abri des eaux) déformée par les Grecs en Memphis, avec Frenda, Ifri, Ifran, Tafraoui (qui font tous référence à l’abri, la grotte ; et Mezghouna avec Amazigh, Mezghena et Mizrana, etc…
Le Matin d’Algérie : Vous remettez en cause la chronologie classique qui situe les contacts majeurs entre Amazighs et Égyptiens à l’époque de Sheshnaq. Quelles résistances avez-vous rencontrées face à cette réinterprétation ?
Mahieddine Khelifa : Ce sont les populations de chasseurs cueilleurs amazigh qui ont été à la base du peuplement de l’Egypte antique et les noms de lieux et de personnages sont là pour accréditer cette thèse. A commencer par le mot Amen (les eaux) et Anekhi (je suis ou c’est moi) qui a donné le nom d’Anekhi Adon déformé par les Grecs en Akhenaton.
Dans la religion hébraïque Anekhi est le mot des mots car c’est par ce terme que Dieu s’est adressé à Moïse en lui disant « Anekhi yahvé Aléhoka » (Je suis Yahvé ton Dieu) c’est tiré de la Thora, je n’invente rien !
Donc réduire le lien entre les Amazigh et la civilisation de l’Egypte antique à Sheshnaq alors qu’ils sont à l’origine de l’une des plus grandes civilisations de l’histoire de l’humanité, c’est faire une injure à l’endroit du peuple Amazigh et de son histoire plurimillénaire.
C’est la raison pour laquelle je fais démarrer le calendrier amazigh à la fondation de la première dynastie pharaonique en 3150 av. J.-C. Nous sommes donc en 5175 de l’an Amazigh !
Pour le moment je n’ai pas rencontré de résistance mais plutôt des encouragements de la part du Professeur Mounir Bouchenaki, ancien Directeur Général Adjoint de l’UNESCO, du Professeur Nadjib Ferhat, Docteur en préhistoire et de nombreux internautes au travers leurs commentaires à l’occasion des vidéos que j’ai réalisées sur la question.
Le Matin d’Algérie : L’archéologie et l’histoire officielle se basent souvent sur des sources écrites. Comment convaincre que la mémoire orale et les indices linguistiques peuvent être aussi fiables ?
Mahieddine Khelifa : J’ai indiqué les sources écrites que sont Pellegrin, Champollion déchiffreur des hiéroglyphes, qui a relevé que cette écriture sacrée n’avait pas de voyelles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je considère que les égyptologues ont fait une grossière erreur en déformant Amen (les eaux) par Amon alors que toute la vie de cette civilisation était basée sur l’eau. Le nom d’une quarantaine de pharaons, toutes dynasties confondues avait pour préfixe ou suffixe le mot Amen. En outre, Moïse, lors de la traversée du Sinaï demandait à ses fidèles de ponctuer ses prières par le mot Amen qui signifie « les eaux » et non « ainsi soit-il »
Le Matin d’Algérie : Votre livre a suscité un écho jusqu’aux États-Unis. Selon vous, qu’est-ce qui explique cet intérêt international pour l’histoire amazighe ?
Mahieddine Khelifa : Pas qu’aux Etats Unis. Au Canada aussi où vit une importante communauté amazighe. Pour les Etats Unis, c’est l’étymologie du mot Memphis qui a dû susciter un intérêt pour « L’épopée Berbère ». Il existe aux USA six villes qui s’appellent Memphis. Comme je l’ai mentionné tout à l’heure, Memphis est la déformation grecque de Mn-Fr, autrement dit Amen Effer, caché ou protégé des eaux.
C’est le premier Pharaon « mn-s » Amenas, ses eaux à lui, que nous retrouvons à l’origine dans le Sahara algérien au lieu-dit In Amenas qui a ordonné que soit édifiée une cité à l’abri des eaux du N’il. Cette explication se tient d’autant qu’elle a été racontée par le grand prêtre historien des dynasties pharaoniques Manéthon (Amen Adon). C’est ainsi qu’une radio de la ville de Memphis Tennessee a eu la géniale idée de donner à ses auditeurs un aperçu de mon ouvrage « L’épopée berbère »
Le Matin d’Algérie : En quoi la préface de Ginette Aumassip renforce-t-elle la crédibilité de votre ouvrage ?
Mahieddine Khelifa : Pour les spécialistes en histoire du Sahara préhistorique et de l’Afrique, Madame Ginette Aumassip, n’est pas à présenter. Ex-directrice de Recherches au CNRS (Paris) et Professeur émérite des universités, son parcours et son intérêt pour la préhistoire du Sahara a permis la publication de dizaines d’articles dans des revues spécialisées ainsi que d’ouvrages sur le sujet. Voici l’un des mails qu’elle m’a envoyés :
« Super ce texte. Il est des morts qui vont festoyer, je pense à Leclant et Huard les premiers à faire intervenir l’Afrique à la grande joie de Diop. Vous enfoncez le clou de manière définitive et redonnez leur place « aux Berbères »
Bonne journée.
Très cordialement
G.A.
Elle m’a appris que l’ouvrage qu’avaient rédigé Leclant et Huard avait été écarté par des grandes maisons d’éditions car ces chercheurs avaient fait un lien entre le Sahara et l’Egypte antique et cela n’avait pas plu à la “secte” des égyptologues.
Ces deux chercheurs se sont donc adressés à Mouloud Mammeri qui a publié leur ouvrage en deux volumes au CRAPE. C’est un scoop que je donne à votre journal…
Le Matin d’Algérie : Si vous deviez résumer en une phrase l’apport des Amazighs à la civilisation humaine, quelle serait-elle ?
Mahieddine Khelifa : La toponymie des noms de lieux et de personnages de l’Egypte antique nous permet de déduire que les tribus de chasseurs cueilleurs Amazigh sont à la base du peuplement de la vallée du N’il et, par conséquent, de l’une des plus grandes civilisations de l’histoire de l’humanité.
Le Matin d’Algérie : Pensez-vous que la connaissance approfondie de l’histoire, notamment celle des peuples amazighs, puisse contribuer à l’évolution des sociétés nord-africaines, particulièrement dans des contextes où la liberté d’opinion est souvent limitée ?
Mahieddine Khelifa : L’étude approfondie de l’histoire, et plus spécifiquement celle des peuples amazighs, est un levier puissant pour le développement des sociétés nord-africaines. La connaissance de l’histoire des peuples amazighs permet aux citoyens de ces pays de s’approprier un passé riche et souvent occulté. Plutôt que de se voir imposer un récit unique, ils peuvent découvrir une histoire plurielle, faite de résistance, d’organisation sociale complexe, de productions artistiques et de traditions.
Cette réappropriation du passé est un acte d’émancipation. Elle permet de construire une identité solide et encourage le développement d’un esprit critique.
L’histoire amazighe révèle la grande diversité des cultures en Afrique du Nord. En apprenant cette histoire, les citoyens peuvent voir comment ces identités coexistent depuis des millénaires. Cela peut contribuer à promouvoir la tolérance et le respect mutuel, en brisant les stéréotypes et en démontrant que la diversité n’est pas une faiblesse, mais une force.
Comprendre que leur société a toujours été un carrefour de cultures peut aider à rapprocher les peuples de la région de l’Atlantique à la mer Rouge.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Mahieddine Khelifa : Je viens de terminer la deuxième édition enrichie de plusieurs chapitres de « L’épopée berbère », de même que j’ai finis un nouvel ouvrage intitulé « Le fou du village, Cheikh M’hand Ou Avva »
Le Matin d’Algérie : Un dernier mot peut-être ?
Mahieddine Khelifa : Merci au Matin d’Algérie pour cette initiative qui contribue, par cette interview, à une meilleure connaissance de l’histoire de notre pays qui plonge ses racines dans des profondeurs insoupçonnées
Entretien réalisé par Brahim Saci
L’épopée berbère, éditions Arabesques. Tunis – 2023





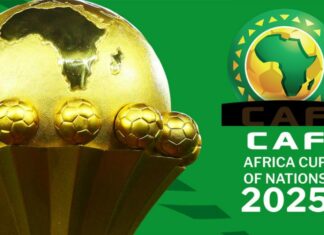





Seul un pays qui se dit exclusivement Amazigh et dont la langue officielle est tamazight, defendras tamazight, la culture Amazigh, le territoire Amazigh, l’agenda Amazigh, redorereras l’histoire Amazigh et defendras l’agenda Amazigh sur le plan international. Le reste c’est du bidon ! Rien a attendre de ceux la meme qui vous ont colonises et decider de votre disparition, car c’est ce dont on parle en ce moment : la diaparition a petite dose
Il est louable de vouloir valoriser le peuple berbère et son histoire, mais il ne faut pas tomber dans la mythologie purement fictive. Ces éléments étymologiques ne tiennent pas du tout la route. Je ne vais pas m’étaler là-dessus, mais quiconque veut vérifier n’a qu’à faire une petire recherche sur l’histoire et l’étympologie de tous ces noms.
J’ai une proposition à mes frères kabyles et autres algériens. : partout dans le monde, les peuples cherchent à se glorifier de hauts faits et d’accomplissements historiques. Et si nous, Kabyles et algériens, faisions de l’absence d’intérêt pour ce genre de vanité justement ce qui nous distingue ? Au diable les conquêtes et les exploits historiques ! Nous sommes ce peuple qui s’enorgueillit de sa liberté de pensée, de sa simplicité, et de son rapport authentique à la vie, sans avoir besoin de glorifier le passé.
Ça aurait au moins le mérite d’être original et authentique.
Tout sauf ca justement. Il ne y a plus rien d’authentique. L’authenticite’ n’est pas etre fige’ dans le temps, mais evoluer de maniere organique et non artificielle.
Nous avons une histoire ou du moins une apprehension de celle-ci toute zigzague’e – alors qu’il existe une une courbe evolutive sans inflections majeures, meme quand il y a des evenements qui en suggerent.
Ce que fait Mr Khalfa est une espece de synthese de divers travaux de recherche de par la planete. Des obersavations soulevent des questionnements et ce n’est qu’avec ce type de procede’s – de synthese – absence d’autres voies, que nous pourront reconstruire et preserver, pour ne pas dire CONTRER les efforts consentis dont le but n’est autre que notre effacement de l’histoire humaine a travers des syntheses et conclusions vicieusement concocte’es.
je ne sais si c’est de Mr Khalif ou l’auteur de l’essai, mais en parcourant je tombe sur ceci, enfoui au milieu: « Contrairement à la vision classique, qui place le rapprochement entre Imazighens et Égyptiens autour du Xe siècle av. J.-C. avec la dynastie libyenne de Sheshnaq, l’auteur situe cette connexion dès 13 000 ans avant notre ère. – La nature de l’INTERRACTION n’est pas encore etablie. La purete’ genetique, c.a.d. absence totale d’affiliation genetique de 2 femmes dans leur 30ains trouve’es a la frontiere Algero-Lybienne datant de 7000 avant notre ere suggere une autre lecture que de la « connection et echange » ou pire, il parle de transmission et metissage – quand le genomes de ces femmes AFFIRME le contraire – je cite: : « Ces migrations, souvent stimulées par les bouleversements climatiques, ne furent pas de simples déplacements de survie, mais des vecteurs d’échanges, de métissages et de transmissions qui ont profondément marqué les civilisations naissantes. » Parcontre lointaines de pres de 300 000 ans de l’homme de Jebel Ihud dans l’Atlas Marocain, ces meme femmes partage le lineage genetique, qui les fait des descendantes. Et pourtant la distance qui les eloigne de l’Atlas Marocain est un multiple de celle qui les eloigne d’Egypte.
Les structures de vases retrouve’s au Maroc et quelque part dans le desert Algerien montre une difference majeure dans la conception – particulierement la presence d’une technique de raccordement des mains d’une cruche horizontales, contrairement a celles trouve en Egypte et au Levant qui sont verticales. Les les courbes des lignes de contact sont de 2 degre’s de finesse differents. Il n’y aura donc meme pas eut d’echange d’objets pour suggerer un echange d’interet/commmercial.
Le fait que les migrations du levant auront atteint le Portugal du cote’ Europeen(nord) de la Mediteranne’e mais pas de l’autre(sud), me dit qu’il y a plutot barrage et conflit. Certe la valle’e du Nile etait fertile, mais le grand Sahara l’etait encore plus ! Le Fleuve Tamanrasett etait tres tres alimente’ de l’Atlas.
Autre les differents dechiffrages de differents textes, l’Archeologie a aussi trouve’ des ossements et de la matiere organique datable ainsi que des artifacts dans notre Sahara et au Maroc. Ces trouvailles racontent une autre histoire de maniere indeniable qui defient les scenarios d’une certaine ecole d’egyptologistes interesse’s plus par la reconstruction d’un certain narratif biblique qu’une interpretation objective de ce qui se presente. Bref les histoires construite autour de l’histoire ancienne de l’egypte et des pyramides meme est ouvertement remise en cause avec preuves a la main.
Pour ce qui est du texte cite’, et specifiquement « l’auteur situe cette connexion dès 13 000 ans avant notre ère. » – Sur quelle base parle-t-il de « CONNECTION ». Je crois vraiment au scenario du conflit, vers les frontieres egypto-lybiennes au nord, ou l’eau qui alimente la vallee cote’ Egyptien arrive de Lybie justement, comme l’explique bien le geologue Randall Carlson. L’archeologie d’interet vraiment est encoure enfouie sous les dunes avec la vaste majorite’ dans les debrits le long de la cote.
https://www.youtube.com/watch?v=LOtydLmdfV8
Bonjour Monsieur . Prière lire le commentaire que j’ai posté le 30 août dans ce même site où je donne un peu plus de détails sur ma démarche. Merci
De la à coffrer l’auteur pour apologie de terrorisme, il n’y a qu’un pas que le régime changriha peut franchir
L’archéologie du langage, j’ai rencontré ce terme à la lecture de ‘La cité antique’ de Fustel de Coulanges.
C’était une reconstitution de l’histoire des cités de la Grèce préclassique; d’avant l’écriture donc. Il s’est appuyé sur les éléments de langage des récits anciens anciens consignés par écrits des siècles plus tard comme l’Iliade, l’Odyssée d’Homère, Les travaux et les jours d’Hésiode notamment.
L’idée est qu’il est possible d’écrire l’histoire en adoptant également d’autres méthodes adaptées à d’autres types de matériaux que ceux de l’histoire classique. L’oralité – la mémoire collective, la toponymie, l’anthroponymie, la religion, la culture matérielle et immatérielle, l’approche comparative peuvent fournir les éléments d’écriture de l’Histoire.
On peut ne pas avoir de noms, mais on peut faire l’histoire du système politique kabyle, berbère, en recourant à la comparaison.
Nous ne demondons rien.
Ils ne rendront rien.
NOUS REPRENDRONS TOUT CE QUE NOS ANCETRES ONT FAIT DURANT LES 5000 ANS D’HISTOIRE !
Pour commencerL INDÉPENDANCE DE LA KABYLIE.
J’ai cherché partout cet ouvrage : aussi boen en France qu’en Algéroe, je ne l’ai trouvé nulle part. J’ai même chargé un collègie tunisoos de me le procurer, sans succès.
Où peut-on se le procurer ? Poirquoi il ne se vend pas là où il a plus de chance d’être lu ?
Et pourquoi une maison d’édition tunisienne ? Est-ce à dire qu’une édition algérienne n’a voulu le publier ?
Cher Monsieur, l’ouvrage L’épopée Berbère, des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides est en vente à la Libraire Cheikh de Tizi Ouzou, à Béjaia à la Libraire Hassissen, à Alger à la librairie Kalimet, Les beaux Arts, El Ijtihed (rue Hamani) L’arbre à Dires à Sidi Yahia.
Le travail de M. Khelifa est d’une grande importance, débarrassé des dogmes idéologiques ou ethnologiques. C’est la toponymie des lieux dans le Sahara en cours de géographie au collège qui a éveillé ma conscience de la continuité de la langue entre ma Kabylie et le Sahara. M. Khelifa a été plus loin et il est vrai que l’onomastique égyptienne révèle beaucoup de liens avec les Amazighs.
Vous dites » ce sont les tribus de chasseurs cueilleurs amazigh qui ont quitté le Maghreb … »
Libellez d’abord les régions géographiques par leurs véritables NOMS et non pas user »MAGHREB » ??? négateur et COLONIALISTE biscepale…
Commencez d’abord par ce niveau … après on verra …
Cher Monsieur, l’ouvrage L’épopée Berbère, des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides est en vente à la Libraire Cheikh de Tizi Ouzou, à Béjaia à la Libraire Hassissen, à Alger à la librairie Kalimet, Les beaux Arts, El Ijtihed (rue Hamani) L’arbre à Dires à Sidi Yahia.
Khelifa Mahieddine : « Par leur méconnaissance de la langue berbère, les égyptologues ont déformé le mot Aman en Amon »
Brahim Saci
Brahim Saci
21 août 2025 à 19:09
khelifa mahieddine égyptiens berbères
Khelifa Mahieddine est l’auteur du livre « L’épopée berbère : des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides », paru en 2023 aux éditions Arabesques à Tunis. Photo DR
Dans cet entretien, Khelifa Mahieddine nous invite à une réinterprétation radicale de l’histoire, en dévoilant les liens étroits qu’il établit entre les mathématiques des anciens Égyptiens et les peuples berbères.
Khelifa Mahieddine révèle comment une analyse de la linguistique et de la toponymie peut bouleverser notre compréhension des origines de la civilisation des anciens égyptiens qu’il relie aux berbères.
Dans son livre, L’Epopée berbère, paru en 2023 aux éditions Arabesques à Tunis, Khelifa Mahieddine part de l’idée que les « Mis-Ra » (les fils de Ra en berbère), les anciens égyptiens, étaient des descendants de tribus de chasseurs-cueilleurs berbères. Ces tribus, selon lui, auraient migré depuis le Maghreb et le Sahara, apportant avec elles des connaissances ancestrales.
La préface signée par Ginette Aumassip, une figure éminente dans les domaines de la préhistoire et de l’archéologie saharienne, confère une crédibilité scientifique importante à son travail. En effet, la participation d’une ancienne directrice de recherche au CNRS est perçue dans le milieu académique comme une reconnaissance de la pertinence et du sérieux de la thèse de l’auteur.
En somme, Khelifa Mahieddine nous invite à un voyage de redécouverte, où l’analyse des langues et des mathématiques peut redonner aux peuples du Maghreb la place qui leur revient dans les origines des grandes civilisations.
Entretien réalisé par Brahim Saci
Diasporadz : Khelifa Mahieddine, il faut dire que votre livre propose une thèse audacieuse sur les origines berbères de la civilisation des anciens Egyptiens. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion et quelles sont les principales sources historiques ou archéologiques sur lesquelles vous vous appuyez, en dehors de la linguistique que vous mentionnez ?
Khelifa Mahieddine : Les égyptologues et orientalistes ont, depuis la Grèce antique (Hérodote), érigé une frontière imaginaire et dogmatique sur les plans ethnique, culturel, linguistique et historique entre l’Egypte antique et le reste de l’Afrique du nord géographique. Cette frontière imaginaire tracée entre les peuples frères de l’Afrique du Nord géographique a encore de fervents adeptes qui ne peuvent se départir de leur complexe et de leur vision de l’Histoire avec des œillères occidentales et néocoloniales. Pour remettre l’histoire à l’endroit, je me suis attelé à entreprendre cette décolonisation de l’histoire des Amazigh (Berbères) pour la décomplexer de son prisme gréco-romain.
Mon ouvrage a donc consisté à recadrer l’histoire de l’Afrique du Nord dans son véritable contexte géographique et historique. Cette nouvelle vision de l’histoire des Berbères est une remise en cause fondamentale des préjugés et aprioris existant depuis la Grèce et la Rome antique et qui perdurent à ce jour chez certain(e)s historien(ne)s, zélateurs de l’Occident.
En fait, cette thèse se base sur une vision nouvelle de l’égyptologie à travers la toponymie, les noms de personnages et vocables soulignant de troublantes similitudes avec la langue berbère. Il accrédite l’hypothèse d’une migration de populations de chasseurs cueilleurs du Maghreb et Sahara centrales, principalement de l’Algérie, vers la grande rivière située à l’est de l’Afrique septentrionale, suite aux graves crises climatiques survenues dans cette région entre 25 000 et 10 000 ans avant notre ère.
N. Grimal, archéologue et historien, fait référence à cette transhumance dans une préface à l’ouvrage « Du Sahara au Nil ». Je le cite : « L’un des déserts les plus arides au monde rappelle qu’il fut peuplé jadis d’êtres qui avaient déjà fixé les lois premières de ce qui sera l’une des plus longues civilisations de la terre. Une fois réalisée la transhumance ultime vers les rives qui bordent le Sahara naissant, le départ sans retour pour fuir l’aridité et gagner l’oasis permanente du Nil… »
De même, dans son article sur « Les sources de la civilisation pharaonique », l’archéologue S. Seidlmayer fait un lien étroit entre l’évolution de l’homme et les conditions climatiques : « L’Egypte montre de manière exemplaire combien l’évolution des hommes est liée aux conditions géographiques et climatiques de leur environnement. La vallée du Nil apparait comme une oasis fluviale enserrée par les déserts : à l’ouest s’étend le vaste Sahara, à l’Est s’étirent les chaines montagneuses escarpées qui séparent l’Egypte de la mer Rouge. Seul un étroit passage au nord-est, au niveau de la côte septentrionale du Sinaï, permet l’accès à la Palestine et au Proche-Orient. »
Dans ce même article, S. Seidlmayer situe les origines du peuplement d’Egypte au début du paléolithique : « La découverte d’outils en pierre dans la vallée du Nil situe les traces de peuplement humain au début du paléolithique. A cette époque, l’Egypte ne présente pas encore les traits d’une culture singulière ; il faut attendre le paléolithique final, entre 25 000 et 10 000 av. J.-C. pour en trouver les premiers témoignages. Une période d’extrême sécheresse conduit alors les chasseurs cueilleurs qui arpentaient les savanes du Sahara à rejoindre le cours du fleuve encore faible et irrégulier pour y trouver leur subsistance ».
Quant à Madame Ginette Aumassip, ex-Directrice de Recherches au CNRS, spécialiste de l’Afrique et du Sahara préhistorique, elle relève dans son ouvrage « Le bas Sahara dans la préhistoire » que, je cite : « En fait, c’est à la fascination exercée le siècle dernier par l’Egypte, son admirable civilisation, bien plus qu’à des arguments que l’on doit l’idée d’origine égyptienne du Néolithique saharien. Comparé à l’Egypte, le Sahara devient, ainsi qu’a pu le souligner Zaboriwski, d’une pauvreté relative. Par les identités qu’elles montrent, ces quelques pièces ne peuvent résoudre la question des rapports avec la vallée du Nil. Leur rareté n’est en aucun cas garante d’une absence de convergence. Elle exclut l’idée de colonisation, amoindrit celle d’influences, mais ne saurait écarter celle de contacts dont l’époque ne peut être précisée. »
Dans un autre ouvrage intitulé « Trésors de l’Atlas », G. Aumassip relève : « S’appuyant sur les similitudes entre le bélier à sphéroïde et bélier d’Amon, certains auteurs trouvaient en Egypte les Sources de l’art de l’Atlas. R.Vaufrey, St. Gsell, H. Obermaier le professèrent. Cette hypothèse se heurte à la jeunesse relative du culte d’Amon en Egypte que l’on situait entre 3000 et 2000 ans av. J.-C. Dans un cas comme dans l’autre, l’hypothèse d’une origine égyptienne ne résiste pas aux données chronologiques dont on dispose actuellement pour les industries néolithiques. »
L’origine de la population berbère dans toute cette région de l’Afrique septentrionale allant de l’Atlantique à la mer Rouge est confirmée par Yves et Christine Gauthier dans leur ouvrage « Des chars et des tifinagh ». Ces chercheurs font référence à la présence de plusieurs milliers de sites rupestres dans toute cette région. Ils relèvent que « plus de 6000 sites rupestres (gravures et peintures, inscriptions libyco-berbère comprises) ont été localisées depuis l’Atlantique jusqu’à la mer Rouge et de l’Atlas Saharien jusqu’au Sahel … ». « Quelques sites très dispersés sont recensés dans le désert libyque, mais il faut aller jusqu’à la vallée du Nil pour observer à nouveau des densités plus élevées de sites, dont beaucoup apparaissent dans un contexte pharaonique. ». « Les inscriptions libyco-berbères sont, parmi d’autres, d’excellents indicateurs de présence de ces populations car elles définissent, mieux que les textes historiques, les limites de ce domaine berbérophone à travers les âges. »
Voici, de manière très succincte et non exhaustive, quelques sources écrites et archéologiques que j’ai complétées en faisant référence à la linguistique qui cloue de manière définitive la berbérité de l’Egypte antique et même actuelle. N’en déplaise aux diviseurs des régions et des peuples !
Diasporadz : Vous faites un lien direct entre le nom « Mis-Ra » et le mot amazigh « awragh ». Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la démarche linguistique qui vous a permis d’établir ce rapprochement et comment vous l’avez vérifié ?
Khelifa Mahieddine : La première erreur des égyptologues a été d’ignorer la véritable appellation de ce pays identifié comme « Aegyptos-Egypte » par les auteurs de la Grèce antique, par déformation du nom de l’antique ville de Gueptou, devenue au fil du temps Coptos/Koptos. Les habitants de cette cité, désignés sous le nom de Coptes, bien qu’ayant été christianisés plus tard, dans leur très grande majorité, se sont toujours définis et se définissent à ce jour, à l’instar du reste de la population de ce pays, comme étant des Mis-Ra (pluriel en arabe : Misrayin et Misraïm pour les hébreux), c’est-à-dire des fils de la divinité Ra.
À vrai dire, c’est Champollion qui m’a mis sur la piste lorsqu’il a déchiffré le cartouche de « Ramsès » en le décomposant en Ra, divinité solaire, et Msès, en relation avec la filiation à cette divinité, par intuition. Tous les Algériens, sans exception, savent ce que veut dire « Mis tmorth ». C’était donc pour moi une évidence. Ce n’est que plus tard que j’ai découvert qu’il existait une tribu des Ath Misra parmi les treize tribus berbères vivant dans les montagnes de l’Atlas blidéen depuis les temps les plus reculés. A des centaines de kilomètres de là, nous avons la commune de Mesra, non loin de Mostaganem qui fait, elle aussi, référence aux fils de la divinité Ra.
Pour ce qui est de Ra, j’ai pris en considération le fait que dans nos montagnes, on fait une abréviation de tous les noms : « Fa » pour Fatma, « Sa » pour Saliha, « Fa » pour Farida, « Moh » pour Mohamed, N’ pour Nath (pronom de l’appartenance) etc. C’est donc en cherchant la source de l’appellation de Ra, qui désigne l’astre solaire, que j’ai fait le rapprochement avec Awragh qui signifie jaune, blond, étincelant, et par extension brulant. Or, s’il y a bien une chose qui réunit ces qualificatifs, c’est bien le Soleil. En prenant en considération le fait que la quasi-totalité des noms de lieux et de personnages de l’Egypte antiques proviennent à l’origine, je dis bien à l’origine, de nos contrées (principalement l’Algérie), j’en ai déduit que Ra était bien le diminutif du mot Awragh. Il n’y a pas de hasards dans l’histoire de l’humanité et tous les éléments de langages ont une origine et une explication.
Par leur méconnaissance de la langue berbère, les égyptologues ont déformé le mot « Aman » (les eaux) en « Amon ». Ceci s’explique en outre par le fait que les hiéroglyphes ne comportent pas de voyelles. Ils ont relevé que les anciens égyptiens appelaient le Nil « Itérou ». Selon eux, le mot « itérou » désignait un dieu lunaire protecteur de la famille royale. Or, de par le lien que je fais avec la langue Amazigh, j’en ai déduit que « itérou ou itrou » veut dire « Il pleure » ! Ce qui s’explique parfaitement dans la mesure où « Amen » désignant « les eaux » était sacralisé par les descendants des tribus de chasseurs cueilleurs amazighs, au point d’en faire un dieu du nom de « Aman ». Et Quand le dieu Aman (et non Amon) pleure, « itérou », ses larmes se transforment en des flots ininterrompus. Le lien avec l’eau devient évident pour des populations qui ont connu les affres de la sècheresse dans leur région d’origine les obligeant à migrer vers la grande rivière qu’ils se sont appropriée en l’appelant « N’il » (le Nil, ndlr).
Diasporadz : Le chiffre 12 occupe une place centrale dans votre analyse, de l’astronomie égyptienne aux religions monothéistes. Selon vous, cette adoption par d’autres cultures est-elle une coïncidence ou une preuve d’une influence historique directe des « Mis-Ra » ?
Khelifa Mahieddine : C’est l’observation durant des siècles de la régularité périodique des crues du Nil qui revenaient chaque année après 12 apparitions de Lune, qui a fait comprendre aux prêtres du pays des Mis-Ra (Egypte), l’importance qu’il fallait accorder au chiffre 12. Ils avaient constaté que c’est en 12 lunaisons que la Terre fait une révolution complète autour du Soleil. Le chiffre 12, considéré comme sacré et divin par les anciens Mis-Ra, explique la raison pour laquelle la dépouille mortuaire du pharaon était portée par 12 notables et qu’ils ont fait figurer le même nombre dans les signes du Zodiac. Ce chiffre 12 a été repris également dans la Thora, écrite et compilée entre le VIIe et IIe siècle av. J.-C, soit plus de 6 siècles plus tard, par les descendants des prêtres monothéistes, suite à l’exode de l’Egypte vers la terre de Canaan, aux environs de 1350 av. JC, en évoquant les 12 enfants de Yacoub (Jacob) qui sont aussi à l’origine des 12 tribus d’Israël.
De même, on retrouve ce chiffre dans le Nouveau Testament où il est question des 12 apôtres de Jésus-Christ, repris symboliquement par le drapeau européen, en faisant figurer 12 étoiles, pour faire référence, de manière camouflée, au christianisme. C’est dire l’influence qu’a eu la civilisation de l’Egypte antique sur les civilisations ultérieures qu’elle soit grecque, romaine et plus tard occidentale.
C’est en tenant compte des observations liées au cycle des astres, durant des siècles, que les Mis-Ra ont eu l’intelligence de partager la journée en 12 parties égales et, par symétrie, la nuit en autant d’intervalles, sans tenir compte de la longueur des jours et des nuits durant les saisons. De même, la confection de la corde égyptienne à 13 nœuds et 12 intervalles a permis aux Mis-Ra de concevoir le seul triangle rectangle à côtés entiers avec une hypoténuse minimale à progression arithmétique : 3, 4, 5, qui donne en les additionnant le chiffre 12 et à suite géométrique : 3 X 4 X 5 = 60.
Voici pourquoi les Mis-Ra ont décidé de partager le temps en heures de 60 minutes et la minute en 60 secondes. Tout comme la planète en degrés, minutes et secondes d’arc. Tout cela à partir du nombre 12 tiré de la nature, c’est-à-dire des 12 lunaisons d’une crue à l’autre du Nil. On peut dire donc que le chiffre 12 était la pierre angulaire des mathématiques égyptiennes. Il a influencé de manière significative la façon dont nous mesurons le temps et les angles aujourd’hui. C’est donc en se basant sur la nature, que les anciens fils de la divinité Ra ont synchronisé, non seulement le temps avec le mouvement des astres, mais également avec la mesure. C’est la raison pour laquelle ils étaient appelés « les maitres de la mesure et du temps » par les savants de la Grèce antique.
Diasporadz : Vous affirmez que les Grecs se sont approprié le nombre Pi et le nombre d’or. Pouvez-vous nous donner des exemples de documents ou de découvertes qui, selon vous, prouvent que les Égyptiens possédaient déjà ces connaissances mathématiques avant les Grecs ?
Khelifa Mahieddine : Ce sont ces données géométriques et mathématiques et notamment la corde à 13 nœuds qui sont à l’origine du théorème de Pythagore, que l’historien Hérodote considérait comme « l’un des plus grands esprits de la Grèce » et que Hegel disait de lui qu’il était « le premier maitre universel », alors qu’il avait passé 22 années à étudier la géométrie et les mathématiques auprès de ses maitres du pays des Mis-Ra, de la même manière que tous les savants de la Grèce antique. Il ne faut occulter le fait que lorsque la Grèce était dans les ténèbres, la civilisation de l’Egypte antique brillait de mille feux et ce, plus de 2000 ans avant l’émergence de la civilisation hellénique. En effet, l’apogée de cette civilisation est traditionnellement située à l’époque classique de 500 à 323 av. J.-C. alors que la Grande Pyramide date de 2500 ans av. JC.
La Grande Pyramide contient dans les rapports entre certaines de ses dimensions le nombre 3,1416, le nombre d’or : 1,618 et d’autres découvertes en lien avec la dimension et la vitesse de rotation de la Terre. Sans entrer dans le détail de ces calculs, il est par exemple relevé par certains mathématiciens et astronomes que la hauteur de la pyramide (280 coudées de 0,5236 m soit 146,6 mètres) correspond à une fraction du rayon polaire de la Terre tandis que sa base est liée à la circonférence de la Terre.
L’occident a cherché à faire accroire que le nombre 3,1416 avait été découvert par Archimède. C’est ce qu’on nous a enseigné dans les écoles depuis notre jeune âge. Or, il se trouve que cette coudée d’exactitude mesure 0,5236 et se décompose en 28 doigts de 1,87 cm chacun (28 X 1,87 = 0,5236). Alors pourquoi l’Occident cherche-t-il à nous faire croire que la dimension de la coudée varie de 52,3 à 52,5 cm, alors que la coudée étalon qui se trouve au musée du Louvre donne la valeur exacte de 0,5236. Cette erreur est voulue et calculée par l’Occident qui cherche à effacer le rapport flagrant existant entre la coudée d’exactitude et le nombre 3,1416 ainsi que le nombre d’Or, 1,618 ! De même, la coudée nilotique servant à calculer la montée des eaux du Nil a été calculée sur la base du nombre d’or, soit 1,618 : 3 = 0,5393m.
Les anciens Égyptiens ont mis en place un calendrier civil qui était basé sur des observations astronomiques et des croyances religieuses. Le découpage de l’année en 360 jours plus 5 jours supplémentaires qualifiés d’épagomène (maléfiques) est le résultat de ce système. Ce sont les observations des astronomes du pays des Mis-Ra qui ont créé, dans un premiers temps, un calendrier de 12 mois de 30 jours = 360 jours. Ils ont cependant observé que le lever héliaque de l’étoile Sirius, c’est-à-dire le moment où elle réapparaissait à l’horizon juste avant le lever du soleil, coïncidait avec le début de la crue du Nil, l’événement le plus important de l’année pour leur agriculture. Leurs observations ont montré que le cycle de Sirius durait environ 365,25 jours. Cependant, comme cela faussait la division de la planète en 360°, ils ont décrété que les 5 jours supplémentaires étaient maléfiques.
Pour connaitre le rapport existant entre la coudée d’exactitude, le nombre d’Or (Phi), le mètre et la taille de la planète Terre, il faut rappeler que la Terre est divisée en 360 degrés, chaque degré est divisé en 60 mn d’arc, chaque minute en 60 secondes d’arc. Ce qui donne une mesure moyenne de 30,9 mètres pour une seconde d’arc. Or, lorsque l’on divise 1000 fois le nombre d’or soit 1618 mètres/30,9 = 52,36 secondes d’arc. Soit 100 fois la coudée d’exactitude ! (Ces calculs sont de Mr Quentin Leplat).
C’est l’observation de l’ombre de la terre sur la Lune qui a fait comprendre aux astronomes égyptiens que la terre était une sphère car il est connu que l’ombre d’un corps reproduit la forme de ce corps. Donc contrairement à ce qui est affirmé par certains historiens occidentaux, ce n’est pas le grec Philalaos (470 avant J.-C.) qui a le premier découvert que la terre était une sphère.
Diasporadz : Vous écrivez que la « coudée d’exactitude » (0,5236 mètre) est une constante mathématique universelle qui a un rapport avec la sphéricité de la Terre. Comment un avocat, spécialiste de l’histoire et non des mathématiques, peut-il faire une telle affirmation et quelle méthode de recherche avez-vous utilisée pour cela ?
Khelifa Mahieddine : C’est E. M. Antoniadi, astronome à l’Observatoire de Meudon, qui a fait cas, dans son ouvrage sur l’astronomie des anciens égyptiens, de « coudée d’exactitude » et non de coudée royale ou de coudée égyptienne. Cette coudée qui a servi à construire la Grande Pyramide, mesure 0,5236 m. Je considère que c’est une constante mathématique universelle, ignorée à dessein par les Occidentaux. En effet, cette coudée d’exactitude, dont un modèle existe au musée du Louvre et certainement au British Museum, mesure 0,5236. L’ingénieur Jomard que Napoléon avait pris avec lui lors de la campagne d’Egypte en avait donné la dimension exacte.
C’est grâce à une parfaite connaissance de l’astronomie que les anciens Mis-Ra ont mis au point une mensuration, qualifiée de divine et appelée « coudée royale » ou « coudée d’exactitude », de valeur métrique 0,5236 m. Cette coudée se présente sous la forme d’une règle graduée en 28 doigts de 1,87 cm chacun, dont les 15 derniers doigts sont eux-mêmes divisés en 2, 3, 4, 5 et ce jusqu’à 1/16 de doigt de 1,16 mm. Le lien flagrant établi avec le nombre 3,1416 explique la raison pour laquelle la coudée d’exactitude a été contestée dans ses dimensions pour devenir une hypothèse controversée. Ce qui est certain, c’est que la coudée royale de 0,5236 mètre a été l’instrument de mesure qui a servi à la construction de la Grande Pyramide et d’autres monuments avec une précision étonnante. En réalité, ce qui pourrait expliquer cette controverse c’est le fait que l’on a attribué aux savants de la Grèce antique la découverte du nombre Pi et le nombre d’or alors qu’ils ressortent clairement des rapports entre les dimensions de la Grande Pyramide.
Il y a lieu de se demander si la mensuration du doigt de la coudée d’exactitude (1,87 cm) n’a pas été calculée en multipliant le nombre Pi par le nombre d’or et en divisant le résultat par la constante d’Euler ? En effet, 3,1416 x 1,618/2,718 = 1,87. En montrant le lien existant entre la coudée de Nippur et la coudée égyptienne, un chercheur du nom de Quentin Leplat fait remarquer que l’édification de la grande Pyramide a intégré plusieurs unités de mesures à des fins numériques qui nous échappent encore. Il en veut pour preuve que la hauteur de la grande pyramide mesure en coudée de Nippur 200 fois le nombre d’argent (1,414 qui est la racine carrée de 2) et que la diagonale de la base mesure 200 fois le nombre Pi (3,1416). Il relève en outre que le périmètre de la grande pyramide mesure une demi-minute d’arc du méridien de la Terre. La précision est là aussi remarquable avec 99,98%. C’est éloquent et montre la maitrise qu’avaient les anciens Mis-Ra des mensurations de la Planète Terre.
Diasporadz : Votre ouvrage soutient que l’Occident a « délibérément ignoré » l’apport des peuples du Sud de la Méditerranée. Quel est, selon vous, l’intérêt de l’Occident à occulter cet héritage, et quelles en sont les conséquences pour l’histoire telle qu’on l’enseigne aujourd’hui ?
Khelifa Mahieddine : Comme cela a été développé dans la réponse à vos précédentes questions, la maitrise des sciences astronomiques, géométriques, mathématiques et architecturales par les anciens Mis-Ra a permis à la civilisation grecque de prendre le relais de ces connaissances et découvertes plusieurs siècles après et de se les approprier. C’est la raison pour laquelle je considère que cette coudée est une constante mathématique universelle, mise sous le boisseau par l’Occident pour ne rien devoir aux peuples du Sud de la Méditerranée, alors qu’elle est à l’origine de la découverte du chiffre 3,1416 et du nombre d’or 1,618 que les Grecs anciens se sont appropriés en l’appelant Phi en hommage au sculpteur Phidias alors qu’il aurait dû s’appeler Mi en l’honneur des Mis-Ra.
Cela montre la justesse des calculs et la maîtrise que les Berbères d’Égypte avaient de la 3D. La symbolique du cercle avait une grande importance pour les Mis-Ra, dans la mesure où il représente les planètes et conjugue à la fois l’infinité de l’Univers dans le chiffre 3,1416…, dont les décimales sont infinies et sa mensuration limitée, comme la vie sur terre, lorsque le périmètre du cercle est représenté par une ligne droite. Le rayonnement de cette civilisation s’est manifesté principalement dans les domaines astronomique, mathématique, géométrique, architectural poussant les plus grands savants de la Grèce antique à aller s’abreuver à l’école du savoir et de la sagesse égyptienne. Dans son ouvrage « Mémoires d’Ulysse » (1996), François Herzog donne les raisons qui ont mené les intellectuels Grecs à considérer le voyage en Egypte comme une étape incontournable : « Voyager en Egypte signifiera pour un intellectuel grec remonter le temps et entrevoir les commencements, pouvoir recueillir un récit ou tenir un discours vraisemblable sur les débuts de la vie civilisée en général ou de telle ou telle pratique culturelle. En somme, faire le voyage en Egypte, c’est pour le Grec le moyen d’avoir « plus de souvenirs que s’il avait mille ans ! », trouver la mémoire qu’il n’a pas où retrouver celle qu’il n’a plus ».
Le savant grec d’origine syrienne Jamblik (déformation grecque de Yamlik, en arabe : il possède, sous-entendu le savoir. C’est mon interprétation) écrivait à propos de Pythagore, il « fréquenta tous les sanctuaires avec beaucoup d’ardeur et s’instruisait en toutes choses avec la plus grande attention cherchant à connaitre personnellement tous ceux qui étaient réputés pour leur intelligence… c’est ainsi qu’il rencontra tous les prêtres apprenant de chacun ce qu’il savait. Et c’est dans ces conditions qu’il passa 22 ans dans les temples de l’Egypte ».
Diasporadz : Vous rappelez que le volume d’une sphère de 1 mètre de diamètre plongée dans un cube de 1 mètre de côté est de 52,36 %, soit 100 fois la coudée d’exactitude. Pensez-vous que cette coïncidence est une preuve irréfutable de la maîtrise mathématique des Mis-Ra ou qu’il s’agit d’une observation fortuite de votre part ?
Khelifa Mahieddine : Il a été démontré tout à l’heure que la coudée d’exactitude de 0,5236 m a un rapport certain avec la sphéricité de la Terre. Cela se vérifie lorsque l’on plonge une sphère de 1 mètre de diamètre dans un cube de 1 mètre de côté, le volume occupé par la sphère dans ce cube est de 52,36%, soit 100 fois la coudée d’exactitude. Ce n’est pas moi qui ai trouvé cette relation, mais si mes souvenirs sont bons, c’est un mathématicien du nom de Quentin Leplat qui a fait plusieurs vidéos sur la question.
Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?
Khelifa Mahieddine : J’ai pratiquement terminé la deuxième édition de l’Epopée berbère en y intégrant de nouveaux chapitres. Un deuxième ouvrage a été finalisé. Il a pour titre le fou du village : Cheikh M’hand Ou Avva.
Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?
Khelifa Mahieddine : Une conclusion : Ces populations berbères, qui se définissent à ce jour comme Mis-Ra (fils de la divinité Ra) se sont appropriées les rives du « N’il », diminutif de Nath-il (ceux de la rivière) où elles ont bu – Assouane en amazigh en relation avec Erg Issaouène dans le Sahara algérien, campé ou bivouaqué – Ténès, Tunis, Tanis et Thinis dont elles ont fait la capitale de la première dynastie pharaonique.
En s’installant dans cette vallée fertile, ces chasseurs cueilleurs amazighs ont gardé les mêmes appellations que dans leurs territoires d’origine : Mis-Ra (Ait Misra dans les monts de Blida), N’il (Oued N’il en Kabylie orientale) Thinis, Tanis (Ténès, Tunis), campement en Berbère ancien ; Mezghouna (Egypte) avec forêt de Mezghena (dérivé de Amazigh) près de Tablat, Mizrana en Kabylie et tribu des Mezghena près d’Alger ; les pharaons (A) man-as (ses eaux à lui) en relation avec In Amenas dans le Sahara algérien, Djer (grand, géant en berbère ancien) en relation avec Adrar N’DjerDjer (Djurdjura), Oued Djer, Amjer (comme un géant) dans le Tassili ; Amen-fer devenu Memphis (à l’abri des eaux) en relation avec Ifri (grotte), Fren-da (se sont cachés là), Tafraoui (les grottes), etc.
Les chasseurs cueilleurs qui ont quitté leurs territoires de la région centrale de l’Afrique du Nord pour aller s’installer sur les rives du Nil, suite à l’assèchement climatique qu’a connu la région ne se doutaient pas que leur descendance allait être à l’origine non seulement de l’une des plus grandes civilisations de l’histoire de l’humanité mais aussi des deux premières religions monothéistes : le judaïsme et la christianisme. Le judaïsme par les descendants des prêtres monothéistes ayant été contraint à l’exode par le clergé polythéiste sous la direction du prophète Moïse (Moussa pour ses congénères). Le christianisme, suite à la rébellion contre le judaïsme, jugé trop sectaire, du prophète Jésus-Christ (appelé Aïssa par ses congénères), par les descendants des prêtres monothéistes qui se sont installés en terre de Canaan. Il est important de relever que Moïse, premier prophète monothéiste, demandait à ses fidèles de ponctuer ses prières par le mot Amen lors de la traversée du Sinaï (Ancien Testament, Deutéronome 27-15). De même que dans le premier commandement, il est relevé que le premier mot prononcé par Dieu est « Anekhi » qui signifie dans tous les parlés berbères » Je suis » ou » C’est moi « . (Exode 20-2).
Entretien réalisé par Brahim Saci
Khelifa Mahieddine, L’Epopée berbère, éditions Arabesques. Tunis – 2023