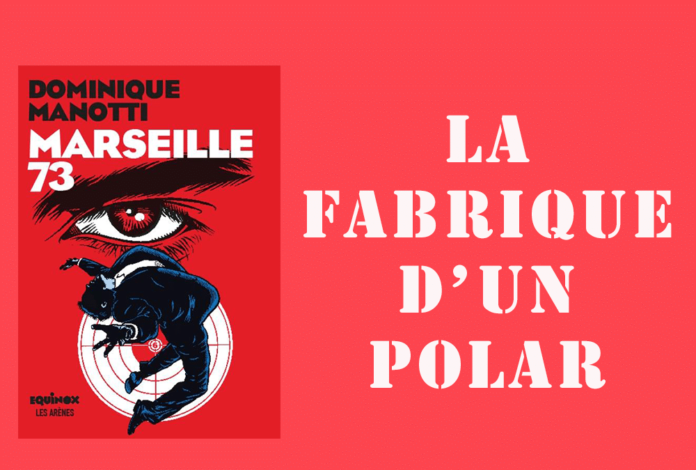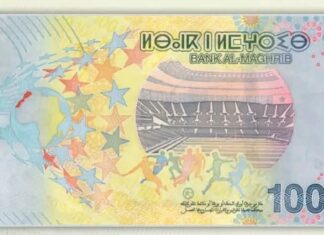Dans Marseille 73 (éd. Les Arènes) Dominique Manotti plonge le lecteur dans une période sombre de l’histoire de la France, où une vague d’assassinats ciblés contre les Algériens et les autres Arabes secoue Marseille.
En l’espace de six mois, plus de cinquante victimes sont abattues, et la ville devient le foyer d’un terrorisme raciste et aveugle. En arrière-plan, la guerre d’Algérie, les nervis de l’OAS, et la montée du Front National forment un décor de violence et de tensions raciales.
À travers le personnage du commissaire Daquin, Manotti explore cette tragédie, en dévoilant les silences complice des autorités et l’omniprésence de la corruption. Ce roman, au style sec et implacable, est un hommage à ceux qu’on a oubliés et une invitation à ne pas oublier les cicatrices laissées par cette époque. C’est un récit nécessaire, où l’histoire et la fiction se rencontrent pour dévoiler des vérités longtemps occultées.
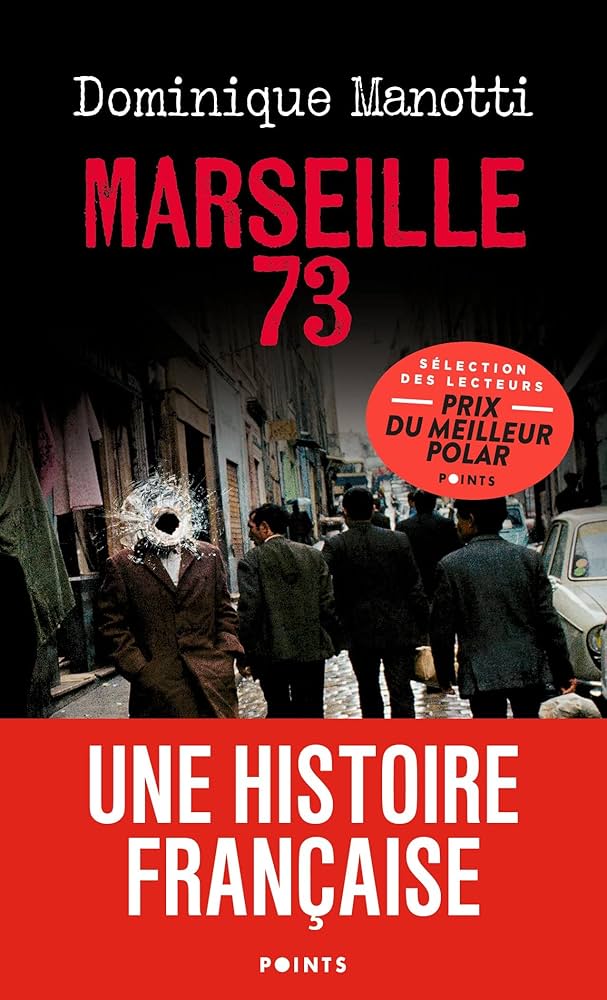
Le Matin d’Algérie : Marseille 73 est profondément ancré dans une période marquée par des violences racistes. Qu’est-ce qui vous a motivée à revisiter cet aspect souvent occulté de l’histoire française des années 70 ?
Dominique Manotti : Si Marseille 73 est profondément ancré dans un passé marqué par des violences racistes, c’est un “passé qui ne passe pas”. Les violences racistes sont toujours bien enracinées dans notre société. La vague de 1973 à Marseille est remarquable par sa durée : en trois semaines, 17 à 18 morts, presque un meurtre chaque jour. Elle se caractérise par un aspect “inorganisé”, avec des assassinats individuels, et surtout par le profond “silence complice” qui entoure ces événements. Pas d’enquête de police, pas d’arrestations, pas de procès. Ce silence est une illustration de la manière dont la France traite ses crimes coloniaux.
Le Matin d’Algérie : Votre écriture dans Marseille 73 est d’une grande précision et semble résulter d’une documentation minutieuse. Pouvez-vous nous parler du processus de recherche que vous avez suivi pour reconstituer ce passé douloureux et souvent négligé ?
Dominique Manotti :Oui, la documentation est cruciale. Lorsque j’écris, il est essentiel de respecter la “vérité” des faits établis. Pour Marseille 73, j’ai consulté des textes d’histoire et de sociologie sur cette période. J’ai également dépouillé la presse régionale et nationale de l’époque. Par ailleurs, j’ai interrogé des témoins directs : l’avocat des victimes, le journaliste ayant couvert l’histoire pour La Marseillaise, des militants d’extrême gauche ayant soutenu les familles et le MTA (Mouvement des Travailleurs Arabes). Bien sûr, dans le roman, les personnages de policiers, juges, avocats, et autres sont romancés, mais les faits eux-mêmes sont fidèles à la réalité.
Le Matin d’Algérie : Le commissaire Daquin, protagoniste de Marseille 73, évolue dans un monde où la corruption et la violence sont omniprésentes. Qu’est-ce qui vous a poussée à le créer et à en faire le personnage central de ce roman ? Comment avez-vous construit son caractère ?
Dominique Manotti : J’ai créé le commissaire Daquin dans mon premier roman, Sombre sentier. Il incarne la “mise en chair” du quartier où il vit, un lieu marqué par des activités clandestines, des patrons hors-la-loi, et une violence omniprésente, mais aussi une solidarité et une chaleur humaines dans l’atmosphère des ateliers. Daquin est un personnage complexe, confronté à des dilemmes moraux, à la corruption et à des forces qui le dépassent, mais il représente aussi un espoir de justice, même dans un environnement aussi impitoyable.
Le Matin d’Algérie : À travers ce roman, vous mettez en lumière les crimes racistes commis contre les Maghrébins dans les années 1970. Selon vous, pourquoi ces événements ont-ils été si longtemps ignorés ou minimisés par l’histoire officielle ?
Dominique Manotti : En France, la violence contre les Maghrébins ne fait pas seulement partie du passé. C’est un racisme profondément enraciné dans l’histoire coloniale. La justification de la conquête coloniale était d’apporter la civilisation à des peuples supposément inférieurs, ce qui permettait de les massacrer sans culpabilité. Le silence sur les crimes de 1973 n’est pas un cas isolé ; il pèse aussi sur les crimes de la guerre d’Algérie, la torture, les disparitions. Ce silence est nécessaire pour protéger l’image de la France comme le pays des droits de l’homme. La cohésion nationale repose sur ce mythe, et il faut donc masquer certains aspects de l’histoire.
Le Matin d’Algérie : Marseille 73 est un polar, mais il semble aussi s’inscrire dans une démarche de mémoire historique. Quelle place occupe, selon vous, la fiction dans la transmission et la compréhension de l’histoire ?
Dominique Manotti : Oui, pour moi la fiction joue un rôle très important dans la culture d’un pays et dans sa transmission historique. Ma génération a appris l’histoire à travers les romans d’Alexandre Dumas, par exemple. Raconter la société telle qu’elle est aujourd’hui, par le biais de la fiction, est une manière d’amener les lecteurs à comprendre des événements historiques de manière plus intime. La fiction permet de rendre l’histoire plus accessible et plus émotionnellement engageante que les simples faits historiques.
Le Matin d’Algérie : Même si l’histoire de Marseille 73 se déroule dans un passé lointain, les questions qu’elle soulève sur le racisme, la xénophobie et la violence sont encore d’actualité. Comment percevez-vous l’impact de ces événements sur la société française actuelle ?
Dominique Manotti : Oui, la série des assassinats de l’automne 1973 à Marseille continue à résonner dans le présent. La société française reste marquée par un racisme anti-arabe et anti-africain, un héritage direct de la colonisation. En même temps, les descendants des colonisés sont plus visibles aujourd’hui dans les sphères publiques : journalistes, acteurs, chefs d’entreprise, professeurs, ce qui déstabilise certains descendants du colonisateur. C’est peut-être cette coexistence difficile qui alimente la permanence du racisme en France.
Le Matin d’Algérie : Le roman aborde la montée du Front National à cette époque. Quelle est votre analyse de l’évolution de ce parti et de ses racines idéologiques ?
Dominique Manotti : Le FN est largement l’héritier des colons français en Algérie. C’est un parti profondément lié à l’idéologie raciste anti-arabe et anti-africain. Depuis 1967, Israël a réussi à s’imposer comme le défenseur de l’Occident face à l’Orient, ce qui a renforcé les liens idéologiques avec des partis comme le FN. Cette alliance est une partie intégrante de l’idéologie nationaliste du FN, qui utilise le racisme comme moteur de sa politique.
Le Matin d’Algérie : Dans Marseille 73, la police apparaît comme une institution corrompue et peu protectrice des populations ciblées. Cette vision de la police dans le roman est-elle un reflet de la réalité de l’époque ou une interprétation personnelle ?
Dominique Manotti : Ce n’est certainement pas une interprétation personnelle. Il ne faut pas oublier que de nombreux policiers qui ont travaillé en Algérie française ont été rapatriés après la guerre et réintégrés dans la police nationale, souvent avec leurs grades intacts. Beaucoup ont été affectés à Marseille, où la situation était déjà explosive, avec une forte présence de pieds-noirs et de travailleurs algériens. La corruption et la violence au sein de la police étaient des réalités incontournables de l’époque.
Le Matin d’Algérie : Comment avez-vous accueilli les retours sur votre livre, notamment de la part des lecteurs et des critiques ? Avez-vous ressenti une forme de réticence ou de malaise face aux thématiques abordées ?
Dominique Manotti : Dans l’ensemble, les réactions des lecteurs que j’ai recueillies étaient très positives. Mais cela n’est pas forcément significatif. Je n’ai pas beaucoup de lecteurs au FN ou de partisans de Retailleau.
Le Matin d’Algérie : Après Marseille 73, avez-vous d’autres projets en lien avec cette période ou d’autres thèmes historiques qui vous tiennent à cœur ?
Dominique Manotti : Non, je n’ai pas de projet vraiment en cours. J’ai ressenti le besoin de souffler un peu. Douze romans en 30 ans, cela commence à peser.
Djamal Guettala