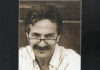Il est des réformes qui se disent modernes, mais prolongent l’archaïsme. Le projet de loi sur la procédure pénale, tel qu’il se profile aujourd’hui, n’ouvre pas une ère nouvelle de justice; il consolide un système de contrôle. Il ne cherche pas à rééquilibrer les rapports entre l’État et le citoyen, mais à les figer au profit du pouvoir. Il ne sécurise pas les droits, il les encadre. Il ne rassure pas, il surveille.
La détention provisoire en est le symptôme le plus flagrant. Ce qui devrait n’être qu’un recours exceptionnel s’est mué, en pratique, en principe de gestion judiciaire. On enferme d’abord, on interroge ensuite, on juge… parfois. La présomption d’innocence s’efface derrière la logique du soupçon. L’avocat, pourtant garant du contradictoire, devient un figurant, convoqué quand tout est déjà décidé. La liberté cesse d’être un droit, pour devenir une faveur; toujours révocable, jamais assurée.
La réforme aurait pu rompre avec cette dérive. Elle aurait pu poser les jalons d’une justice plus équilibrée, plus rigoureuse, plus respectueuse. Mais elle évite l’essentiel. Elle n’évoque pas, ou à peine, la nécessité d’introduire la collégialité des décisions privatives de liberté, pourtant l’un des piliers des systèmes judiciaires qui se respectent. Dans toute démocratie digne de ce nom, priver durablement une personne de sa liberté ne peut reposer sur l’avis d’un seul juge. La décision collégiale, prise à plusieurs voix, est une garantie fondamentale : elle protège le justiciable, bien sûr, mais aussi le juge, qui n’est plus seul face à la pression politique ou hiérarchique. Maintenir le modèle du juge unique, c’est perpétuer la vulnérabilité du système, et par là même, son instrumentalisation.
Le renforcement des droits de la défense devrait également être au cœur de toute réforme crédible. Un accès immédiat et complet au dossier dès la première heure de garde à vue, la présence obligatoire de l’avocat à chaque étape de l’interrogatoire, la possibilité de contester sans délai toute mesure attentatoire aux libertés, l’instauration de délais stricts pour les enquêtes; ce ne sont pas des revendications corporatistes, mais les conditions minimales d’un procès équitable. Une procédure qui marginalise l’avocat n’est pas une procédure rigoureuse : c’est une procédure à sens unique, déséquilibrée dès l’origine.
Il ne s’agit pas ici d’un simple débat technique, mais d’un choix de société. Voulons-nous d’un État où la justice protège, ou d’un système où elle obéit ? Car une justice aux ordres, c’est une justice qui condamne sans preuve, qui punit sans débat, qui confisque sans contrôle. Ce n’est pas l’ordre qu’elle garantit, mais la peur qu’elle administre.
La population le sait. Les investisseurs le devinent. On ne construit pas la confiance sur le soupçon, ni le développement sur l’arbitraire. Un pays où les libertés fondamentales sont précaires est un pays dont l’économie vacille, dont les talents fuient, dont les voix se taisent ou s’exilent.
La réforme actuelle est donc bien plus qu’un texte législatif : c’est un test politique. Si elle ne réaffirme pas la vocation protectrice de la procédure pénale, si elle ne rétablit pas l’équilibre entre les pouvoirs, si elle ne place pas la défense au cœur du procès, elle trahira son ambition affichée et manquera son rendez-vous avec l’Histoire.
L’Algérie mérite mieux qu’une justice de façade. Elle mérite une justice debout, impartiale, visible et digne. Une justice qui ne tremble pas face au pouvoir, mais qui s’en distingue. Une justice qui ne pèse pas les libertés au gré des équilibres politiques, mais qui les garantit, en tout temps, pour tous.
Car il ne suffit pas de réécrire la loi pour en faire une réforme. Encore faut-il qu’elle soit fondée sur le droit, et non sur la défiance. Sur l’équité, non sur le contrôle. Sur la liberté, non sur la peur.
Mohcine Belabbas, ancien président du RCD