L’entretien télévisé accordé jeudi dernier par le président de la République a mis en lumière, bien au-delà du contenu politique qui reste très critiquable, l’état préoccupant du journalisme en Algérie. Les journalistes conviés ont enchaîné des questions convenues, parfois formulées de manière à contenir déjà la réponse attendue, sans jamais relancer ni bousculer l’interlocuteur.
Cette absence de contradiction trahit un double affaissement : éthique, d’abord, lorsqu’un métier fondé sur le doute et la vérification s’accommode de la simple reproduction du discours officiel ; professionnel, ensuite, quand la pratique de l’interview devient un exercice de communication à sens unique. Les quelques interrogations de fond sur les politiques publiques ou les dossiers sensibles n’ont pas trouvé place, réduisant l’échange à une tribune pour le pouvoir exécutif.
Le problème ne se limite pas à ce face-à-face télévisé. La presse écrite reflète la même dérive. Deux quotidiens (Le Soir d’Algérie et El Khabar) ont publié ce lundi 28 septembre, à la une, un article identique – titre et contenu – visiblement dicté par des circuits institutionnels, sans vérification indépendante.
Il s’agit d’un sujet à la portée stratégique majeure pour le pays : la fuite réelle ou supposée du directeur général de la Sécurité intérieure (DGSI), le général Abdelkader Haddad, alias El Djinn, un événement qui a enflammé les réseaux sociaux et attiré l’attention de nombreux médias internationaux, mais que l’ensemble de la presse nationale — y compris les deux quotidiens — s’est abstenu d’évoquer ou de vérifier. Comment comprendre le silence de la presse mais surtout des autorités devant un fait aussi grave ? Le silence, voire le déni, fera-t-il pour autant oublier ce scandale d’Etat ?
Cet épisode illustre une tendance plus large : celle d’un journalisme de connivence, où la recherche de l’information s’efface derrière la diffusion de messages « téléphonés ».
Les causes sont multiples : dépendance économique vis-à-vis de la publicité publique, cadre réglementaire restrictif, autocensure nourrie par la crainte de poursuites. Mais les conséquences convergent : affaiblissement de la crédibilité, perte de confiance du public et rétrécissement de l’espace critique dans le débat national.
La presse algérienne a connu de bien meilleures années. Dans un contexte où la société algérienne aspire à plus de transparence et de responsabilité, la profession journalistique se trouve à la croisée des chemins.
Retrouver sa mission de contre-pouvoir et de questionnement rigoureux n’est plus seulement un impératif déontologique : c’est une condition essentielle pour une information digne de ce nom et, plus largement, pour une vie démocratique authentique.
Rabah Aït Abache









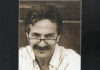

Mais je voudrais bien faire au passage une petite remarque sur un média comme AL24 news. A la limite on peut comprendre les brosseurs et brodeuses de pompes de Tebboune et du régime comme les Badis Khenissa, Gamal Abina , Nouhad Belkhadem, Narimene Zekagh , Sofiane Baroudi , mais il y a un grand traitre du Hirak qui s’appelle Fayçal Métaoui qui était durant la durée du mouvement citoyen contre le système , contre le régime qu’il remettant en question et qu’il critiquait parfois sévèrement et là il choisit l’aplaventrisme personnifié. Et on l’a vu dans l’interview , il ne cessait pas de faire des signes de satisfaction de la tête quand Tebboune prenait la parole. D’un soit disant journaliste révolté , progressiste et bien en Algérie , on peut en faire facilement un paillasson. PS : Ce que je dis n’engage que moi.
Les journalistes ne sont pas des Zambla ou Supermens ou Superwomen – c’est des Agents de la Verite’. Entendez-moi bien, je dis VERITE’ et non REALITE’. Les verite’s sont les histoires, c.a.d. le narratif qu’on construit autour d’une meme verite’ – et il y en a toujours au moins 2 verite’s CONTRADICTOIRES – ce qui necessite, DIFFERENTES perspectives, c.a.d. PERCEPTIONS – qui necessite differentes positions par rapport a une quelconque realite’ et dans tous les sens du mot. Cela requiert au moins 2 acteurs – qui voien, enttendent, pensent et reflechissent differemment – C’est ce qui manque terriblement !
Ce n’est biensur pas des acteurs aux perceptions differentes qui manquent, loin de la. Les Algeriens connaissent et savent(comprennent) leurs realite’s. Ils les ont exprime’es oralement, par ecrit et par les urnes. Et ce qu’ils ont exprime’ par les urnes ne trouve pas d’echo dans ce khorti dit « Balamane ». Les barlamantaires semblent etre tous les copies les uns des autres, c.a.d. des copies identiques a la barzidania. A quoi bon un parlement de plus d’une personne si ce n’est pour exprimer plus d’une perspective ?
Et je reviens aux journalistes – Le job 1er des journalistes n’est-il pas justement 1) de capter les differents echos des parlementaires et de les amplifier, analyser et diffuser les differents narratifs? Biensur que si. C’est bien cela qui remet en question la representation parlementaire. Et par remise en cause, il faut comprendre « maintien » ou « pas » d’un elu. Voila donc ce qui motive des elus. Ca ne semble pas etre le cas en Algerie – et la raison logique est que la carriere dans la houkouma barlementaire ou chikouritaire ne depend pas des Algeriens, de leurs realite’s, perception de celle-ci et encore moins leurs opinions. Des lors que ces opinions n’ont aucune valeur, leur expressions nonplus. Ce n’est pas qu’elles(opinions) n’existent pas, bien au-contraire ils ne les gaspillent pas tout simplement. c.a.d. qu’ils ne les expriment plus – d’aucune maniere, certainnement pas par les urnes. Apres les avoir crie’es, et ecrites des generations durant, maintenant ils les marchent. Oui, les Algeriens VOTENT AVEC LES PIEDS, comme l’a demontre’ la derniere election de Septembre 2024. Donnons l’echo de cette election-la: « Teboune Tebagg !!! »
NOTE: Leur bla bla bla m’est totalement incomprehensible. Je ne suis ni Arabe ni Khorti – Je suis Kabyle !
Le Jour tu auras le courage de combattre comme nous l’avons fait, sur le front de la haine anti raciste la question de la défense de l’Algérie de la Palestine, tu pourras parler.
On connaît les guerrier du net ça parle beaucoup mais ça n’agit pas.