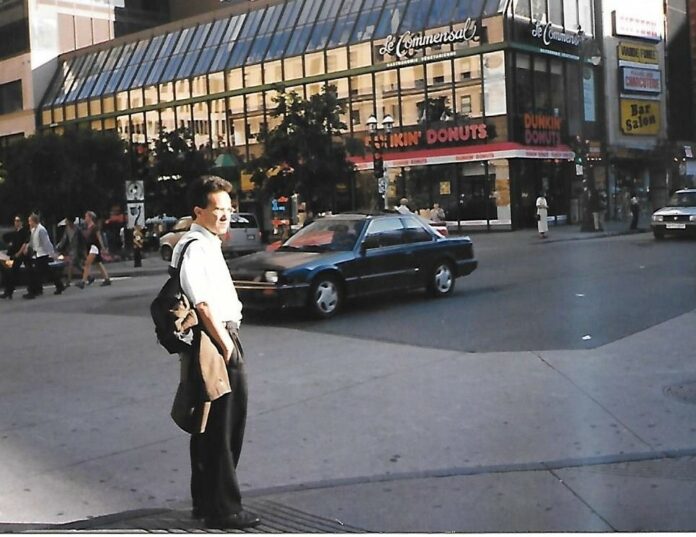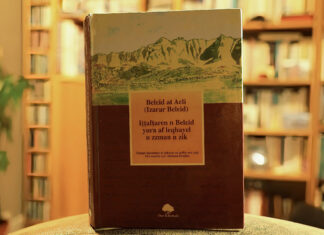De leur origine terrienne, ils gardaient une certaine fierté. Gamin, il se rendait chaque été à Aïn Taghrout, lieu natal de sa mère. Plus précisément à Oulèd Mosly, près de Tixter, commune mixte créée pour la circonstance par la France occupante pour mieux quadriller certaines localités, à tout le moins administrativement.
Pour couper la population des fellagas qui sillonnaient les champs, se réfugiant tard le soir chez les fellahs. Du moins à ce qu’on croyait. Les champs, vastes espaces qu’il traversait gamin pour amener paître les bêtes de Djedda Baya, sa grand-mère, avec ses cousins et cousines ; en général, près du Sbèkh, un lieu où il y avait quelques herbes et l’eau des oueds pour étancher la soif des braves bêtes. Ces mêmes oueds leur servaient également de piscines où certains exerçaient leurs talents de nageurs. L’inconscience éloignait d’eux les maladies ; c’était leur protection.
Leur insouciance faisait le reste ; entre repas frugaux, kesra avec de l’huile d’olive ou du lebèn avec dattes et musiques stridentes des flûtes taillées à même le roseau, leur joie était indicible car préservés alors par leur ignorance des abominations de ce monde. Leur quotidien était gavé de rires insouciants, peuplés de rêves d’une vie meilleure.
Combien il aimait se rendre chez Djedda Baya ! Son grand père mourut hélas alors qu’il était encore dans les langes ; sa mère lui racontait qu’il lui arrivait souvent de faire le chemin jusqu’à Sétif, où ils habitaient alors, pour le voir. Djeddi Ali lui vouait ainsi une véritable adoration, comme me le rapporta sa mère. Pour pouvoir tenir dans ses bras son petit-fils, il faisait du chemin ; avec le problème de transport, sans compter l’éloignement de leur ferme de la route, en un lieu dit El Djarda, pour espérer tomber sur un taxi qui daignait s’arrêter. Il fallait en effet marcher à travers champs, il n’y avait pas d’autre alternative.
Ma mère lui disait qu’il était souvent taquin envers Djedda Baya, mais très brave à tel point que rien ne le rebutait dans la vie. Hélas, un jour, il rendit visite à sa fille, Dahbia, et se sentit fatigué ; il rentra à Oulèd Mosly pour se reposer. Le soir, il dormit pour ne plus se réveiller. Mort sans souffrance, mais à un jeune âge. L’indigence endémique empêchait alors les gens jusqu’à avoir un appareil photographique de sorte qu’aucune photo de lui ne lui est parvenue.
Gamin, il imaginait que ce jour de deuil, il faisait noir. Depuis longtemps, la nuit caressait de son voile enveloppant le village endormi. Les ténèbres avaient englouti le soleil. Le travail harassant de la journée l’avait terrassé. Des clameurs nocturnes s’élevaient ça et là. Ce fut une journée de labeur estival. Une de ces journées chargées de la chaleur d’un soleil qui divorçait avec neuf mois de lassitude, prodiguant lumière pour tous. En cette nuit où la lune trônait dans le ciel parsemé d’étoiles, admirer cette terre qui s’étendait jusqu’à l’horizon le plus visible.
Terre ancestrale apprivoisée jusqu’à devenir compagne et maîtresse de toute une vie. Tout était calme dehors. Cette sérénité était déflorée par moments par les aboiements de chiens errants ou des fermes avoisinantes. Une nuit qui respirait la fraîcheur et l’espoir de demander le bilan des méfaits des féodaux que la terre avait enrichis. Sonne l’heure de la fin de la servitude et des magnats de la terre. Et libérer celle-ci pour ceux maniant l’araire, plume paysanne.
La meilleure école pour une culture universelle. Pour Djeddi Ali, la vie fut un combat, les lois au service de ceux qui les élaborent. Lumières foncièrement fallacieuses des enseignes de la ville où il lui arrivait de se rendre. Tribulations affluant du subconscient. Appréhension du cerveau en ébullition. Blessures multiples et aiguës de la vie.
C’était un jour hivernal. Un de ces jours où le soleil, rassemblant tout ce que l’été lui a ménagé d’énergie, colorait la terre de ses pinceaux rayonnants. La terre, fraîchement labourée, respirait la joie de vivre. Exhalait une odeur de quiétude. Sous ses pas pesants, la terre se dispersait de part et d’autre. Sa silhouette se découpait dans le crépuscule naissant. Sa démarche, jadis si altère, s’alourdissait ; ses épaules accusaient le poids de la mélancolie. Le site environnant, si familier, devint lugubre. Journées pluvieuses de l’hiver, le vent régnant en maître. Au chevet du jour, la nuit pointait ses rideaux sombres. Respirer de grandes bouffées d’air avant de se coucher.
Et il se surprit à penser à cette douloureuse nuit qui devait emporter son grand papa. Taille haute et altière. Large carrure. Sourire généreux. Moustache grisonnante. Cheveux ras. Energie juvénile.
Ardeur au travail. Autoritaire mais tolérant. Instinctif et patriarcal. Subtil mélange de qualités et de défauts… Soudain, des pleurs violents. Voile de deuil. Corps sans âme. Ultime courtoisie à la vie. Mutisme et douleur. Crier de rage. Eloges du défunt expurgés des différends. La mort, faucille implacable. Prostration. Vision nébuleuse, yeux embués.
L’aube naissait des restes de la nuit lorsque l’amère réalité s’installa. Femmes éplorées. Djedda Baya et ses filles, ses tantes. Ce qui lui rappela la mort de l’une d’elles quelques années avant, tante Barkahoum. Il était alors gamin, seules quelques ombres hantent sa mémoire… Au lever de ce soleil hivernal timide, la maison devint une sorte de réceptacle respirant le deuil. Somnolence encore visible sur les visages bouffis par le sommeil. Dépouille mortelle.
Ultime toilette pour comparaître devant l’Eternel. Exit la vanité de l’homme. Bienvenue à l’humilité sans faille. Vénération du défunt. Piété infiniment mesurée. Austère. Défunt enveloppé dans un suaire blanc, dernier habit pour l’ultime demeure. Inhumation dans cette terre si câlinée. Silences et palabres s’entrechoquaient. S’affrontaient. Rhétorique sur le malheur. Sépulture à même le sol. Englouti par la terre si tendrement cajolée par l’araire, ce calame de toute une vie…
De là date sans doute son envie de vivre à la campagne. Durant son enfance, il allait chaque saison estivale à la campagne. Chez ses grands-parents maternels. Les vacances scolaires étaient longues et ennuyeuses. Mortelles. Qui pouvait alors s’offrir un congé au bord de la mer ? C’était coûteux. Avec son oncle et ses cousins, ils s’occupaient des tâches pénibles. Corvées matinales.
Garder les moutons et chèvres. Quelques moments de bonheur cependant. Tirer l’eau du puits et la déverser dans les petits canaux creusés à cet effet pour arroser le potager aménagé par l’un de ses oncles. Une eau si pure et si fraîche qu’ils en buvaient tout notre soûl. Se promener, en fin d’après midi le long des champs, à travers pistes. En solitaire souvent. En chantonnant sûrement. Il allait le plus loin possible de la ferme, après une sieste. A travers une piste aménagée. Quel bonheur rien qu’à l’évocation de ce seul souvenir.
La maison était bâtie en pierres et en chaux. L’entrée barrée d’une porte sommaire qui fermait de l’intérieur à l’aide d’une grosse poutre apposée de part et d’autre. Dès le seuil, essedda, sorte de lit monté en pierres où dormait son oncle Khier. Pour monter la garde de nuit. Au fond, l’étable où se reposaient les bêtes après leur ration de foin. Tout de suite, une petite porte obligeant à se baisser pour entrer. Elle donnait sur une courette dont le sol demeurait à l’état de terre. Une petite nouala, sorte de cuisine aménagée pour la préparation des repas quotidiens. Trois pierres posées en forme de triangle servaient de cuisinière.
Le combustible ? De la bonne bouse de vache séchée faisait l’affaire. Les repas ? Le soir, invariablement de la berboucha, couscous au lait. En face, deux pièces servant à la fois de salles à manger, de salons et de chambres à coucher. C’est là que sa grand-mère Baya lui raconta nombre de contes : Hdidouène, La vache des orphelins… Livrer toute la Terre au néant pour revivre ces moments ! (à suivre)
Ammar Koroghli-Ayadi, auteur-avocat
Email : akoroghli@yahoo.fr