La fabrication d’ennemis par certains régimes cherchant à conserver le pouvoir est un phénomène récurrent dans l’histoire politique. Elle s’appuie sur une idéologie stratégique et des marqueurs identitaires pour créer une menace, réelle ou imaginaire.
Ce procédé n’est pas limité aux dictatures ; certaines démocraties l’ont aussi utilisé dans des contextes de crises ou de tensions internationales, où un ennemi extérieur sert à unifier temporairement la population autour du pouvoir en place. Mais cette construction repose toujours sur une volonté politique de manipuler et contrôler l’opinion publique Ce procédé repose sur la construction d’un « autre » perçu comme une menace, interne ou externe, qui sert à mobiliser le soutien populaire, détourner l’attention des problèmes internes et justifier des mesures autoritaires. Ce mécanisme, bien que souvent associé aux régimes totalitaires, peut également être observé dans des démocraties.
La création d’un ennemi peut être un mécanisme toxique de pouvoir qui fragilise la société à long terme, en instaurant la division, en brisant la confiance sociale et en alimentant la violence. La production d’ennemis systémiques provoque souvent des conflits sanglants, un recul des libertés et l’affaiblissement des institutions démocratiques.
Ainsi, la fabrique des ennemis est une stratégie politique ancienne et universelle utilisée par des régimes divers pour maintenir leur emprise sur le pouvoir à travers la peur et la manipulation de la population. Un regard critique, historique et sociopolitique est essentiel pour comprendre cet usage et prévenir ses dérives.
Pourquoi fabriquer un ennemi ?
L’ennemi agit comme un mécanisme de différenciation du « nous » et de « l’autre » et permet de consolider l’identité nationale ou collective autour d’une menace identifiée.
Il sert souvent à cimenter un régime en difficulté en mobilisant les peurs collectives ou en fournissant une explication facile à des crises économiques, sociales ou politiques.
La figure de l’ennemi est aussi une échappatoire pour les autorités en panne de légitimité, leur permettant de détourner l’attention publique et d’imposer un ordre répressif sous couvert de sécurité.
Exemples historiques
- Régime nazi d’Allemagne (1933-1945) : Hitler a fabriqué un ennemi multiple : les Juifs, les communistes, les démocraties, prétendant qu’ils étaient une menace pour la pureté raciale allemande et la survie de la nation. Cette fabrication a justifié la suppression des opposants et les campagnes génocidaires.
- Dictatures militaires d’Amérique latine : Beaucoup ont exacerbé des conflits contre des ennemis intérieurs, notamment des communistes ou des guérilleros, pour justifier la répression politique violente.
- Guerre en Irak après le 11 septembre 2001 : L’administration américaine a utilisé la peur d’armes de destruction massive et des ennemis supposés (comme Saddam Hussein) pour justifier une intervention militaire importante, malgré des preuves insuffisantes.
Mécanismes et outils de fabrication
- Discours et propagande : Construction d’un discours politique martelant la figure de l’ennemi (médiatisation, discours officiels, écrits).
- Symboles et mythologiques nationales : Le recours à des références historiques et culturelles servira à légitimer la peur de l’ennemi.
- Manipulation psychologique : Exacerber les peurs collectives avec des fausses informations, des théories du complot, ou la stigmatisation.
- Légitimation de la violence : Le régime se donne le droit de recourir à la répression, la censure, la surveillance accrue au nom de la sécurité nationale.
Il est des États qui, pour survivre, doivent toujours brandir un spectre. Sans ennemi déclaré, ils vacillent, perdent leur ciment, s’effritent. Alors, ils se mettent à fabriquer de toutes pièces ce dont ils ont besoin : une menace, un monstre, un « autre » à désigner, à craindre, à haïr.
La mécanique est ancienne. Les empires, les régimes autoritaires, mais aussi certaines démocraties fragiles, recourent à ce stratagème. L’ennemi devient l’outil politique par excellence : il soude la population derrière ses dirigeants, détourne l’attention des crises internes, justifie la répression ou l’extension de l’appareil sécuritaire.
La recette est simple et éprouvée :
*Désigner d’abord une cible, souvent une minorité, une puissance étrangère, une idéologie.
* Marteler ensuite le récit par les médias, l’éducation, la propagande, pour que l’imaginaire collectif s’en imprègne.
* Entretenir enfin la peur par des rappels réguliers : discours solennels, incidents amplifiés, rumeurs savamment distillées.
Ainsi, l’ennemi n’est pas toujours réel, mais il devient socialement vrai. Et c’est cela qui compte pour le pouvoir.
On croit lutter contre une menace extérieure, alors qu’on alimente surtout la survie d’un système. L’histoire est riche d’exemples : la Guerre froide et son rideau de fer invisible, les régimes dictatoriaux accusant « l’étranger » de tous les maux, ou encore certains États modernes qui fabriquent le « terroriste » comme figure permanente de justification.
La fabrique d’ennemis est donc une industrie politique : elle tourne sans relâche, produit à la chaîne des figures hostiles, et distribue au peuple une peur empaquetée, prête à l’emploi. Mais derrière chaque ennemi ainsi forgé se cache la même réalité : l’incapacité ou le refus d’affronter les véritables problèmes internes — inégalités, corruption, injustice, absence de perspectives.
Un pouvoir qui a besoin d’un ennemi pour exister finit par devenir lui-même le véritable danger. Car il confisque la conscience critique, il infantilise la société, il entretient la guerre permanente contre des fantômes. Et à force de créer des ennemis, il ne sait plus fabriquer de citoyens.
Bachir Djaïder
Journaliste, écrivain

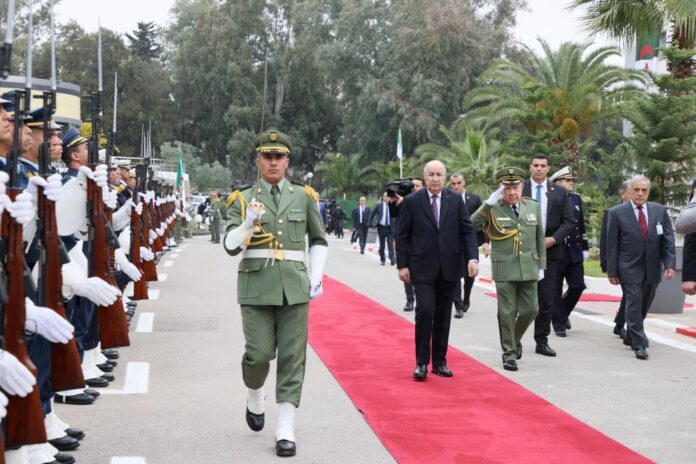









Genève, Palais des Nations. À l’occasion de la 18e session du Mécanisme d’Experts des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), le Congrès Mondial Amazigh (CMA), ONG internationale de défense des droits des Amazighs, a été reçu officiellement par Mme Anexa Brendalee Alfred Cunningham, présidente du MEDPA, accompagnée des experts Binota Moy Dhamai et Ojot Miru Ojulu.
Deux dossiers urgents ont été remis lors de cette rencontre le 14 juillet 2025 : l’un concernant la Kabylie, région d’Algérie, et l’autre les Amazighs de Libye. Ces demandes d’assistance s’inscrivent dans le cadre du mandat défini par la résolution 33/25 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Kabylie : une répression d’État dénoncée
Au nom du peuple kabyle, le CMA a exposé la situation alarmante dans cette région d’Algérie : répression politique, emprisonnements massifs, condamnations à mort — 39 au total — au titre de l’article 87 bis du Code pénal algérien, pourtant en violation flagrante du droit international selon plusieurs organes onusiens.
La délégation a mis en lumière la politique d’arabisation, d’islamisation forcée, de répression culturelle et linguistique menée depuis l’indépendance de l’Algérie. Malgré cela, le peuple kabyle persiste dans sa revendication d’un règlement pacifique du conflit, sur la base du dialogue et des normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones.
Face à ce contexte de violence institutionnalisée, le CMA sollicite l’intervention urgente du MEDPA pour :
Informer et conseiller les représentants kabyles sur les mécanismes de protection de leurs droits ;
Encourager et faciliter un dialogue entre les autorités algériennes et les représentants légitimes désignés par les Kabyles eux-mêmes.
Libye : une invisibilisation structurelle des Amazighs
En l’absence de la délégation du Haut Conseil des Amazighs de Libye (HCAL), empêchée de se rendre à Genève pour des raisons administratives, le CMA a plaidé leur cause. Depuis 65 ans, les Amazighs libyens subissent marginalisation, spoliation de leurs terres, déni identitaire et exclusion constitutionnelle.
Dans un pays toujours fracturé entre deux gouvernements, les Amazighs ont rétabli leurs formes traditionnelles de gouvernance et réclament aujourd’hui la reconnaissance officielle d’un statut d’autonomie pour leurs territoires.
Le CMA, au nom du HCAL, appelle le MEDPA à :
nformer les Amazighs libyens de leurs droits collectifs ;
Collaborer à la rédaction de textes législatifs favorisant leur reconnaissance ;
Encourager les autorités libyennes à initier un dialogue en vue d’un accord sur un statut juridique spécial, garantissant leur développement et leur pérennité culturelle.
Une reconnaissance indispensable des droits autochtones
La présidente du MEDPA a salué l’initiative du CMA et s’est engagée à examiner avec attention les deux requêtes. Le CMA espère qu’une mission d’enquête pourra prochainement se rendre en Kabylie et en territoire amazigh libyen.
Par cette démarche diplomatique, le Congrès Mondial Amazigh réaffirme sa volonté de recourir aux mécanismes internationaux pour faire entendre la voix des peuples autochtones d’Afrique du Nord, dans le respect du droit, de la dignité et de la paix.
Le problème quand on fabrique des ennemis c’est qu’on devient soi même ennemi des autres… Ce qui est un immense malheur pour un peuple, pour une jeunesse qui a toujours voulu vivre en paix avec les autres, surtout avec les occidentaux. Cela fait 63 ans que ce régime pourri nous oblige à vivre dos à la mer, dos à l’Europe. Cela fait 63 ans que ce régime nous oblige à croire que nous sommes assiégés par le monde entier. Je pense que c’est la pire chose qu’on ait imposé aux algériens et aux algériennes : l’interdiction absolue de se sentir en paix avec le monde, l’interdiction d’aimer et d’être aimer des autres, l’interdiction de se dire en paix avec France. Il faut bien le reconnaître : ils ont bien réussi à nous isoler totalement du monde. Ils ont bien réussi à faire de nous un peuple hai, paria, un peuple dont on se méfie. Le drame c’est que même sur leur lit de mort, Teboune, Chengriha et ceux qui suivront resteront animés que par un seul projet : ne laisser aucune chance aux algériens et à l’Algérie. Je pense que même l’OAS ne nous a pas souhaité autant de mal.