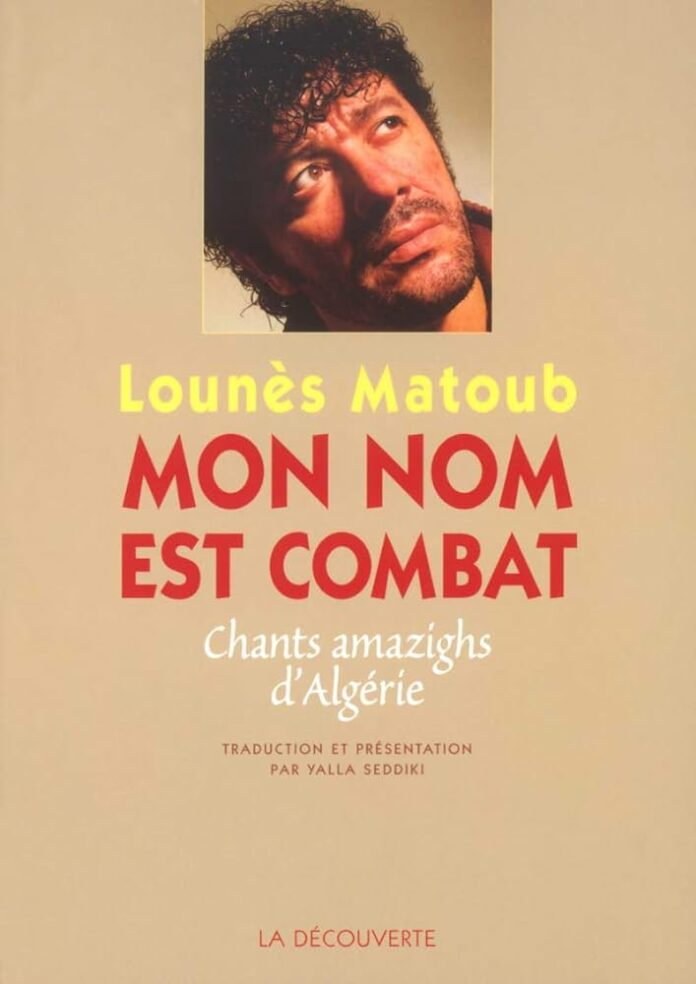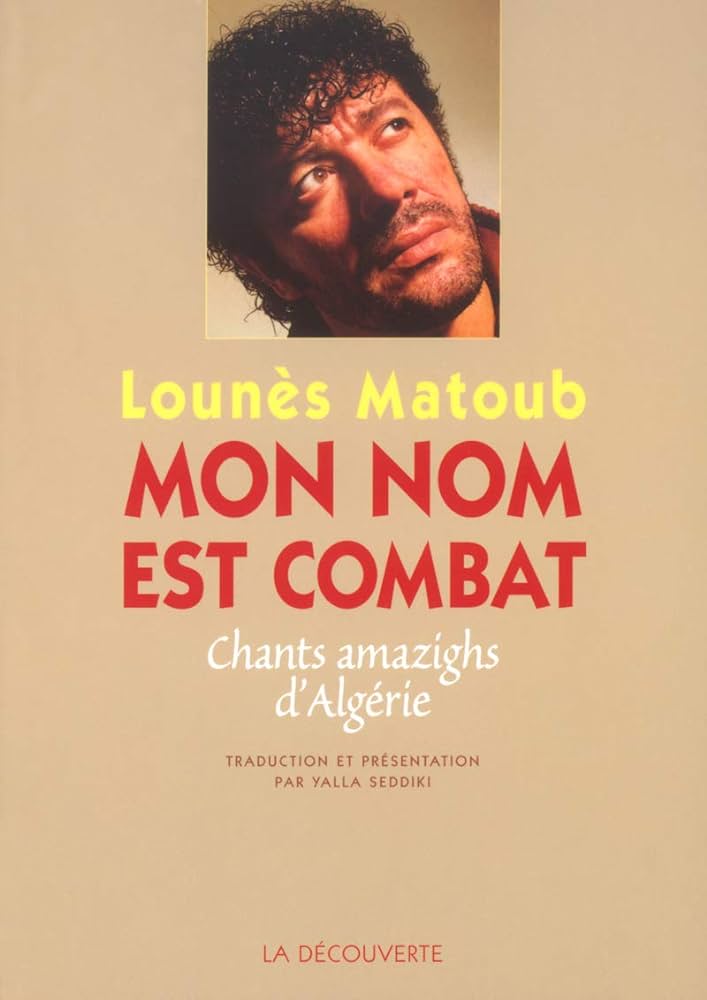Jeudi 22 septembre 2016
Une nuit « sanglante » nommée Bentalha
C’est en septembre 1997 que survient le plus terrible des drames de la décennie noire, le massacre de Bentalha (sud d’Alger).
Le peuple algérien y découvre l’indicible et une mort dénuée de tout sens. Les terroristes tuent systématiquement les individus qu’ils ont d’abord mis au ban de l’humanité. Plus de 400 personnes sont massacrées dans l’horreur la plus abjecte. Condamnées à disparaître comme un déchet, les victimes ont été « animalisées » avant d’être complètement anéanties dans des scènes qui expriment la négation de toute humanité. Il semble que les terroristes « encagoulés » aient décidé d’abattre les « mécréants ». Le but c’est de créer « un enfer fantasmé » tel que décrit dans les textes sacrés.
C’est ainsi que les cadavres s’amoncellent, alors que même des hélicoptères survolent le théâtre des événements sans vouloir intervenir. Des militaires apathiques face à la menace et au carnage qui laissent « soupçonner » ou penser que l’État était l’instigateur de ces crimes atroces perpétrés plusieurs heures durant (Nesroulah & Mellah, 2000). C’est au lendemain de ce drame absurde que le photographe Hocine Zaourar dévoile au monde la souffrance « pudique » des Algériens, en publiant « la Madone de Bentalha » (Guillot, 2005). Cette femme adossée à un mur exprime le profond malaise qui règne dans une Algérie « traumatisée ». Mais ce « dévoilement » a été violemment critiqué, parce que tabou dont la transgression s’avère dangereuse. Encore faudrait-il le préciser ici que le cimetière de Bentalha fut le théâtre d’une tragédie des plus atroces, et quasiment indicible. Ce lieu est alors symbole de la mort d’un peuple « rêveur d’une Algérie pacifiée» ». Des hommes et des femmes là-bas présents sont noyés dans l’assourdissant bruit des sirènes de la mort. On voit des images floues, hachées, entrecoupées, laides, etc. C’est un film dramatique sans protagonistes précis, où les regards sont « oblitérés » par la peur, l’incompréhension, l’amertume. Il y a eu une sorte d’obligation de regarder ou, du moins, de prendre position pour secourir une humanité en danger.
Radicalisé, le discours des terroristes se fonde sur une division manichéenne entre monde « croyant » et monde « mécréant ». Tout devient possible dès lors qu’un individu n’est plus inclus dans cet univers commun. De mon point de vue, les massacres commis ne relèvent pas d’une problématique raciste, puisque les terroristes armés n’éliminent pas les Algériens en tant que pères de familles, frères, amis, cousins et voisins, mais bien plutôt parce que ce sont des « mécréants ». Ces véritables exécuteurs, agissent en vertu d’une mission dont ils se sentent investis. C’est un ordre qui suppose l’Unicité du monde : un seul Dieu, une seule idéologie, une seule conscience et même une seule vie. D’ailleurs, des milliers d’intellectuels et d’artistes s’exilent, car ils se sentent d’ores et déjà étrangers au drame. Voilà comment l’Algérie se retrouve progressivement vidée de son intelligentsia et de son potentiel.
Evidemment, la persécution terroriste a détruit le bonheur de « vivre-ensemble » qui est désormais inconcevable Stora, 2001b). Le film « L’épreuve » (Elmahna) réalisé par Abdelhalim Zerrouki en 2010, montre parfaitement le sadisme de groupes islamistes qui se sont mis au service d’une guerre cruelle et incompréhensible. À plus d’un titre, ce film considéré comme un objet de mémoire dédié aux victimes, retrace avec précision les contours d’une société caractérisée par la haine de la différence. C’est en de pareilles circonstances que la vie des Algériens bascule dans l’absurdité. Humiliés physiquement et psychiquement, les hommes se cachent pour échapper à un destin monstrueux. Ils se retrouvent parfois les spectateurs impuissants du viol de leurs mères, sœurs ou épouses. Le viol « tue la femme dans la femme » comme dirait la féministe Gisèle Halimi. De même, le viol collectif constitue le stade ultime de toute cette barbarie. En quête du pouvoir, les terroristes perçoivent le corps de la femme comme un lieu de pouvoir à reconquérir. Or, vivre avec un corps « abîmé » rend cette femme déjà meurtrie dans sa chair « intouchable », voire « impossible à marier » dans une société des tabous.
A cet effet, le rescapé Yous Nesroulah (2000) décrit minutieusement dans son livre intitulé « Qui a tué à Bentalha ? » toute la violence dirigée contre un peuple sérieusement sacrifié. Les événements ont été retranscrits le plus précisément possible dans un souci de fidélité à une réalité quasi pathologique. Le témoignage « Qui a tué à Bentalha ? » est à la fois un acte de dénonciation et d’interrogation lisible à travers lequel Nesroulah montre l’évolution tragiquement logique vers l’horreur d’une violence instrumentalisée à des fins politiques. En témoigne notamment l’absence d’intervention des forces de l’ordre à proximité du lieu du drame, alors que les victimes accablées par l’épouvante d’une « nuit des longs couteaux » demandaient à être secourues !
La réconcialtion, ce mensonge d’Etat
La guerre civile a été une période sombre et « tabou » pour l’Algérie. Nombreuses ont été les victimes lâchement assassinées, torturées, harcelées et parfois forcées à l’exil. La guerre a symboliquement pris fin suite à la mise en place du « Projet de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale » en septembre 2005, lequel aurait offert une amnistie totale aux terroristes. L’homme politique qui a échoué moralement dans sa mission de construire une société digne de ce nom aurait-il cherché à préserver l’ordre public par tous les moyens ? Cet homme-là, le président Bouteflika en l’occurrence, est porteur d’un programme de réconciliation sur lequel il a focalisé toutes son énergie. Mais il aurait fallu sacrifier quand même la mémoire des millions de victimes martyrisées pour garantir « une société de paix ». C’est une logique qui se fonde cette fois-ci sur un autre discours « au nom des martyrs algériens » ; « au nom de la souveraineté nationale » ; « au nom de la démocratie », etc. Mais cette vision n’est-elle pas d’ailleurs calquée sur le discours de l’antagoniste « au nom de Dieu » ? Beaucoup se sont interrogés alors si cette réconciliation décrétée par la Présidence était vraiment susceptible de pacifier la société et préfigurer la fin du cauchemar algérien. Et puis, comment est-ce possible d’accepter le pardon accordé aux terroristes, en tirant un trait définitif sur tous les crimes et les violences que le peuple aurait endurées ? Il est évident qu’être reconnu comme victime empêchera l’individu de se venger dans le sang. Cette reconnaissance « victimale » est primordiale pour sauver ce qui lui reste de dignité, sachant que l’impératif de vengeance (« œil pour œil, dent pour dent ») a largement façonné jusqu’ici les mœurs de la société traditionnelle.
A dire vrai, on chemine laborieusement vers l’effacement de la mémoire collective au lieu d’aller vers un sérieux travail de vérité et de réparation. L’État a accordé une amnistie totale aux terroristes par le biais d’un référendum et des urnes. Mais cette démarche politique demeure largement insuffisante au regard des crimes commis. La victime a été exclue de surcroît des circuits d’échange et de négociation générés en vue d’établir une transition politique. Cette « seconde mort » justifie ici le retour de la vengeance, et ce d’autant plus que les terroristes ont bénéficié d’offres d’intégration et de récompenses après les années de violence (logement, soin, éducation, travail, etc.). N’est-il pas une négation « malveillante » de la victime, contrainte de vivre désormais avec son bourreau ? On s’interroge justement ici sur le rapport des institutions juridiques aux crimes perpétrés puisque la violence terroriste a pris, semble-t-il, une forme d’une violence « fondatrice » d’une nouvelle justice marquée par « l’impunité des crimes ».
En réalité, la réconciliation nationale n’est finalement qu’une « projection politique » pour occulter la vérité des faits au point qu’elle devienne un mensonge d’État « Plus jamais ça ! ». La répression des revendications véhiculées par des mouvements associatifs des victimes des terroristes (l’ANFV et le Collectif des Familles de Disparus notamment) en est un exemple édifiant. Dans l’idéal, ces mouvements-là participent à la « dépolitisation » de la vie publique, en transcendant les préjugés, les tabous et la censure (Benrabah, 2000). Ce qui montre bien la difficulté de l’État algérien à concilier politique du pardon et mémoire du massacre du peule. C’est la défaite de la culture politique inconciliable avec les valeurs démocratiques.
Aujourd’hui, la guerre « d’entre nous » reste encore le symbole d’une situation politique malsaine et inextricable. Ces Algériens assassinés et enterrés sans sépulture sont tout aussi innocents que les survivants. Vingt ans plus tard, aucun lieu mémoriel n’a été inauguré pour rendre hommage aux victimes de Bentalha sacrifiées. C’est pourquoi il est urgent de regarder en face la barbarie dont le peuple est victime. Un monument érigé en l’honneur des victimes de la décennie noire est nécessaire afin de lutter symboliquement contre l’oubli et le mépris de la vie humaine. Ces souffrances « d’origine socio-politiques » déniées sont telles « des braises qui crépitent dans des cendres refroidies d’un feu de mort » dirait Claude Allione. Reconstruire une mémoire collective, dans tel contexte, ne se réduit pas à des offres compassionnelles et provisoires (pension symbolique, centre d’hébergement, écoute et/ou soutien psychologique, etc.) qui permettent certes de colmater les brèches sans pour autant régler la problématique de la responsabilité. Cette politique totalisante a été largement critiquée dans la mesure où le travail de deuil, de mémoire et de vérité ont été détruit au nom de l’idéal républicain « l’unité nationale ». Or, la reconnaissance de la victime exige nécessairement le respect des droits– que ce soit pour les morts ou les vivants – à travers lequel s’enracine le sentiment d’apaisement dans leurs cœurs des victimes. Que l’on veuille ou pas, la politique de « l’oubli forcé » maintient l’individu dans une position de victime éternelle dont sa double blessure reste sans guérison possible. En plus de la négation des droits d’un peuple endeuillé, une histoire de haine officielle se construit pour empêcher le travail de «réconciliation- reconstruction» dans une « société de mépris » rompue à la haine de la parole.
Chérifa Sider
Quelques références
1) Benrabah, D. (2000, février 14). Le mouvement de défense des victimes du terrorisme a été manipulé. Libre Algérie.
2) Guillot, C. (2005, octobre 6). L’encombrante « madone » d’Hocine Zaourar. Le Monde.
3) Nesroulah, Y., & Mellah, S. (2000). Qui a tué à Benthala ? Paris: La Découverte. 4) Stora, B. (2001b). La guerre invisible. Algérie, années 90. Paris: Les Presses de Sciences Po.