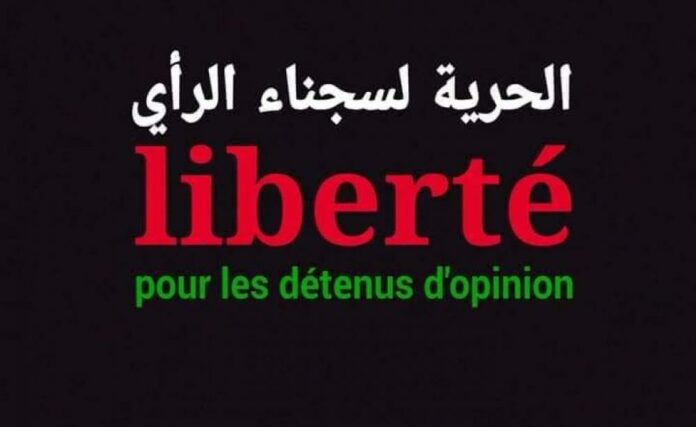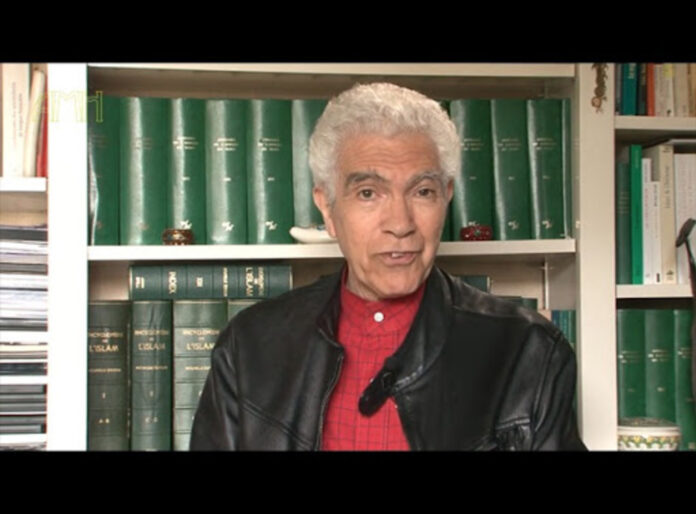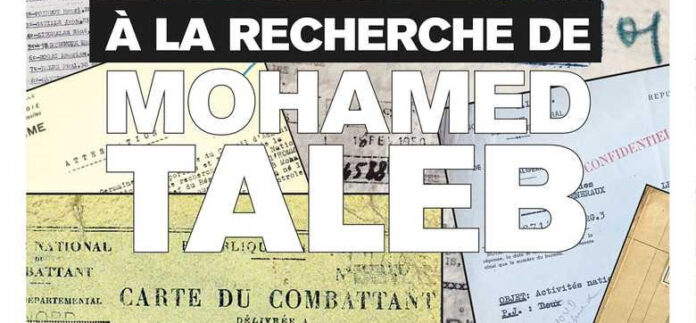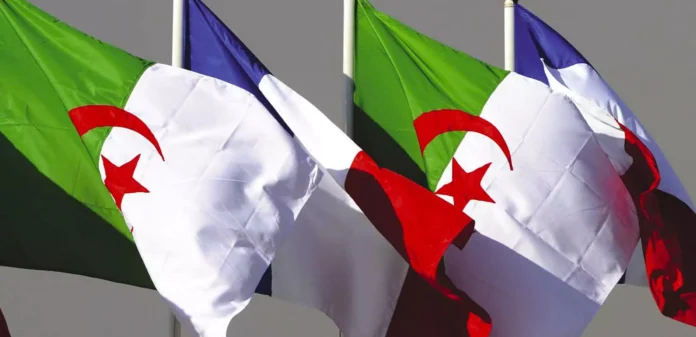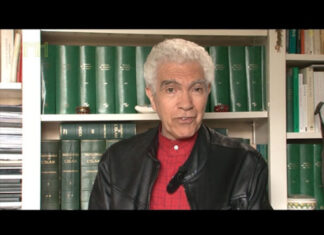Nous publions cette déclaration sur les violations des liberté à l’occasion de la journée mondiale des droits humains. en Algérie. Des responsables de partis, des avocats, des activistes, des universitaires, des citoyens et des journalistes interpellent les autorités sur la répression qui sévit dans le pays.
Cette année encore, nous célébrons la journée mondiale des droits humains coïncidant avec le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de L’ONU acceptée par l’Algérie au lendemain de son indépendance, dans un climat de répression et de restrictions des droits fondamentaux des Algériennes et des Algériens.
Encore une fois, ce 10 décembre marque une année sombre pour les Droits de l’Homme en Algérie. Après des mois d’une mobilisation populaire pacifique, d’un Hirak qui a suscité un grand espoir pour établir un Etat de droit démocratique garantissant les droits de l’Homme, l’action des autorités se caractérise par une volonté affichée d’étouffer tous les espaces civiques autonomes et de criminaliser l’action politique des voix critiques.
Tandis que l’ensemble de la société est confronté à une crise sociale , économique et sanitaire aigue, plus de 500 personne ont été mis en détention et plus de 7000 mille personnes été interpellés dans la seule année de 2021 juste pour le fait d’avoir exercé leurs droits fondamentaux d’opinion, d’expression . et de manifestations pacifiques Pourtant garantis par la loi, Le nombre de personnes qui sont en poursuites judiciaires dépasse les 2500 .
Des libertés fondamentales bafouées
Alors même que depuis la révision de la Constitution en novembre 2020, la liberté de manifestation pacifique est censée être garantie et s’exercer sur simple déclaration. Non seulement la loi applicable en la matière qui instaure un régime d’autorisation n’a pas été révisée pour la mettre en conformité avec la Constitution, mais l’interdiction de fait de toute manifestation publique continue d’être appliquée. Toute tentative d’exercer la liberté de manifestation pacifique mène aujourd’hui sûrement à des poursuites pénales pour attroupement. De même, la liberté d’association est réduite à sa plus simple expression dans le pays.
Au plan juridique, la loi actuellement en vigueur particulièrement restrictive n’a toujours pas été mise en conformité avec la Constitution révisée. Surtout, la récente dissolution judiciaire de l’association RAJ montre à quel point la liberté d’association est fragile.
Des partis politiques de l’opposition PST et UCP sont menacés de dissolution, des militants politiques sont l’objet d’harcèlement et de détentions arbitraires a l’image des responsables de SOS Bab El Oued et du MDS , ces mesures apparaissent comme un signal fort de dissuasion à destination des organisations gênantes pour le pouvoir. La liberté de la presse est encore plus fragile. L’interdiction constitutionnelle de la privation de liberté pour les délits de presse est contournée dans les faits.
Ce contournement s’ajoute aux divers moyens devenus classiques, comme les contrôles fiscaux et la sélectivité politique de l’accès à la publicité publique, pour instaurer le réflexe de l’autocensure dans la presse. Plus largement, ce sont les libertés d’opinion et d’expression qui sont menacées dans leur substance même par l’extension de la définition du terrorisme et le nouveau dispositif de désignation des personnes et entités terroristes.
L’arbitraire des dispositions pénales relatives au terrorisme
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021, en plus des actes qu’il énumère déjà, est terroriste en vertu de l’article 87 bis du Code pénal. Désormais, revendiquer un changement de régime par des moyens non prévus par la Constitution mais qui ne lui sont pas nécessairement contraires ou ne sont pas violents peut entrer dans la définition du crime de terrorisme.
L’accusation de terrorisme est largement instrumentalisée par les autorités à des fins politiques. Le simple soupçon d’appartenance à une organisation classée terroriste par les autorités selon des critères obscurs suffit pour l’engagement de poursuites pénales. Les arrestations pour terrorisme se multiplient à travers le pays dans le cadre d’opérations qui ressemblent fort à de l’intimidation par leur mise en scène, notamment dans plusieurs villages de Kabylie. Quant au décret exécutif n° 21-384 du 7 octobre 2021 qui fixe les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent, il est tout simplement liberticide et ouvre la voie à l’arbitraire.
En effet, il permet l’inscription sur la liste terroriste – qui est publique – de personnes qui n’ont pas été condamnées judiciairement au mépris flagrant de la présomption d’innocence et du droit à l’honneur tous deux censés être protégés par la Constitution. Ce dispositif est d’autant plus attentatoire aux droits les plus fondamentaux que les personnes inscrites sur cette liste peuvent être privés de leurs biens et de toute activité et, par conséquent, de tout moyen de subsistance. Il s’agit là d’une technique de mise à mort sociale particulièrement dissuasive et d’autant plus dangereuse que la définition du terrorisme est extrêmement large.
73 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 59 ans après l’accession de notre pays à l’indépendance, les libertés les plus élémentaires consacrées par la Déclaration sont vidées de leur substance par la législation et les pratiques.
A cette occasion,
Nous signataires , défenseurs des droits humains et organisations, interpellons le pouvoir au respect de ses engagements internationaux contenus dans les traités et conventions internationales des droits humains ratifiées.
Nous appelons le pouvoir a l’arrêt de la répression et la levée de toutes les restrictions à l’exercice des libertés et des droits fondamentaux.
Nous réitérons notre demande pressante pour la libération inconditionnelle de l’ensemble des détenus d’opinion , des journalistes, défenseurs des droits humains et avocats.
Fait a Alger le 08 décembre 2021
Les signataires :
Associations signataires
ACDA
Appel Egalité
Alternativ Media
Centre Justitia pour la protection légale des droits humains en Algérie
CGATA
Collectif Debout l’Algérie
Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA)
Collectif Groupe Algérie droit devant (CGADD)
Comité de soutien pour les droits humains en Algérie (Montréal)
Femmes plurielles
Ibtykar
LADDH
PUNA
Riposte internationale
SHOAA for Human Rights
SNAPAP
Personnes:
Abdelaziz Ould Ali, universitaire
Abdelhak Mechibeche, juriste
Abdelkrim Boudra, militant associatif
Abdelmoumene Khelil, défenseur des droits humains
Abdelouhab Fersaoui, militant associatif
Abdennour Abbas, professeur d’Université, chercheur en bio-nanotechnologie (Minnesota)
Abdou Bendjoudi, consultant
Adel Abderezak, universitaire
Afif Bouattou, militant pour les droits humains
Ahmed Benberkane, universitaire, Nacera, Brahimi Ali juriste et militant politique, Douici Noureddine journaliste,
Ahmed Dahmani, économiste
Ahmed Mahiou, ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger, ancien président de la commission du droit international de l’ONU, membre de l’institut de droit international
Ahmed Manseri, militant LADDH (Tiaret)
Aïssa Kadri, sociologue
Aïssa Moussi, journaliste
Aïssa Rahmoune, avocat, LADDH
Akram Belkaïd, journaliste
Aldja Seghir, enseignante universitaire et militante
Ali Aït Djoudi, Riposte internationale
Ali Bensaad, géographe
Ali Laskri, militant politique FFS
Alima Boumediène, avocate
Amar Mohand Amer, historien
Amin Khan, écrivain
Arab Azzi, militant politique,
Arezki Aït Larbi, journaliste
Arezki Challal, militant
Arezki Krim, militant
Azize Ghadi, avocat, membre de la LADDH
Belkacem Benzenine, chercheur
Ben Mohamed, poète
Boualem Amoura, secrétaire général du syndicat SATEF
Boudjema Ghechir, avocat et ancien président de la LADH
Boukhalfa Ben Mamar, défenseur des droits de l’Homme
Bouzid Senane, responsable associatif France
Chafia Outerbah, militante de l’immigration
Chouicha Kaddour, syndicaliste, LADDH
Djafar Naït Amar, militant
Djaffar Lakhdari, consultant et militant associatif
Djamel-Eddine Benchenouf, journaliste
Djamel-Eddine Khan, militant LADDH
Djeloul Djoudi, dirigeant du PT
Essaïd Aknine, militant humaniste
Faïza Berber, présidente du Collectif debout l’Algérie
Farid Aïssani, ancien secrétaire national du FFS à l’Emigration
Fatima Benlarbi, journaliste
Fouad Ouicher, militant associatif
Hacene Hirèche, universitaire, consultant
Hakim Taïbi, journaliste
Hamid Arab, directeur du site d’information Le Matin d’Algerie
Hamid Challal Hamid, militant des droits de l’Homme
Hasni Abidi, chercheur,
Hicham Khiat, militant politique
Hmimi Bouider, militant du FFS et du HIRAK
Hocine Boumedjane, CDDH Bejaïa
Hocine Mezouar, retraité paramédical
Iddir Nadir, journaliste
Ihsane el-Kadi, journaliste
Ilyas Lahouazi , membre du conseil national du RCD immigration
Kamel Aïssat militant politique et syndicaliste
Kamel Ouhn journaliste
Kamel Tarwiht, journaliste
Karim Aïmeur, journaliste
Karim Azzoug, producteur
Karim Bellazoug, militant
Karim Kebir, journaliste
Karim Labchri, dirigeant du PT
Karima Aït Meziane, universitaire
Khaled Tazaghart, militant politique
Kouceïla Amer, consultant
Lahouari Addi, professeur émérite à Sciences-po Lyon
Lahouari Fellahi, militant et universitaire
Lalia Bedjaoui, militante
Lila Mansouri, militante FFS-France Nord
Louisa Aït Hamadouche, universitaire
Louisa Hanoune, secrétaire du PT
Louiza Hanoune, secrétaire générale du PT
Lyazid Benhami écrivain
Lyes Djebaïli, militant associatif
Lyès Touati, militant associatif
Lynda Abbou, journaliste
Madjid Benchikh, ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger
Madjid Hachour, avocat
Madjid Medkhi, journaliste
Mahieddine Ouferhat, militant associatif, ancien président du FFS immigration
Mahmoud Rechidi, secrétaire général du PST
Malek Sebahi, militant politique et membre LADDH Bejaïa
Malika Bakhti, ingénieure d’études
Malika Baraka, médecin
Malika Benarab-Attou, militante politique, ancienne députée européenne (EELV)
Massensen Cherbi, constitutionaliste
Menad Amrouchi, défenseur des droits de l’homme
Menad Si Ahmed, Riposte Internationale (Autriche)
Metref Arezki, journaliste
Mhenna Abdesselem, universitaire
Mohamed Benaïssa, militant du PUNA
Mohamed Fellag, comédien
Mohamed Hennad, universitaire
Mohammed Bakour, enseignant-chercheur
Mohammed Idir Yacoub, architecte, militant FFS
Mohand Bakir, citoyen
Mohcine Belabbes, président du RCD
Mokrani militant associatif
Mostefa Bouchachi, avocat
Mouloud Boumghar, universitaire
Mourad Yefsah, militant politique
Moussa Ouyougoute, journaliste
Mohamed Iouanoughene journaliste
Nabila Bekhechi, chercheure
Nabila Smaïl, avocate et militante politique
Nacer Djabi, sociologue
Nacer Ouabbou, universitaire (Costa Rica)
Nacéra Hadouche, avocate
Nacima Ourahmoune, chercheure
Naoual Belakhdar, politologue
Nassera Dutour, présidente du Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA)
Nora Ouali, ex-députée et membre du SN RCD
Noureddine Benissad, avocat,
Noureddine Melikchi, physicien
Nouri Nesrouche, journaliste
Omar Bouraba, militant associatif
Omar Eddine Bentahar, militant LADDH
Ouaamar Saoudi, du SN à la coordination du RCD
Rabah Moulla, enseignant et militant
Rabah Rezgui, militant LADDH Bejaïa
Rachid Aïssaoui, universitaire
Rachid Aouine, SHOAA for Human Rights
Rachid Malaoui, syndicaliste
Rafika Gherbi, journaliste
Raouf Farah, géographe
Redjala, militante associative
Sadek Chouali, syndicaliste
Sadek Hajou, militant politique
Saïd Boudour, journaliste
Saïd Khelil, militant politiques pour les libertés
Saïd Salhi, LADDH
Salah Abderahmane, avocat
Salah Oudahar, poète, directeur de festival
Salah Taibi, responsable associatif (France)
Salim Mechri, LADDH
Samia Ammour, militante féministe
Samir Larabi, journaliste
Samir Yahiaoui, architecte analyste, militant politique
Sanhadja Akrouf, militante féministe
Sofiane Chouiter, avocat
Tahar Khalfoune, universitaire
Tayeb Kennouche, sociologue
Tewfik Allal, militant associatif de l’émigration
Wezna Cheikh Lounis, syndicaliste et militante démocrate
Yacine Bouzid, avocat
Yasmina-Karima Bennini, journaliste
Yazid Temim Yazid , Riposte Internationale (Beauvais)
Yidir Ounoughene, militant politique
Youcef Ammar-Khoudja, activiste du Hirak
Youcef Kacimi, défenseur des DH, enseignant universitaire
Youcef Rezoug journaliste
Youssef Tazibt, dirigeant du PT
Zahra Harfouche, avocate
Zaki Hannache, défenseur des droits humains
Zineb Ali-Benali, professeure des universités émérite
Zoheïr Aberkane, journaliste
Zohra Bouras journaliste
Zoubida Assoul, avocate et présidente de l’UCP
Zoubir Rouina, syndicaliste
#StandUp4HumanRights
#HumanRightsDay2021
***Pour info cette liste a été arrêté ce matin.
La collecte des signatures se poursuit, une deuxième liste suivra