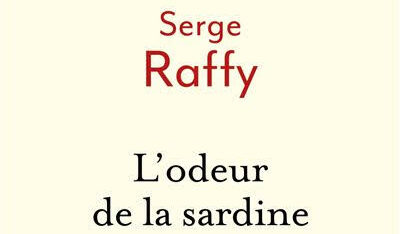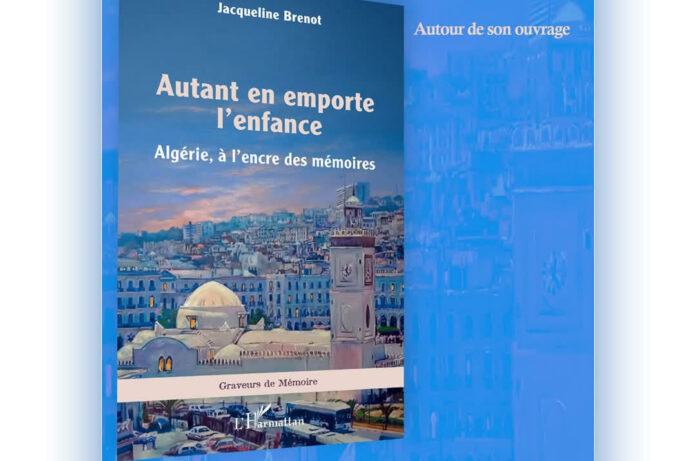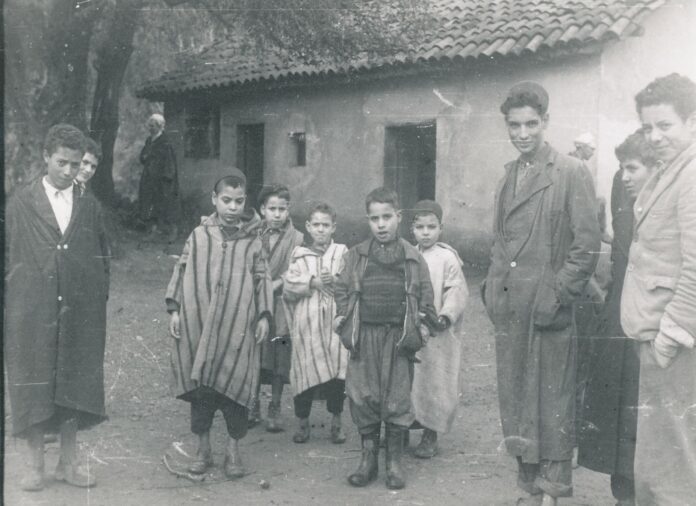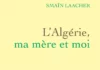Souvent, les hommages se murmurent trop tard, lorsque le silence a déjà pris possession des voix. Rompre avec cette habitude, c’est reconnaître, de son vivant, ceux dont la parole et l’action et la réflexion appartiennent déjà au patrimoine moral et politique d’un pays.
Djamel Zenati est de ceux-là : militant infatigable, incorruptible, enraciné à la fois dans les réalités populaires et dans la haute tradition de la pensée politique, nourrie par l’expérience concrète de son peuple. Depuis plus de quarante ans, il occupe cette ligne fragile où la réflexion n’est pas un luxe académique, mais un instrument de libération.
Il est un intellectuel populaire — et l’expression, ici, n’a rien de condescendant. Elle désigne celui qui, nourri par l’histoire et les réalités vécues de son peuple, le droit et l’économie politique, refuse le jargon des cénacles pour restituer aux concepts leur force vive, traduite dans une langue que le peuple peut s’approprier sans qu’elle perde sa rigueur.
Ni universitaire enfermé dans une tour d’ivoire, ni tribun populiste distribuant des illusions, Zenati est ce pédagogue intransigeant qui parle à la fois la langue des livres et celle des places publiques, qui cite Abane Ramdane et Karl Marx dans la même phrase, sans jamais se couper de l’expérience quotidienne des Algériens.
Ses années universitaires à Tizi-Ouzou furent marquées par l’effervescence intellectuelle et l’engagement au sein du Mouvement culturel berbère. En avril 1980, il a vingt-deux ans lorsque éclate le Printemps berbère, dont il est l’un des initiateurs et, peu après, le plus jeune détenu politique. Les manifestations pour la reconnaissance de l’identité amazighe et des libertés fondamentales sont réprimées dans la violence.
De cette lutte pour la reconnaissance pleine et entière de la dimension amazighe de l’Algérie, Zenati tire la conviction que la véritable réalisation ne peut advenir que dans une Algérie démocratique. Il comprend surtout que culture et politique ne sont pas deux sphères séparées, mais « en constante interaction » : la culture est un champ de bataille où se forgent les consciences et où se prépare la souveraineté populaire.
Héritier direct du Printemps berbère, Djamel Zenati établit un lien organique entre ce soulèvement et les mobilisations citoyennes du Hirak : « Le printemps amazigh est incontestablement le précurseur et le catalyseur du combat démocratique en Algérie », affirme-t-il. Cette révolte culturelle n’a pas seulement revendiqué une identité, mais ouvert l’espace des libertés, brisé le monopole du parti unique et posé la question de la souveraineté populaire.
Selon lui, l’insurrection citoyenne d’aujourd’hui prolonge, à bien des égards, le printemps berbère — lui-même ancré dans la lutte de libération nationale — et, « le système n’a pas d’autre choix que de disparaître ». Ainsi, le combat démocratique, l’héritage anticolonial et la revendication d’une pluralité culturelle se rejoignent pour former un même mouvement historique.
Sa pensée politique repose sur un concept central : le pacte de souveraineté. Ce pacte articule deux dimensions : une dimension contractuelle, au sens classique, où la société fonde la légitimité du pouvoir politique ; et une dimension historique, où ce pacte n’est pas universel et abstrait, mais enraciné dans l’expérience algérienne et dans les exigences d’une transition démocratique.
La pensée politique évoquée ici s’inscrit dans la filiation des grandes théories du contrat social, mais elle les transpose au contexte algérien contemporain. Le pacte de souveraineté n’est donc pas conçu comme une construction juridique détachée de la réalité, mais comme un compromis historique, enraciné dans l’expérience collective du peuple.
Sans ce pacte, avertit Zenati, les constitutions et textes normatifs risquent de demeurer des coquilles vides, condamnées à être dévorées par la « norme réelle » – c’est-à-dire ce pouvoir informel, clientéliste et opaque, qui supplante le droit écrit. En ce sens, la référence implicite est aussi à Marx et Gramsci : la norme juridique ne peut survivre que si elle correspond à une hégémonie politique réellement acceptée, issue d’un compromis social partagé.
Pour lui, la transition démocratique consiste à traduire « les exigences du mouvement populaire en pacte historique qui soit de nature à renouveler la perspective historique en Algérie, un pacte qui puisse mettre le pays dans la voie du progrès et du développement ». Toute architecture institutionnelle doit, selon lui, répondre à trois questions radicales : à qui appartient la souveraineté, comment s’exerce-t-elle et pour quelles finalités ? Sa réponse est sans équivoque : « La souveraineté, c’est la capacité inaliénable reconnue au corps des citoyens de décider librement de son destin. » Sans ce compromis historique, issu de l’expérience vécue, la norme écrite reste condamnée à être dévorée par la « norme réelle », ce pouvoir informel qui opère dans l’ombre.
Cette exigence le conduit à défendre l’idée d’une transition démocratique pacifique, graduelle et négociée. Ce n’est pas frilosité, mais lucidité stratégique : l’histoire récente a montré combien les ruptures abruptes peuvent précipiter les sociétés dans l’aventure autoritaire ou la régression sanglante. « L’Algérie n’a pas besoin d’un saut dans le vide, mais d’un chemin clair vers un État démocratique et social », insiste-t-il. La négociation, pour lui, n’est pas compromission mais méthode : elle permet de construire un rapport de forces capable d’imposer des réformes irréversibles et de prévenir le chaos. Mais il se méfie tout autant des « transitions gérées » par le pouvoir, simples manœuvres de survie, que des appels au renversement immédiat sans projet structuré.
Sa critique vise les consensus de façade qui, sous couvert d’unité, dissimulent ambitions personnelles et compromissions. « Le fameux consensus serait alors un simple emballage devant sceller un concubinage avec le pouvoir et couvrir des ambitions ministérielles », avertit-il. Pour Zenati, un tel arrangement ne fonde pas l’unité politique, il la mine. Le consensus, lorsqu’il se réduit à un calcul opportuniste ou à un compromis de circonstances, tue le politique. Dans cette perspective, mieux vaut un désaccord franc qu’une alliance trompeuse. Le désaccord, s’il est ouvert et transparent, peut être fécond : il favorise l’affrontement des idées, stimule la délibération collective et permet l’émergence d’une volonté générale. Ce raisonnement rejoint la critique de Carl Schmitt, pour qui le politique ne naît véritablement que là où le conflit est clairement nommé, c’est-à-dire sur un conflit assumé, et fait également écho à Hannah Arendt, qui voyait dans la pluralité humaine et la confrontation des différences la véritable source de la vie politique et la fin de la politique c’est le début de la violence.
Dans sa lecture de la crise algérienne, le déficit le plus profond n’est pas seulement institutionnel, mais militant. D’où son appel à « réinventer le militantisme » : sortir des postures spectaculaires, renouer avec les luttes concrètes sur le logement, l’emploi, la santé, l’éducation, et « réhabiliter les idées et la production du sens ». Sa « rébellion positive » vise à briser les archaïsmes culturels et les réflexes d’allégeance qui nourrissent l’autoritarisme. Cet appel à « réhabiliter les idées et la production du sens » s’apparente à une exigence arendtienne : redonner à la politique sa dimension de création, de discours et d’action. Pour Arendt, la véritable liberté politique naît de la capacité des citoyens à prendre la parole, à agir ensemble et à inaugurer du nouveau.
Dans un pays où la norme réelle dévore la norme écrite, où l’idéologie sécuritaire fait de l’armée « non pas la colonne vertébrale de l’État, mais l’État lui-même », Zenati ne cesse de rappeler que la dignité et la liberté ne se mendient pas : elles se conquièrent. « Il n’y a pas de voie royale pour la transition démocratique. Chaque peuple puise dans ses ressources. Les chemins sont singuliers, mais universelle est l’aspiration de l’homme à la liberté et au bien-être. » Sa maxime — « théorie et pratique, réflexion et action ne sauraient être dissociées » — condense un équilibre rare : lucide sur la corruption et la résistance du système, confiant dans la capacité de la mobilisation citoyenne à les renverser.
Qu’il s’agisse des expériences de transition en Amérique latine ou en Europe de l’Est, ou encore des grands conflits mondiaux tels que la question palestinienne, Zenati se distingue par une vaste érudition. Il mobilise les enseignements tirés d’autres contextes sociopolitiques tout en les confrontant de manière critique à la réalité algérienne, sans jamais s’en détacher. Dans Palestine trahie, publié en 2014, il déploie une lecture du système international alliant précision politique et profondeur sociologique. Il y déconstruit les postures officielles arabes face à la cause palestinienne : derrière les discours enflammés, il révèle l’impuissance organisée, les calculs diplomatiques, les connivences tacites avec les puissances occidentales et l’abandon stratégique d’une cause érigée en mythe fondateur. Le terme de « trahison », emprunté à Kateb Yacine, désigne un mécanisme structurel : la rhétorique nationaliste masque la capitulation devant une logique impériale.
Djamel Zenati situe le conflit israélo-palestinien dans ce qu’il appelle le « choc des empires », bien plus que dans le « choc des civilisations » ou les « guerres de religion ». Ce sont, explique-t-il, les rapports matériels — contrôle des ressources, domination des marchés, sécurisation des alliances — qui structurent les alignements. Israël devient « prétexte et base arrière » de l’Occident au Moyen-Orient, réussissant à s’implanter là où la géographie avait échoué : inscrire l’Occident dans l’Orient.
Il en donne aussi une lecture sociologique : la montée de l’islamisme radical, incarnée par le Hamas, résulte de la rétraction des classes moyennes sous la pression de la mondialisation, cherchant refuge dans un repli identitaire. Ce glissement déterritorialise la lutte palestinienne et sert objectivement les extrémismes israéliens en enfermant le conflit dans une guerre sans fin.
Formulé il y a plus d’une décennie, ce diagnostic demeure d’une brûlante actualité : fragmentation régionale, multiplication des ingérences extérieures, persistance des régimes autoritaires. Tant que le Maghreb et le Machrek resteront des terrains de projection pour les puissances impériales et que les élites locales refuseront les « révisions déchirantes » qu’il appelle de ses vœux, la cause palestinienne restera un instrument rhétorique vidé de sa finalité : l’édification d’un État souverain et démocratique.
Sa méthode se résume dans une maxime : « Il faut toujours construire à partir du réel. » Idéaliser le réel mène au populisme, le sous-estimer méne à l’intellectualisme stérile. Le populisme grossit et manipule un instantané ; l’intellectualisme tente de couler la société dans un moule inadapté. Il faut observer, écouter, scruter les ressorts profonds et les conflictualités cachées. Cette approche, mêlant réalisme pragmatique de Raymond Aron et rationalisme critique de Karl Popper, rejette les idéologies globales et les simplifications abusives, valorisant les améliorations progressives validées par l’expérience.
Réaliste dans le discours, optimiste dans l’action, Djamel Zenati incarne un équilibre rare : lucide sur la persistance des structures de domination, confiant dans la capacité de la mobilisation citoyenne à les renverser. Parler de lui au présent, c’est déjà affirmer que l’histoire reste ouverte, à condition d’avoir, comme lui, le courage de la penser, la lucidité de l’analyser et l’honnêteté de la servir.
Chez Zenati, l’engagement intellectuel ne se sépare jamais de l’action politique : analyser, c’est déjà combattre. Et rappeler que la dignité des peuples, qu’ils soient en Palestine, au Maghreb ou ailleurs, ne se négocie pas dans les marges feutrées des conférences internationales, mais se conquiert dans la lucidité, la mobilisation et le refus de la résignation.
Parler de Djamel Zenati au présent, c’est déjà résister à l’oubli. Sa voix appartient au patrimoine moral et politique de l’Algérie, non comme relique, mais comme instrument vivant de combat. Dans ses phrases se croisent l’ombre de Matoub Lounès, la rigueur d’Aït Ahmed, l’écho de la rue algérienne et la discipline de l’intellectuel qui sait que les textes n’ont de force que s’ils sont habités par la volonté populaire.
Rendre hommage à Zenati de son vivant, c’est affirmer que l’histoire reste ouverte, à condition d’avoir, comme lui, le courage de la penser et l’honnêteté de militer.
Prof. Dr. Rachid Ouaissa
- Publicité -