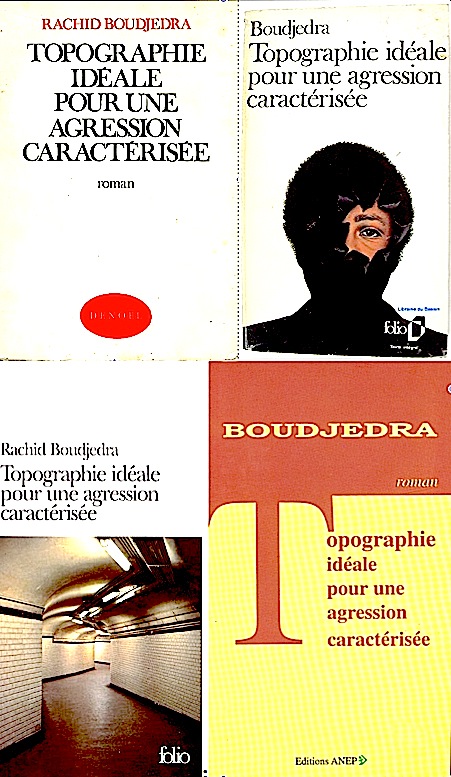
Rachid Boudjedra a trahi en partant d’une Algérie en pleine mutation. Il a aussi violé les tabous d’une société qui est la sienne en divulguant des secrets en les étalant au grand jour. Tout cela pour tirer un bénéfice en lui assurant des droits d’auteur non négligeable.
C’est ce que nous pouvons encore lire sur l’Annuaire de l’Afrique du Nord du 12/1973 sous la plume de ce que fut Jean-Claude Vatin, disparu en 2021, dans Littérature et société en Algérie : Rachid Boudjedra ou le jeu des confrontations. Il était question de l’auteur du Démantèlement et de L’Insolation et non de celui de Topographie idéale pour une agression caractérisée.
Le Boudjedra dont il est question est celui du Démantèlement et de L’Insolation. Mais, celui de Topographie idéale pour une agression caractérisée est totalement ignoré, à peine si Bernard Poirot-Delpech l’évoquait dans Le Monde du 3/10/1975 dans sa chronique intitulée « Saïd dans le métro » pour dire que les voyageurs français du métro parisien « ont autre chose à faire que de renseigner des bicots qui cherchent leur cousin ». Ce sont ces bicots que tout le monde aime parce qu’ils ont du bon pour « les gros travaux » et qu’ils ne soient pas toujours obligés de venir en France.
Le lascars dont parle Boudjedra dans Topographie… étaient quelque 871 223 en 1974 pour devenir 884 200 paysans analphabètes en âge de nettoyer les ordures de France et de Navarre et de bâtir le capitalisme monopoliste des quartiers de La Défense et sa sous-culture au Centre Pompidou, après avoir mis sur pied le capitalisme colonialiste de la Compagnie générale et de la BN Parisbas. Rachid Boudjedra des années 1970 était encore un jeune poète Chaoui en colère d’une Algérie en transition vers un bureaucratisme féodal d’Etat. Certaines plumes parisienne le classé comme intellectuel francisant déchiré, vivant un malaise et une inadéquation avec sa communauté. Sa littérature est comparée à l’électrochoc, celle de la remise en cause et de la démystification.
Il est celui qui prend place dans « ce courant littéraire nord-africain non pas gentiment, mais en ouvrant la porte d’un coup de pied et en bousculant les fauteuils. Il entre avec effraction comme un malade halluciné et en délire », écrivait le Père Jean Déjeux, un excellent gendarme de la littérature algérienne. C’est aussi celui « qui dit non à une société où l’hypocrisie religieuse et le refoulement sexuel sont les plus sûrs garants de l’oppression politique » (Le Nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays, Robert Lafont, 1994). En sommes, un écrivain qui a le plus reçu de tirs croisés entre lance-roquettes de 105 mm et des canons de 155 mm, afin d’anéantir tout reste de son ADN.
Il n’est pas facile d’être un jeune étudiant en philosophie sous la double bannière de Jean-Paul Sartre et de Louis Althusser et de revendiquer d’être lecteur du fascisant Louis-Ferdinand Céline dans la peau d’un militant du PCA-PAGS révisionniste tout en restant dans une France en pleine crise économique. Il est temps de faire sa valise et d’atterrir au ministère de l’information et de la culture de M. Redha Malek.
A cette époque, il n’est pas question de soi face aux « tâches de l’heure » pour l’édification d’un socialisme qui tardera à venir. Il n’est n’on plus question d’étaler son narcissisme, ni d’une quelconque liberté du corps et le freudo-marxisme est totalement banni de la Charte islamo-socialiste de 1975.
En quittant Paris, Rachid Boudjedra avait retenu la leçon de Milan Kundera, qui disait dans Le Monde du 23/1/1976 que « le rôle du roman n’est pas de dénoncer les évènements politiques, mais de donner à voir les scandales anthropologiques ». Là, il décide de laisser le corps sans sépulture de « Saïd dans le métro » victime d’un crime raciste à la station de la Porte-de-Clichy. Si Topographie… est un texte conçu par l’esprit de son auteur sans être perçu par ses sens, la géométrie des lignes du métro parisien qui déferlent le long de ce texte ont pour objet de solides idéaux. « Il y a dans l’âme du peintre autant d’idéals que d’individus », disait Baudelaire et c’est là où Boudjedra marquera son signe presque magique en élevant un acte criminel et d’ignominie humaine à la hauteur d’un esthétisme littéraire afin de configurer tout un pays à partir d’un seul lieu.
Que vaudrait aujourd’hui un tel texte au milieu d’une littérature mondiale en pleine récession ? Des mots que l’on prime parce qu’ils racontent un inceste dans une campagne alpine, un Cameroun totalement vidé de sa population où il n’y a que « des exilés européens qui vivent les uns sur les autres » ou encore des bouts de phrases d’étudiant en agronomie qui entendent relever le défi de l’impérialisme écologique… en élevant des vers de terre. Une littérature qui s’écrit par de jeunes gens qui narrent le parcours d’un personnage de 82 ans ayant vécu une Italie de la première moitié du XXe siècle. C’est cette littérature made in ChatGPT que l’on bazarde à la gueule d’un lectorat bien emprisonné dans la galaxie de la consommation, afin qu’il élabore son prix.
Topographie… est le roman qui « enfonce des portes plus qu’entrebâillés », écrit-on encore à la sortie du bouquin en librairie et que le lecteur français de Boudjedra « risque de s’insurger contre ses descriptions de situations faites aux travailleurs immigrés-émigrés », l’antiracisme des uns y trouvera « de quoi alimenter ses fureurs et son masochisme », et le racisme des autres, « n’y reconnaîtra que la loi d’airain des rapports de force entre Développés et Sous-développés ». Une belle galerie qui s’ajoute aux 250 librairies et les 230 boutiques réparties entre 345 stations et quelques 200 km de couloirs. Ce qui laisse dire à une certaine parisienne de l’époque, que ce troisième roman « se rattache à un courant qui emprunte plus aux idées en cours en Occident, qu’au fonds culturel propre à l’auteur ». Une bien sournoise intelligence de récupérer l’œuvre à la récup dans l’amas des Michel Butor, Alain Robbe-Grillet et autres Beckett.
A lire l’ensemble de ces avis, on finira par croire que l’écrivain algérien n’a fait qu’imiter une voie littéraire tracée par L’Etranger de Camus. Un Arabe sans identité claire, errant dans le métro parisien à la recherche de sa station afin de rejoindre son cousin, marié à une Française, prendre avec lui le couscous d’orge et lui remettre une valise bourrée de petits paquets ficelés venant du douar et destinés aux membres de la communauté installée dans le pays de la Contrée (entendre la France). L’Arabe finira per être victime d’un absurde assassinat perpétré par « de jeunes voyous » venant de nul part.
L’Arabe de Boudjedra est-il comestible à ce point avec celui de l’auteur de Caligula ? Il faut délirer pour le croire. Le paysan du pays du Piton (entendre l’Algérie) est certainement l’anti-héros camusien puisqu’au fur et à mesure « où celui-ci avance dans le roman, celui-ci piétine, de quais en couloirs et de correspondances en changements », laissant chez le lecteur algérien, cette frustration de l’émigré qui s’intensifie jusqu’à son assassinat. Un crime qui s’inscrit comme résultat d’un ensemble de faits tracés dans le roman.
En faussant « la topographie et créant artificiellement des semblants d’espaces » (Topographie…, 1975, p. 16), Boudjedra case son paysan au cœur du métro où les lignes géométriques sont avant tout cette « frontière honteuse ébauchée en hâte » (p. 19), des lignes « aux couleurs variées, lignes enchevêtrées les unes dans les autres » (p. 20) transformant le métro en taxi souterrain. C’est au cœur de ce dernier que s’inscrit toute la géopolitique de ce roman. En adoptant les formes géométriques de l’enfermement, l’écrivain « rappelle les zones interdites entourés de fer barbelé dont le substrat sur le papier est le pointillé » (p. 23), une transposition mémorielle qui ouvre un chemin, jusque-là non explorer dans l’écrit de Boudjedra, ignoré consciemment ou non, tout juste pour faire de cet auteur un écrivain de la « violence ».
Mais cette « violence primitive » dont il est question est celle qui a été imposée par cette ville dont le métro n’est qu’une image inversée où chaque station renvoi à un prolongement urbain à sa surface. Le type à la valise du roman, n’est autre que cette petite bête qui git entre les racines d’un arbre aux deux rives de la Seine. Il fait partie de ces laskars, le mot est d’ailleurs d’origine arabe, note Boudjedra (p. 36) qui veut dire soldat et dont le sens a été modifié en 1830 devenant le familier de brave homme et malin – , un être qui se levait chez lui dans le Piton (entendre l’Algérie) « pour aller cueillir les abricots ou moissonner le blé » (p. 96), alors que dans le pays du cloisonnement labyrinthique, le temps est à la grasse matinée.
Le Piton-Algérie est ce pays du temps qui passe, des saisons qui s’enroulent et des illusions qui se perdent dans « les formations politiques des masses, propagation des idées antireligieuses, apprentissage intégral des paradoxes » (p. 141). Un pays où « la République Communiste Verdoyante » (p. 160) penne à « tenir des réunions pour expliquer la réforme agraire » (p. 147), un pays porté par le discours de l’auteur-narrateur comme indices d’une localisation et repère de l’histoire de ceux qui se trouvent à la surface du dédalique métro qui ne fait partie de l’existence de ce paysan qui le traverse en 7 itinéraires différents. En surface, les compatriotes du malheureux « se retrempent dans les salles toujours pleines (…) à l’affût, ou bien de nouvelles fraîches parvenues de la Contrée (…) ou bien d’informations de première main concernant un chantier où l’embauche serait organisés clandestinement » (p. 197).
Des salles « saupoudrés de sciure absorbant les viscosités sanguinolentes » (p. 199) en présence de poitrinaires ébouriffés qui ne jouaient plus aux dames dans les cafés-maures de Barbès, mais plutôt aux échecs au jeu militaire de la tactique et de la stratégie, « sillonnant la Mégalopolis à scooter, les deux premiers en avant et le troisième en couverture, éparpillant leurs paquets bien ficelés là où il fallait » (p. 201). Des individus qui « arrivant toujours avant la police pour récupérer l’argent, les ordres et les pistolets mitrailleurs » (p. 201) en soudoyant des brigadiers corses et des commissaires vireux, changeant de piaules toutes les nuits et faisant des balades en train jusqu’à Mourepiane (R. Boudjedra). Ceux-là mêmes qui ont appris par cœur, tous les itinéraires du métro, lieu de leurs rendez-vous clandestins, ils venaient pour déposer « dans ses corbeilles à papiers, des armes et des tracts, que d’autres venaient, discrètement, récupérer » (p ; 202), afin de commettre les attentats contre ceux qui ont laissés leur unique vache atteinte de tuberculose au pays du colonel « Atatürk » (p. 96) et celui de leur « grand vizir » (p. 225) qui décidera de l’arrêt de l’émigration le 19 ou 20 septembre 1973.
Mohamed-Karim Assouane, universitaire.

