« Deleuze cite les paroles suivantes de Sartre : « En un mot, la littérature constitue la subjectivité d’une société en état de révolution permanente. ». » (1)
Aller au secours d’un des siens, ce ne peut être qu’une vertu que naturellement tous louent. Mais la victime a réussi à s’attirer les regards de « l’aristocratie du monde » (Régis Debray). Qu’est-ce qui empêche la droite de parler de la vacance du poste d’intellectuel engagé, quand la gauche (pas toute) se désengage de tous ses attributs historiques sans la moindre retenue morale ? Sartre est mort, et je loue sa mort parce qu’il aurait été sali par la vie d’un champ intellectuel où seules quelques tribunes sont diffusées pour défendre les opprimés et où tous prennent leurs distances vis-à-vis des causes humaines. Plutôt en sélectionnent. La solidarité reste une valeur essentielle dont use l’humain pour préserver son humanité et échapper à ce qui vient des dominants. Marie-Claude Blais écrit : « Les idées d’association et de coopération, renforcées par le développement des sciences de la nature, jouent un rôle immense dans l’émergence de la notion de solidarité qui accompagnera toutes les réflexions sur la “science sociale” au cours du siècle. » (1)
Le cas du poète Mohamed Tadjadit et de Boualem Sansal est édifiant. Sansal a atteint l’universalité par le fait d’avoir été emprisonné. L’écho a été bien suivi. La lecture populaire progressiste consacre la rupture avec des concepts creux utilisés comme credo par les chancelleries occidentales et par les espaces où diverses officines exercent. Les intellectuels, on leur accordera les circonstances atténuantes, sont occupés par les guerres menées par les sionistes au peuple palestinien et par la guerre russo-ukrainienne. Rien de cela : silence radio. La scène intellectuelle s’est-elle tellement ringardisée, voire infestée ? Si les détenus d’opinions ne sont pas défendus par les intellectuels progressistes, c’est parce qu’ils auraient été porteurs de messages qui n’intéressent par les chancelleries occidentales. Jamais vu, les détenus sont livrés à la répression exercée par le pouvoir et leur cas n’a pas eu de portée à la mesure de l’universel. Celui-ci n’atteint pas les « corps vivants invisibles ». Claude Obadia écrit : « Transcendantal selon les uns, chimérique selon les autres, l’universel est régulièrement mis au banc des accusés. » (2)
Boualem Sansal écrivain répondant aux standards « internationaux » ; ça suffit. Non ? C’est défendre la lumière et le génie, c’est vaincre le diable qui loge partout dans les pays décolonisés. Certes, Boualem Sansal a défié le pouvoir dans plusieurs de ses interventions médiatiques du temps du président déchu ; mais il n’a pas refusé le confort auquel donnent accès les médias et les divers espaces culturels. Cela se comprend et…se défend.
En revanche, Mohamed Tadjadit évolue dans un espace qui n’intéresse nullement les progressistes : il écrit au peuple peut-être… en l’essentialisant. La solidarité universelle n’est pas le devoir des seuls peuples civilisés. On voit des partis de la droite algérienne s’allier avec le diable pour laisser la répression s’exercer sans moindre résistance. Le cas de Mohamed Tadjadit incarne le pouvoir qu’ont les droites officielles et populistes sur le peuple. Nos progressistes s’enorgueillissent de leur chauvinisme nationaliste. Nous n’avons pas vu des travaux de recherche universitaires liés à la poésie populaire engagée. Une poésie qui, que je sache, n’existe pas. Cela pose de sérieuses problématiques universitaires, philosophiques, sociologiques et éthiques. « La poésie populaire – chant ou chanson – et le conte sont les deux principaux genres de la littérature populaire. Grâce à la mélodie, la poésie est enregistrée dans la mémoire collective et sa transmission de bouche à oreille, d’une contrée à une autre et d’une génération à une autre, reste assurée. Toutefois, les études consacrées à cette poésie, voire à la littérature populaire de manière générale, sont peu nombreuses, comparées à celles faites sur la poésie « classique »i. » (3)
L’épistémè a joué le jeu
« Les comportements discriminatoires tels que le racisme ou le sexisme s’accompagnent en effet de représentations stéréotypées des groupes à l’égard desquels la discrimination s’exerce… » (4) La stéréotypisation de l’image de l’intellectuel joue contre les poètes populaires. Ceux-ci font intervenir des fragments discursifs sur lesquels les idéologies « nationales » et non « civilisationnelles » ne sont pas en harmonie. Dans l’image occidentale, le poète symbolise la sensibilité la plus extrême et la plus importante ; alors qu’en Algérie, il ne symbolise que l’inverse de la virilité et de la bravoure. Dans ses errances intellectuelles, le sujet algérien colle au poète, pour le discréditer, et à tort, la féminité ; alors que la féminité a ses symboles révolutionnaires et historiques. Si Boualem Sansal est défendu c’est que l’espace sémiotique de l’Occident n’accepte pas que l’intellectuel soit malmené ; mais pour défendre Tadjadit, il faut passer par les réseaux d’influence et les groupes de pression, qui, en Algérie, sont tenus par les conservateurs, toutes tendances confondues, y compris la droite ethnoculturelle. Le poète qui s’exprime en kabyle ou en arabe populaire n’intéresserait jamais les cercles de pression liés à la finance ou au savoir consacré. Ces groupes défendent des thématiques religieuses, d’une part ; et identitaire, d’autre part.
Ecrire en arabe populaire ou en kabyle, c’est se jeter à la marge réservée aux damnés et aux proscrits. Cela nous renvoie directement à la gauche du mouvement d’avril quatre-vingts. La gauche des avrilistes a réussi un coup de maître : chasser l’essentialisation que la droite du mouvement voulait, suite à des tendances pathologiques et à des penchants narcissiques, à tout prix imposer.
En gros, Sansal, c’est Sansal ; Tadjadit, c’est Tadjadit. Tous, dans le système auquel nous appartenons et auquel nous contribuons, savent ce qui les attend : les jeux de coulisses pour certains, des gouttes d’encre pour d’autres, des commentaires de presse pour les journaleux, des fonctionnalités numériques pour les internautes. Et tout se plie en quelques heures. Le système se serait nourri de notre psyché et de notre sang, et tout rentre dans l’ordre. L’imprévu a été prévu. Le commandant de bord ne perd pas son identité ni bio-civil, ni ontique.
Abane Madi
Notes bibliographiques :
- Kôjin Karatani, « La fin de la littérature moderne », dans Fabula-LhT, n° 6, « Tombeaux de la littérature », dir. Alexandre Gefen, May 2009,URL : http://www.fabula.org/lht/6/karatani.html, page consultée le 12 November 2025. DOI : https://doi.org/10.58282/lht.138
- Blais, Marie-Claude. « Solidarité : une idée politique ? ». Solidarité(s) : Perspectives juridiques, édité par Maryvonne Hecquard-Théron, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2009, https://doi.org/10.4000/books.putc.218.
- Obadia, C. (2009). Entre le même et l’autre, l’Universel. Le Philosophoire, 31(1), 113-120. https://doi.org/10.3917/phoir.031.0113.
- In OULED HADDAR, S. (2020). La poésie populaire algérienne dans la Revue africaine: Quelles expressions?. مجلة الواحات للبحوث و الدراسات, 13(2), 1569-1587. https://asjp.cerist.dz/en/article/138078
- Georges Schadron, « De la naissance d’un stéréotype à son internalisation », Cahiers de l’Urmis [En ligne], 10-11 | 2006, mis en ligne le 15 décembre 2006, consulté le 12 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/urmis/220 ; DOI : https://doi.org/10.4000/urmis.220









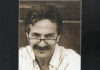

Terreur en Algerie ! Demain seras pire qu’aujourd hui. Bientot il n y auras plus de gaz a vendre et ce seras le retour a l’age de la pierre car on ne produit rien
et le pays est organiser pour bouffer et non produire. La terreur conbre les civils est une premice d’un avenir terrifiant.
La TERREUR du pouvoir MAFFIEUX SANGUINAIRE tenu d’une main ARMÉE par DES MERCENAIRES qui se succèdent par générations interposées …cette terreur qui est en réalité entretenue par des puissances extérieures (et à dessein) ne laisse aucune alternative d’issue pacifique aux Algerien-ne-s pour la construction d’un authentique ÉTAT DE DROIT ou la FORCE DE LA LOI…VIENDRA mettre fin à LA LOI DE LA FORCE…!!! Un TADJADIT embastillé ce sont des millions de TADJADIT qui reprennent le FLAMBEAU