
Armé d’une préface de Serge Barcellini à propos de la « tranches mémorielle » du conflit algérien, d’une solide chronologie et d’annexes précieuses de textes fondamentaux de reconnaissance de diverses mémoires, cette remarquable synthèse apporte beaucoup.
L’introduction distingue histoire et mémoire qui luttent de façon différente contre l’oubli. L’auteur note que la mémoire confond souvent causes et conséquences. Ce qui favorise les thèses complotistes, alors que l’analyse chronologique et scientifique de l’histoire ne s’intéresse qu’aux faits et évite la sacralisation du passé. En découle une « mémoire particulière » des Français d’Algérie qui cultivent la confusion entre histoire et mémoire.
Guy Pervillé démontre tout d’abord que la guerre d’Algérie n’a pas été une simple répétition de la Seconde Guerre mondiale. Ce que laisse entendre le phénomène d’assimilation entre « OAS=fascistes », « harkis=collabos » et « FLN=résistants ». La déviance de cette interprétation usuelle en Algérie entraîne un rejet des pieds-noirs et des juifs. Cette surimposition a persisté au temps de la guerre civile algérienne à la fin des années 1990, de sorte que chaque camp employait les mêmes appellations accusatrices. Ainsi, pour les islamistes engagés dans « une nouvelle guerre de libération », le gouvernement et ses acolytes composés de « nouveaux pieds-noirs » et de « nouveaux harkis » n’étaient que des « collabos » qui pactisaient avec le « parti de la France ». En fait, la seule comparaison possible pourrait être le long conflit des Irlandais se libérant de la tutelle anglaise.
En France, à l’inverse de l’Algérie, il n’y a pas de mémoire officielle. Une phase d’amnistie-amnésie de 1962 à 1992 accompagne des relations franco-algériennes en dents de scie. Comme pour l’autre conflit colonial, l’Indochine, il est difficile de commémorer une guerre perdue, certes quasiment gagnée sur le terrain, mais qui débouche sur un sentiment de honte en raison des moyens indignes d’une démocratie pour y parvenir.
Relatif à la mémoire algérienne pour la même période, le chapitre III est des plus instructifs. Guy Perville a été le premier à définir « l’hyper-commémoration » du 1er novembre 1954, fondement de la légitimité du régime d’Alger.
Cette seule mémoire renvoie au magasin des accessoires le PPA (Parti du peuple algérien) et l’insurrection du 8 mai 1945 tardivement reconnue. Ce ne fut qu’en 1992 que, pour la première fois, le cessez-le-feu, le 19 mars, fut considéré comme fête de la victoire.
Le triomphe du parti unique, le FLN, gomme aussi toute référence commémorative du 19 septembre 1958 où fut proclamé le GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne) au Caire, sous la présidence de Ferhat Abbas. Cette interprétation du passé se retrouve aussi dans la négligence des très riches racines de l’histoire algérienne, depuis les dynasties berbères et l’apport de la civilisation romaine.
Le FLN est fondé sur un discours et un héritage arabo-musulman comme seul fondement de la nation. Il en découle que la période de 1830 à 1962 est vue sous ce prisme déformant, sans tenir compte par exemple des messalistes.
On conçoit combien est essentielle pour l’historien l’étude des textes fondamentaux (dont le Manifeste du peuple algérien du 10 février 1943) mis en lumière par les travaux essentiels de Mahfoud Kaddache et de Mohammed Harbi. Leur analyse des diverses racines du nationalisme et de la nation algérienne a aidé, sur fond d’aspiration au changement de régime en 1988-1989, à la loi de 1989 donnant une certaine liberté d’expression aux chercheurs en Algérie.
Mais cette ouverture tourne court après la mort du président Boudiaf en 1992. C’est la rechute des contraintes mémorielles au moment où le pouvoir, par son discours militant, fait flèche de tout bois pour combattre le FIS (Front islamique du salut) et son avatar sanglant, le GIA (Groupe islamique armé). Le discours officiel reprend alors une expression de l’Etat colonial en utilisant systématiquement le terme de « terrorisme » pour ôter toute légitimité à l’islamisme. Ce qui occulte toute aspiration à la liberté. Ce que l’on retrouve récemment dans la négation du « Hirak » par le pouvoir d’Alger.
Ce qui fit dire, dès 1975, à Mohammed Harbi : « Comment des hommes, dont la résistance force l’admiration, n’ont pas su devenir des hommes libres ? ». En découle la quasi-impossibilité pour le chercheur d’accéder alors aux archives, malgré la revendication de la liberté d’expression revendiquée par les historiens lors de la courte ouverture pluraliste de 1988-1990.
Reste à analyser l’évolution de la mémoire française depuis 1992. La loi du 18 octobre 1999 reconnaissant la guerre d’Algérie est bien un tournant. Elle a été favorisée par l’immixtion de la « seconde guerre d’Algérie » en France, qui rappelle par sa violence et les malheurs du peuple algérien la période 1954-1962.
Les attentats de 1995, l’assassinat à Oran de Mgr Claverie, le 1er aout 1996, la fin des moines de Tibhirine la même année inquiètent l’opinion française. Mais l’auteur souligne fort à propos comme autre cause la dégradation des rapports franco-algériens au crescendo de la guerre civile, et comment le pouvoir d’Alger a manipulé la mémoire grâce à la Fondation du 8 mai 1945, sans tenir compte des travaux des historiens français et algériens (Boucif Mekhaled).
En France, on bute devant l’impossibilité de trouver une date faisant l’unanimité, malgré la loi du 8 novembre 2012, sous la présidence Hollande, qui fait du 19 mars le « jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie », comme « Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie ». Et ce, à la grande satisfaction de la puissante FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie), mesure critiquée par d’autres associations d’anciens combattants.
Les deux derniers chapitres analysent les commémorations de la guerre dans les deux pays. Guy Pervillé observe qu’à Alger la France demeure l’ennemi héréditaire. Si bien que le FLN fixe ses propres dates, dont celle de l’indépendance, le 5 juillet, symbole de la « résurrection » de l’Etat algérien après la capitulation d’Hussein Dey le 5 juillet 1830.
De même, choisi par le président Boumediene en 1966, la date du 20 août, « Journée nationale du Moudjahid » mélange deux événements, à savoir les massacres du 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam. Plus tard, la commémoration du massacre de Paris du 17 octobre 1961 devient la « Journée nationale de l’immigration ».
L’auteur insiste sur les effets pervers de l’article 62, liberticide, de la constitution de 1996 révisée en 2008 qui définit la « soumission » des historiens pour pouvoir enseigner aux jeunes générations.
En découle la manipulation mémorielle des livres d’enseignement. D’autre part, l’Etat algérien glorifie la lutte de libération à travers les monuments symboliques d’Alger : statue d’Abd el-Kader remplaçant celle de Bugeaud, gigantesque mémorial des martyrs de 92 m inauguré en 1982… Toutefois le principal lieu de mémoire est le « carré des martyrs » du cimetière national d’El Alia au Sud de la capitale où sont inhumés Abane Ramdane, Mohammed Khider, Ben Bella…
Pour la France, l’auteur rappelle les diverses manifestations et associations dénonçant les « crimes coloniaux » depuis 1995, la fondation, dix ans plus tard, des « Indigènes de la République » et les passions suscitées en 2000-2002 par la publication de la thèse de Raphaëlle Branche sur la torture et l’armée. Très belle analyse du sort des harkis dont les injustices subies sont reconnues à partir de 1995.
Ce qui conduit à l’association « Harkis et droits de l’homme », en 2004, qui fait peu à peu l’unanimité et lève l’accusation de « collabos » les concernant. Si la mémoire des harkis peut être considérée comme apaisée depuis les efforts de l’Elysée lors de journées d’hommage en 2003 et 2022, il n’en va pas de même pour les Français d’Algérie. Et ce, malgré l’inauguration du monument du quai Branly le 5 décembre 2009. Plus tard y sont rajoutés les 61 tués de la rue d’Isly du 26 mars 1962 et les 1 585 noms de civils disparus, mais pas ceux du massacre d’Oran du 5 juillet 1962 (700 morts selon Jean-Jacques Jordi).
Cette mémoire blessée, de ceux qui se considéraient comme « Algériens », suscite toujours les passions. Notamment depuis l’inauguration en 2007, à Perpignan, avec le soutien du Cercle des algérianistes, d’un monument consacré aux pieds-noirs disparus et enlevés.
En conclusion, l’étude des efforts de la République pour réunifier des mémoires disparates conduit à la politique mémorielle du président Macron, fort du rapport de Benjamin Stora, de janvier 2021, à qui l’auteur reproche de faire la part trop belle à la mémoire au détriment de l’histoire. Le tout au nom de la réconciliation franco-algérienne, dont Guy Pervillé déplore qu’elle ne soit qu’à sens unique : pour l’heure sans aucun effort notable de la part du régime d’Alger.
Jean-Charles Jauffret
Guy Pervillé, Histoire de la mémoire de la guerre d’Algérie, préface de Serge Barcellini, Editions SOTECA, avril 2022, 180 p., 21 euros.


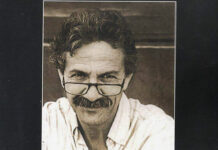







Guy Pervillé fait partie de ces d’historiens qui travaillent à la réduction de l’écriture de la colonisation française de l’Algérie à un conflit de mémoires entre les divers protagonistes : indigènes, pieds noirs, juifs, harkis et … ratons laveurs. Ce qui lui permet, croit-il, d’occulter ou de relativiser les crimes indélébiles et imprescriptibles perpétrés par l’Etat français, en renvoyant dos à dos l’agresseur et l’agressé, l’oppresseur et l’opprimé, puisque la violence, soutient-il, aurait été exercée de part et d’autre!