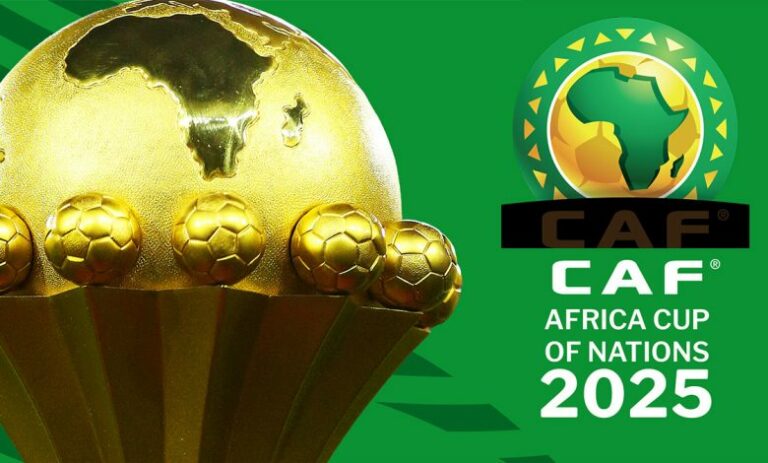Comme dans toutes les luttes pour l’émancipation et les libertés fondamentales, la résistance iranienne est celle d’un peuple qui se veut unique, vaillant et indivisible.
Une résistance tournée vers l’universalisme, d’un infini mouvement de libération à un autre, d’une militante à une autre, d’une femme à des Antigones, créant vie et mouvement partout. Leur lutte nous interpelle et nous renvoie subséquemment à nous, à notre condition d’hommes voilés, à nous autres, hommes de mal qui entendons mal, dont il faut tout rappeler, encore et encore!
Oui, nous rappeler la lutte héroïque des femmes algériennes contre l’islamisme, la bête immonde qui a fait plus de deux cent mille morts en Algérie. Oui, nous rappeler la lutte de Katia Begana, d’ Amel Zenoune, ou encore de ces douze enseignantes sauvagement égorgées par les terroristes islamistes pour avoir refusé le dictat du voile islamique.
Je peux en citer d’autres et d’autres encore, de celles et de ceux qui ont refusé le bonheur asservissant de la religion des Ayatollahs, se soustrayant à ces prophètes de toutes les soumissions, préférant à eux les renégats, adulant les parias. La révolte iranienne est loin d’être une révolte de la faim. Elle est , pour les politiques dont les limites géographiques et intellectuelles ne voguent pas au-delà de la pensée populeuse et islamo-électoraliste, une victoire qui finira par embraser le reste des dictatures islamistes.
Le silence des pantoufles est beaucoup plus assourdissant que le bruit des bottes. Le silence de nos politiques est beaucoup plus asphyxiant que toutes les pendaisons auxquelles la résistance iranienne fait face. Sommes-nous devenus des êtres muets, finis et définitifs? Incapables de trouver dans la lutte émancipatrice des peuples opprimés la partie la plus noble chez nous, les peuples libérés.
Qui mieux que cette vaillante résistance iranienne pour nous rappeler que l’ennemi n’est plus de chair et d’os, qu’il est un ordre, un système mis en corde, un vent glacial, une tornade, une nébuleuse, voire un complot ontologique. Un complot qui tient ses racines dans la genèse de l’Islam politique et de ceux qui lui ont permis de prospérer. Il n’est pas d’hier, ce complot; il remonte à l’avant-veille, avant l’endormissement des consciences sur un amas de brumes et un cortège de ruines.
C’est dans ces moments de massacres à huis clos que la résistance iranienne a plus que jamais besoin de nous. Elle nous révèle l’histoire macabre qui se joue à l’ombre de notre civilisation, aux portes d’un occident chancelant, persuadé d’être à l’abri de nouveaux pogroms, de nouvelles guerres de civilisation. Toutes les luttes du peuple iranien, depuis l’avènement de la révolution islamique, sont un kaléidoscope narratif qui interpelle notre passé, interroge notre présent et bouscule notre futur.
Mais, encore une fois, nous entendons mal, il faut tout nous rappeler, encore et encore! Nous rappeler que l’islamisme est un système de pensée politico- religieux d’une seule pièce, qu’il serait vain de le croire compatible avec la république, avec le respect des libertés individuelles et collectives. Une machine répressive qui réfrène la multiplicité intérieure, s’abreuve de dogmes, érige des dômes à mensonges crus et indubitables. Ce sont là des hommes façonnés par le mythe, suspendus comme des sangsues au symbolisme, guidés par les métaphores. Des hommes ciselés dans des métonymies inébranlables.
Cependant, ce que le régime des Ayatollahs ignore, c’est que les rebelles iraniennes sont des furtives. Elles sont, pour paraphraser Alain Damasio dans son roman Les Furtifs, celles qui assimilent et transforment le monde. Elles ne contrôlent rien, ne veulent rien contrôler, elles sont dans la rencontre. Du huis clos génocidaire dans lequel la résistance iranienne est enfermée, leurs cris, leurs larmes, leurs écrits et leurs pensées nous parviennent dans leurs formes les plus vivantes. La révolte iranienne vivra, la révolte iranienne vaincra!
Mohand Ouabdelkader