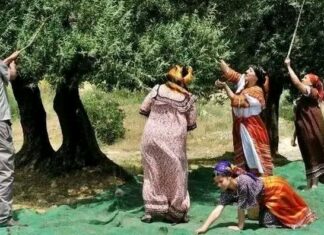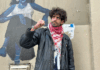Je ne connais pas personnellement Kadour Naïmi, qui m’interpelle à nouveau véhémentement dans Algérie patriotique (15 juillet 2018) après Le Matin d’Algérie (6 juillet 2018). Travaillant depuis longtemps sur le champ culturel national, je me rappelle lointainement l’éphémère expérience du « Théâtre de la Mer » à laquelle il a participé vers la fin des années 1960. Fut-elle prometteuse pour être renouvelée ? À cette période, déjà, le « Prolet Kult », à Saïda, témoignait d’un théâtre hors les murs, défiant la léthargie des institutions nationales du 4e art, qui devait compter dans l’évolution du théâtre coopératif, jusqu’à nos jours. Kadour Naïmi aurait pu approfondir cette entrée généreuse dans le théâtre algérien. Il excipe du titre de dramaturge (« artiste de théâtre connu », argue-t-il) mais il serait bien embarrassé de citer ses œuvres jouées sur les planches algériennes. Il aurait écrit des dizaines de pièces, qui ne sont autant de projets avortés.
Répondant à ma contribution sur Slimane Benaïssa (AP, 31 mars 2018), Naïmi m’avait posé des questions pour approfondir ce débat, auxquelles j’ai apporté de nécessaires précisions (AP, 1er avril 2018). Ce fut un échange courtois. Naïmi, qui avait obtenu de la direction d’Algérie patriotique mon mail, m’avait écrit pour m’inviter à réfléchir à la création d’une association ou d’un site en ligne, proposant un « Appel pour une Association Algérienne pour une Culture Libre et Solidaire ». Il me l’avait fait parvenir – comme à d’autres personnes qui y ont souscrit – pour discussion et enrichissement afin d’en faire la base théorique de la future association. Or, il avait requis la participation de personnalités étrangères à cet échange. Je lui avais écrit pour me désengager de ce projet, estimant qu’une réflexion sur la culture nationale ne devait concerner que l’expertise d’Algériens. Cette option internationaliste, je la refusais autant dans le champ culturel que dans le champ politique. Il en avait pris acte, et moi mes distances. Jusqu’à son texte de conclusion de sa contribution sur les « harkis » où il glosait hasardement le concept « mtorni » (AP, 7 juillet 2018, LMA, 6 juillet 2018), m’impliquant directement, mettant en cause une démarche intellectuelle, qu’il entendait « redresser ».
Je me devais de lui répondre. Kadour Naïmi a été apparemment inquiété par le dernier paragraphe de ma « Mise au point » (AP, 12 juillet 2018), lui demandant de clarifier son lieu de parole. Il y consacre l’essentiel de son pensum sans faire avancer les choses d’un iota. Pourtant, il n’infirme rien de ce que j’ai écrit sur sa participation à Mai 1968 en France (« le plus important mouvement populaire révolutionnaire, depuis le front populaire en 1936 », surenchérit-il) ; sur ses démêlés avec des politiciens communistes et syndicalistes italiens, semblables à leur frères d’Algérie, irrécupérables chiens de garde, agents du Grand Capital ; sur sa présence de cinq ans en Chine. Enfin, sur ce singulier cheval de Troie qu’il a enfourché en un temps brumeux. Il faudra bien y revenir.
De quelques distinguos
Je voudrais, auparavant, faire justice de certaines assertions de Naïmi, qui m’accuse de parler sans rien prouver, tout en me prêtant un parcours politique à la mesure de ses vaines attentes :
1) Le confusionnisme mental. Kadour Naïmi a eu vraisemblablement maille à partir avec ceux qu’il appelle les « communistes » et les « progressistes », qui l’auraient malmené sans répit, sans indiquer de date précise, dans cette période de sacro-saint mot d’ordre de « soutien critique » du Parti de l’Avant-garde socialiste (PAGS) au régime issu du coup d’État du 19 juin 1965 du colonel Boumediene. Leurs attaques furent-elles si rudes pour le contraindre à quitter définitivement le pays ? Il ne s’en explique pas, déployant un éprouvant effort pour m’incorporer à cette famille politique, ne manquant pas de penser et d’affirmer : « […] Merdaci fait partie et/ou défend cette ‘‘gauche communiste’’ et les ‘‘progressistes’’ algériens du ‘‘soutien critique’’ ». Ainsi, les faits seraient si simples dans leur énoncé : je continue et prolonge ce terrifiant hallali du « parti du ‘‘soutien critique’’ ». Insurmontable paranoïa ?
Cette détestation de la « gauche communiste » algérienne, Kadour Naïmi, qui revendique crânement sa carte du défunt Parti de la Révolution socialiste (PRS) de Mohamed Boudiaf et militer dans des organisations d’extrême gauche européennes, veut lui donner la consistance de l’histoire. Outre ma parenté avec le « parti du ‘‘soutien critique’’ », ma démarche intellectuelle est assignée à celle d’Andreï Aleksandrovitch Jdanov, théoricien tardif du « réalisme socialiste » dans la défunte Union soviétique, développé avant lui par Lénine et Plekhanov, relisant Marx et Engels. Et à ce titre donc, je ne suis pas loin des fomenteurs de goulags et d’exécutions expéditives. La belle affaire ! Je me souviens avoir introduit mes étudiants de Théorie littéraire, à l’Université, aux premières sociologies littéraires dans le monde socialiste d’antan, notamment la « théorie du reflet » et le « réalisme socialiste » confrontées à de vives lectures des textes.
Avant de s’attaquer au « formalisme » dans les arts, principalement dans la musique de Chostakovitch, Andrei Jdanov pouvait réviser les thèses du Hongrois Georg Lukacs sur la crise de la littérature bourgeoise occidentale post-balzacienne. Était-ce, seulement, l’émule de Béria qu’esquisse dans une piètre caricature Naïmi ? Jdanov représente le moment régressif d’une pensée critique de l’art dans l’Union soviétique. Naïmi l’a-t-il étudié ? Le Jdanov, qu’il évoque comme la dernière des injures, à qui il me renvoie présomptueusement, est un épouvantail né dans les discussions avinées de demi-intellectuels de tripots à bière, à Alger, Paris ou Naples. Ces comparaisons brutales et sommaires ne soulignent que les méfaits de l’inculture, du vulgaire prêt à porter culturel.
Je voudrais paraphraser Louis Aragon dans « La Rose et le réséda » (La Diane française, Paris, Seghers, 1944) et nommer : « Celui qui croyait au ‘‘soutien critique’’ | Celui qui n’y croyait pas ». Je n’étais pas de cette chapelle qui croit au « soutien critique », un très bel oxymore, qui est plus qu’un programme – et, d’aucune autre ; mais comme le dit le poète cette « clarté sur nos pas » s’appelle l’Algérie. Le PCA et ses nombreux démembrements, passés ou actuels, réunit des hommes et des femmes qui ont été et qui restent utiles à leur pays, qui lui ont apporté une part, toujours exigeante et émouvante, d’engagements et de courage. Je n’insulterai jamais cette histoire, même si le communisme n’est pas mon histoire.
2) La relation au pouvoir. Il est vraiment commode pour Kadour Naïmi de me camper en chasseur de provendes officielles et de privilèges et de s’interroger sur le fait que je n’ai pas quitté le pays. Le système au pouvoir, depuis 1962, ne m’a jamais rien donné et je ne lui ai jamais rien demandé. Lorsque je me présente dans des débats publics, je le fais en mes qualités acquises par mon travail : mon titre de professeur des Universités est inaliénable, il est une reconnaissance de mes pairs, ce n’est pas une récompense politique ; écrivain, j’en suis, actuellement à dix-sept essais de critique et d’histoire littéraires publiés sous mon nom ; critique, je m’autorise de cette longue œuvre de plus d’un quart de siècle de lectures de textes littéraires et de faits culturels rassemblées dans deux premières publications (Cahier de lectures I, 2008, II, 2011, Constantine, Médersa). Je ne m’identifie pas à cette « couche d’intellectuels, dans tous les domaines, dont le théâtre, qui a toujours […] bénéficié de privilèges en termes de postes administratifs, en échange de ‘‘soutien critique’’ au régime en place », légèrement alléguée par mon contradicteur. Qui s’interroge sur les raisons pour lesquelles je n’ai pas quitté mon pays lorsque ceux qui, à son exemple, l’ont abandonné y reviennent honteux, en catimini. J’appartiens à cette Algérie qui a défendu par sa constance et par son ouvrage quotidien, au-delà des errements des pouvoirs politiques, de leurs oligarques et de leurs maffias, l’espérance d’une nation.
Tous ceux qui n’ont pas quitté l’Algérie – il convient d’entendre qui n’ont pas pris la nationalité d’un autre pays – seraient donc d’incurables clients du « système » ? Raisonnement trop court, en effet. Naïmi n’existe pas en Algérie, à l’exception de ses récentes contributions dans Algérie patriotique et Le Matin d’Algérie. Il n’y réside plus depuis de nombreuses décennies, défaisant le lien national. J’ai, pour ma part, apporté dans mon pays ma modeste contribution au débat culturel national, souvent à charge contre les politiques culturelles du gouvernement. Ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’il fallait s’opposer à la « Caravane Camus », initiée en 2010 par Yasmina Khadra, écrivain et directeur du Centre culturel algérien, à Paris, approuvée par le gouvernement de M. Ouyahia, à la censure par le même gouvernement du livre égyptien et d’écrivains algériens au Sila, dénoncer l’absence de la littérature algérienne (toutes langues confondues) dans l’École algérienne.
J’ai publiquement mis en cause la création par le gouvernement et son actuel ministre de la Culture d’un Prix littéraire au nom d’Assia Djebar, reconnue par la communauté universitaire en Occident dans les dernières années de sa vie, au moment où elle était élue à l’Académie française, comme une des théoriciennes de la « littérature migrante », promouvant l’image de l’écrivain sans frontières. En Algérie, cette conception de la littérature et de l’écrivain, coupés de leurs racines et de leur histoire, retarde l’émergence d’un espace littéraire national autonome. Elle est discutée dans plusieurs de mes études, notamment dans mon ouvrage Engagements. Une critique au quotidien (Médersa, 2014).
Lorsque l’intelligentsia d’Alger se taisait, j’ai défendu et honoré l’algérianité de l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, que lui déniait l’écrivain et journaliste Tahar Benaïcha. J’ai, souvent, soutenu, seul, la contradiction à Boualem Sansal et Kamel Daoud, écrivains sans talent, portés littéralement par l’établissement français, armés face à leurs compatriotes par le lobby sioniste des lettres françaises dirigé par l’écrivain Pierre Assouline, sanctifiés par le philosophe aux mains sales Bernard-Henri Lévy.
L’Algérien, qui n’est pas sorti de la colonie, même s’il ne l’a pas connue, donne raison aux analyses d’Albert Memmi sur les décolonisations ratées, notamment au Maghreb (Cf. Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, Paris, Gallimard, 2004), il chérit et adore tout ce qui est consacré par l’ancien colonisateur, la France, sans recul critique, sans en rechercher les tortueux soubassements. C’est l’ancien chroniqueur du « Monde », Éric Chevillard, qui torpille la langue de Yasmina Khadra « qui écrit faux comme une casserole » (Cf. Défense de Prosper Brouillon, Paris, Noir sur Blanc, 2017) ; c’est Françoise Nyssen, patronne des éditions Actes Sud, actuelle ministre de la Culture du président Macron, qui reconnaît le travail de « réécriture » de son équipe éditoriale du Meursault, contre-enquête (2014), premier opus de Kamel Daoud ; ce sont les propres protecteurs de Boualem Sansal, membres du jury Goncourt, qui déplorent l’inanité de son style de bureaucrate infatué. Lorsque j’avais signalé ces déconvenues de nos « grands écrivains » dans des journaux algériens, bien avant ces Français bien intentionnés, les bonnes âmes et les dîneurs affétés des cantines bourgeoises d’Alger m’avaient accusé de jalousie. Ces combats pour la culture nationale algérienne n’appartiennent pas à Kadour Naïmi. Il était en voyage, ailleurs. Alors passons.
3) Une improbable querelle de mots. Au fond, cet échange avec Naïmi ne serait qu’une querelle de mots. Il me reproche ainsi de l’avoir qualifié de « tribunitien », un terme qui ne figure pas dans les dictionnaires qu’il a consultés sur le Net. En fait, il est bien mentionné dans les dernières éditions de dictionnaires français disponibles dans les librairies algériennes. Il est ainsi attesté par « le Robert » dans sa forme adjectivale : « du tribun, de l’art populaire » (2017, p. 1962). Le processus de transformation de la langue intègre souvent le passage de la forme adjectivale à la forme substantive ; cela s’appelle une substantivation, phénomène courant de néologie. Ainsi, lorsque dans le contexte politique, on parle d’un « rouge » – qui horripile Naïmi, s’il est Algérien ou Italien –, il s’agit moins de tonalité chromatique (adjectif) que d’affiliation politique à un parti de la gauche communiste (substantif). La reconnaissance et la confirmation de ces transformations linguistiques par les dictionnaires de langue est lente et il convient de signaler que la totalité des mots nouveaux introduits dans leurs éditions annuelles est rejetée par l’Académie française, gardienne de l’orthodoxie lexicale. Ces derniers mois, il est possible d’observer la semblable transformation lexico-sémantique dans les discours politiques et dans les médias : le « tribunitien » se rattache à l’art de la tribune ; c’est bien ce qui caractérise Kadour Naïmi, « ergotant » – c’est son propre terme – pendant trois mois, d’avril à juillet 2018, sur le terme « harki » dans Algérie patriotique et dans Le Matin d’Algérie.
L’usage du concept « mtorni » sur lequel Naïmi me reprend relève du processus de signification (ou valeur) des mots. Des lecteurs, réagissant à ma « Mise au point », l’ont situé dans son sens premier, celui de la conversion au christianisme, œuvre de la mission évangélique des Pères blancs dans l’Algérie coloniale. Il me semble avoir bien expliqué dans mes contributions le sémantisme de « mtorni », une réalité conceptuelle nouvelle dans le champ culturel algérien, un glissement fondamental d’opinions, d’idéologies et de statut, signalant dans les exemples traités le mouvement de l’Algérie vers la France, avec ce que cela engage de retournement, toujours propitiatoire – et, pas seulement dans le cas du dramaturge Slimane Benaïssa, assurant la défense et illustration de l’interculturel et du « métissage culturel ». Un même signifiant donc, deux signifiés, de la période coloniale à la période actuelle. L’idée de transfert, de déplacement, présente dans le sème principal du vocable de la période coloniale, ne signale plus un fait religieux mais un marqueur sociopolitique.
J’avais utilisé, au début des années 2010, dans différentes contributions dans la presse nationale le terme « harki » pour désigner par analogie la transition du fusil à la plume, armes électives du mercenaire. Je notais ainsi à propos de la plus vindicative opération de dénationalisation des littératures de langue française dans le monde : « La ‘‘littérature-monde en français’’, dans son scénario algérien, est au mieux un enrôlement crépusculaire de harkis, spadassins de la plume après l’avoir été du sabre et du fusil. Et Sansal, dans une fumeuse logique de carrière qui ne recule devant aucune forfaiture, en est la recrue la plus extravagante. (« Quand Boualem Sansal veut ‘‘déradicaliser’’ la critique », Reporters [Alger], 17 avril 2016). Le romancier Rachid Boudjedra a apporté dans Les Contrebandiers de l’Histoire (Tizi Ouzou, Les Éditions Frantz Fanon, 2017) de précieux éclaircissements à ce débat sur les défections à la nation algérienne, à sa culture, plus spécialement à sa littérature.
« Harki » est un terme du mouvement national algérien avant d’être intégré dans le langage politique après l’indépendance. En Algérie, c’est une expression péjorative ; en France, c’est une qualification administrative attribuée à des mercenaires indigènes de l’Armée française, transplantés, au lendemain de la proclamation du cessez-le-feu, dans ce pays et parqués dans des forêts et des hangars désaffectés de friches industrielles. Contrairement à l’Algérie, le terme « harki » n’a pas un sens disruptif en France, puisqu’il est accepté par les descendants directs des soudards de l’Algérie française (Cf. Fatima Besnaci-Lancou, Fille de harki, Paris, Éditions de l’Atelier, 2005). On peut en relever des emplois différenciés en France et en Algérie, mais son usage universel n’est pas établi : les présidents Poutine (Russie), Xi Jinping (Chine) et Trump (USA) ne l’ont pas inscrit dans leur vocabulaire. Et ne le feront jamais.
Toujours dans le discours de Naïmi, mais aussi dans celui des lecteurs d’Algérie patriotique et du Matin d’Algérie, le mot « exil ». Naïmi utilise une sorte de circonvolution, introduisant la notion d’« éloignement géographique » (AP, 15 juillet 2018). Dans les dictionnaires de langue, l’exil prend le sens d’« expulsion de la patrie avec la défense d’y retourner » (« Le Robert », 2017, p. 716) ; il peut aussi être un « exil volontaire ». Mais malgré les interdictions décrétées, l’exilé a toujours enracinée en lui l’idée du retour dans la patrie. J’ai déjà cité dans de précédentes contributions les cas, largement discutés dans l’histoire, de Lénine et Ho Chi Minh, et dans l’Algérie contemporaine, de Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf, Ahmed Ben Bella, opiniâtres exilés politiques, irrémédiablement algériens dans la terrible adversité de pouvoirs qui ne les ont pas épargnés. Et dans l’histoire de la littérature mondiale, il y a des parcours édifiants d’écrivains exilés : les Français Victor Hugo à Guernesey et Georges Bernanos à Rio de Janeiro, le Chilien Pablo Neruda à Paris, le Colombien Gabriel Garcia Marquez à Madrid, L’histoire a tourné et ils sont rentrés chez eux sans l’ombre d’une défection. L’exilé n’est pas une personne qui quitte volontairement son pays pour rechercher ailleurs une meilleure vie et prendre une nouvelle nationalité ; il ne peut être assimilé juridiquement à un naturalisé, qui a opté pour un résolu saut de frontières. C’est précisément ce qui caractérise Slimane Benaïssa, Anouar Benmalek, Salim Bachi, Mohamed Kacimi, Merzak Allouache, Sid Ahmed Aggoumi, Mohamed Sifaoui, et bien d’autres, toujours bienvenus et honorés dans une Algérie officielle sans mémoire, qui oublie – et absout ? – leur défection et les replace sur scène pour d’inénarrables comédies. Alors, pour rejoindre et saluer l’écrivain et blogueur Youcef Benzatat, j’ose la question : c’est quand Madame Lila Haddad Lefèvre ? Du persiflage ? Il faut bien avoir lu les déclarations souillées de haine sur l’Algérie et les Algériens de certains de ces mtornis devant lesquels les propos de la journaliste belge d’origine algérienne seraient des gazouillis de moineau à la presqu’aube.
L’aggiornamento national
Comment Kadour Naïmi peut-il s’étaler aussi longuement sur les « harkis » ? Quelle est sa compétence pour traiter de ce sujet ? Est-il historien, sociologue, psychologue ? Il n’y a rien, en vérité, qui puisse l’accréditer à publier un feuilleton de seize numéros sur un thème qui lui échappe, qu’il nourrit de ses fantasmes politico-culturels. À partir de quel réel se positionne-t-il ? J’ai insisté dans ma « Mise au point » sur cet arrière-plan moral : lorsqu’on s’adresse aux Algériens dans un débat public, il faut leur dire qui nous sommes et d’où nous venons. Naïmi fournit une réponse biaisée. Il évoque un exil – qui semble si définitif pour ne plus l’être – et se couvre d’un subtil « éloignement géographique ».
J’ai découvert récemment et incidemment, avec un profond effarement, que Kadour Naïmi est un Italien d’origine algérienne, « un citoyen italien », correspondant pleinement à la définition du mtorni que je propose. La notice biographique de l’intéressé, consultable sur le Net, est publiée à l’occasion de la parution dans son pays d’adoption d’une nouvelle : « Kadour Naïmi, d’origine algérienne, est citoyen italien. Lettre de Rome d’un E-C est sa première nouvelle publiée. Il est auteur et metteur en scène de théâtre, ainsi que scénariste et réalisateur de documentaires et de films. Il a également publié des articles de sociologie. D’autres informations sont disponibles sur son site professionnel ». Voici le cheval de Troie, hideux masque sur la triste figure du naturalisé, qui finit par tomber. Un naturalisé italien qui fait la leçon aux Algériens sur les « harkis » ? Il aurait été plus indiqué, par respect envers ses lecteurs algériens et le pays qui l’a accueilli et lui a accordé sa nationalité, que Kadour Naïmi dise d’où il vient, qui il est. Il y a, en l’espèce une tromperie, une horrible tromperie. Lorsqu’on a pris la nationalité de la France ou de l’Italie, comme c’est le cas pour Benaïssa et Naïmi, qu’on vit au cœur de ce retournement, cela suppose une loyauté à toute épreuve pour se ranger derrière un drapeau, un hymne, une histoire.
Lorsque je débattais avec Kadour Naïmi dans les pages d’Algérie patriotique et dans des mails, il était le compatriote qui rattachait son nom à la sympathique expérience du « Théâtre de la Mer ». Poursuivre une discussion avec l’inattendu mtorni Naïmi, ce serait banaliser le fait.
Il y a une conclusion essentielle à tirer de ce débat. L’idée de nation et d’identité nationale reste opaque pour l’extrême majorité des Algériens ; elle ne leur a pas été enseignée par l’École pour faire partie de leur culture (certains diraient ADN ou logiciel), ni par le milieu familial et la société. Même ceux qui appartiennent à la première génération de l’indépendance ont déserté en masse le pays lors de la mortelle dérive antinationale des années 1990 (islamisme, vagues continues d’émigration, naturalisations massives) pour jeter dans les caniveaux d’Europe, de France particulièrement, leur identité originelle. Naïmi aurait l’excuse de l’avoir fait bien avant eux… Combien d’Algériens savent ce qu’est une patrie, ce qu’elle représente. Cette défaillance s’observe dans des réactions de lecteurs : qu’un Algérien prenne la nationalité d’un autre pays est vécu par eux comme une promotion, parce qu’ils n’y ressentent pas une défection au pays commun, à son histoire et son devenir. Ils peuvent encore s’enflammer pour un chanteur d’origine algérienne, naturalisé français, puis marocain, qui n’hésitera pas à prendre une quatrième nationalité. Sans doute, un héros. Que Slimane Benaïssa revienne présider le Festival international du théâtre de Bejaia et Merzak Allouache le Festival du film arabe d’Oran, manifestations culturelles gouvernementales, cela ne relève que de leur art. Non, le mtorni n’a jamais trahi, il n’a fait que quitter ce pays aux appellations barbares que taguent les jeunes sur les murs de nos cités.
Que penser, en cet été 2018, de ces drapeaux algériens dans les stades russes de la Coupe du monde de football encourageant l’équipe de France et fêtant dans les rues de Paris sa victoire ? L’Algérie reste symptomatiquement un morceau de l’ancien empire colonial français et l’ambassadeur de France à Alger, maître des visas, est dans l’esprit de beaucoup d’Algériens plus important que le président de la République et son gouvernement. Il est loisible, pour certains, d’opposer désormais à l’idée arriérée, antimoderne, de nation et d’identité nationale la guerre de conquête de l’espace et son progrès technologique où ni la France ni l’Europe unie n’ont leur place, qui ne concerne que trois pays dans le monde, les États-Unis d’Amérique, la Russie et la Chine, qui triompheront sur la lune ou sur Mars avec leur drapeau, leur hymne et leur histoire. Ni les citoyens de la Grande Amérique ni ceux du plus petit État du monde n’abdiquent leur identité et nationalité, des Algériens, de plus en plus nombreux, peuvent le faire sans état d’âme. Pour beaucoup d’entre eux, qui ont transmis cette fêlure à leurs enfants, la blessure quasi-pathogène de la rupture coloniale reste ouverte, cinquante-six après l’indépendance de leur pays à laquelle ils ne croient pas. Et leur propension à s’enrôler dans la « harga » pour changer de vie et de pays est une menace potentielle de millions de migrants aux portes de l’Europe. Dans les nations avancées, la loyauté envers son pays se mérite. On en est éloignés.
(*) Professeur de l’enseignement supérieur, écrivain et critique.
PS | Ce droit de réponse, adressé le 18 juillet 2018, a été censuré par Algérie patriotique qui publie deux jours après un poème de Kadour Naïmi dans lequel il me répond – indirectement – sur son identité juridique. Il n’écrit pas expressément qu’il n’est pas Italien, il ne dément rien, ce qui serait clair. Il exprime dans un poème testamentaire (« À la vie ! ») une nostalgie du cimetière d’Oran « au soleil et le plus près de la mer ». Mais ce n’est qu’une image faible poétiquement. Il ajoute, toutefois : « Si vous m’incinérez | parfumez mes poussières | et répandez-les dans l’air ».
Dans les pratiques funéraires musulmanes, il n’y a pas d’incinération, admise dans les rites chrétiens ou agnostiques. Là est la duplicité de Naïmi, éperonnant son cheval de Troie. Qu’il ait le courage d’écrire publiquement qu’il n’est pas un citoyen italien, résidant dans ce pays depuis bientôt un demi-siècle. Matteo Salvini, l’actuel ministre de l’Intérieur d’extrême droite, traqueur de migrants, se ferait un plaisir de lui répondre et de le confondre. Naïmi est un activiste connu de l’extrême gauche italienne, un habitué de ses publications maoïstes, dont il utilise les techniques de communication et d’agit-prop éprouvées. Il le fait si bien pour subjuguer, ici et là, des lecteurs.