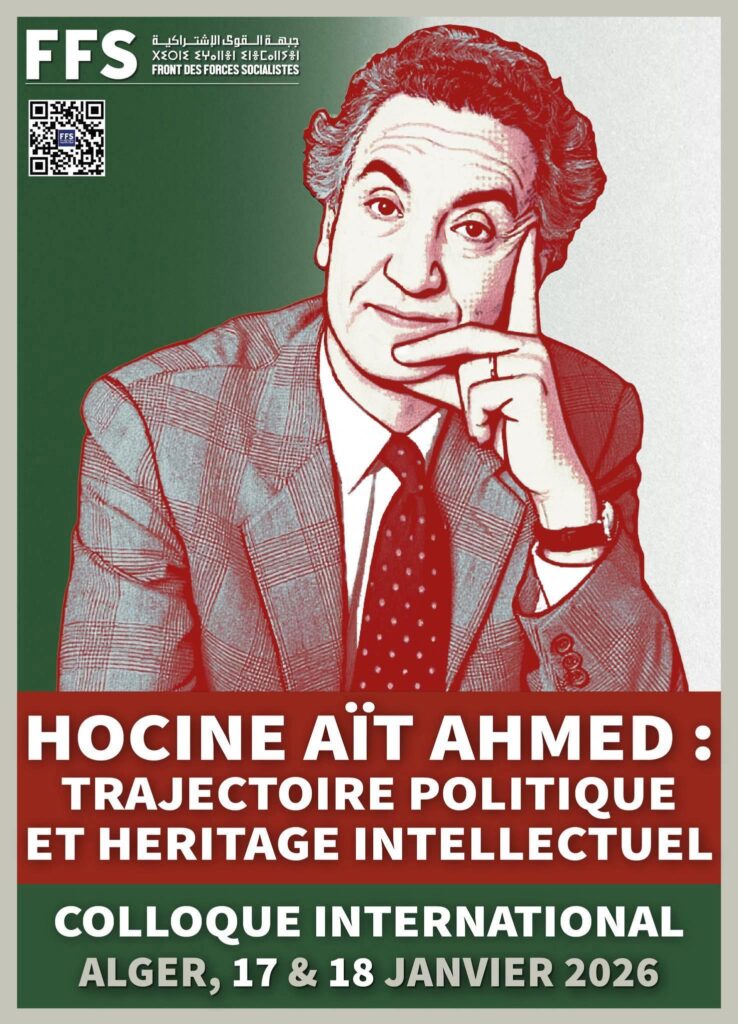L’extrême droite est parvenue, jeudi 30 octobre 2025, à faire adopter une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968. Un événement inédit dans l’histoire de la Ve République, qui actera sans doute – malgré sa valeur symbolique – l’officialisation de l’alliance des droites dites «républicaines» avec un parti dont les fondateurs comptaient notamment un ancien membre de la Waffen-SS et un cadre de l’OAS.
Officiellement, le Parlement consacre les fantasmes des droites extrêmes sur l’immigration algérienne « pour protéger concrètement les Français ».
Ici, la crise du langage apparaît avec une clarté frappante. La simple évocation du signifiant « Algérie » suffit à désinhiber et libérer une parole raciste, désormais exprimée dans une large partie du champ politique français. Du centre à l’extrême droite, en passant par une droite autrefois dite « gaulliste » et une frange de la gauche se réclamant de la « social-démocratie », s’exprime aujourd’hui un profond ressentiment colonial envers le principe d’autodétermination des peuples et envers l’héritage des luttes victorieuses de décolonisation.
Dans les discours ayant pour obsession ce signifiant d’ « Algérie », un accord migratoire largement défavorable aux ressortissants algériens vivant en France est fallacieusement présenté comme un « privilège » accordé à une « caste » d’immigrés qui, affirme-t-on, ne feraient pas suffisamment preuve d’ « amour » ou de « gratitude » envers leur pays d’accueil. La présence d’une Algérienne ou d’un Algérien en France y est dépeinte comme illégitime par principe, presque « criminelle » par nature, et ce en dépit de leur participation active à l’enrichissement de la vie de la cité. Au-delà des Algériens durablement installés en France, ce vote au racisme décomplexé s’accompagne également d’une rhétorique quasi maurassienne qui désigne des millions de binationaux comme de potentiels « ennemis de l’intérieur ».
Pour répondre à ce déluge de « vérités alternatives », le journaliste indépendant Faris Lounis s’est entretenu, pourle Matin d’Algérie, avec Baptiste Mollard, docteur en science politique, chercheur associé au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Université Versailles–Saint-Quentin, CNRS) et membre de l’Institut Convergence Migrations. Il a rédigé sa thèse à l’émigration algérienne de travail au tournant de l’indépendance.
Le Matin d’Algérie : Pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement l’accord franco-algérien de 1968 et nous rappeler les circonstances particulières de sa signature ?
Baptiste Mollard : L’accord de main-d’œuvre de 1968 ne peut pas se comprendre en dehors du contexte des décolonisations. Une clause des accords d’Évian (19 mars 1962) garantit une liberté totale de circulation vers la France des Algériens en possession d’une simple carte d’identité. Ce qu’on oublie souvent, c’est que cette clause s’applique aussi aux Français se rendant en Algérie. Peu discutée par les négociateurs, elle prolonge des logiques observées dans d’autres sorties d’empire, comme au Sénégal, au Mali et en Mauritanie (ex-empire français), ou en Inde, au Pakistan, au Nigeria ou au Ghana (Commonwealth britannique). L’Algérie s’en distingue toutefois par ce que plus de 250 000 Algériens vivent déjà en France avant l’indépendance, malgré un accès limité aux seuls détenteurs de cartes d’identité et un contrôle policier et militaire renforcé des mobilités pendant la guerre.
Cette liberté de circulation issue d’Évian est très vite remise en cause. Dès avril 1963, l’État français impose unilatéralement des contrôles sanitaires censés écarter les hommes inaptes au travail, mais en réalité pilotés par le ministère de l’intérieur, qui s’estime seul habilité à réguler une immigration qui devient sa bête noire. Un « bureau des étrangers à statuts spéciaux » est mis sur pied pour limiter l’immigration d’anciens sujets coloniaux, en parfaite continuité avec des pratiques de l’entre-deux-guerres, quand leur présence était principalement régulée par le « rapatriement », comme l’ont montré les travaux de Vincent Bollenot, Aliénor Cadiot et Hugo Mulonnières. Ce service prolonge aussi la priorité donnée à « l’ordre public » pendant la guerre d’Algérie.
Après un an de mesures unilatérales dérogatoires, un premier accord de main-d’œuvre franco-algérien est signé en avril 1964, rapidement critiqué par Paris en 1965 et dénoncé dès 1966 par Alger. L’État français fixe seul les contingents de travailleurs autorisés à entrer en France, systématiquement en-deçà des besoins économiques réels, algériens ou français. Fatalement, de nombreux Algériens viennent se présenter comme touristes. En réaction, le ministère de l’Intérieur prend de nombreuses mesures unilatérales discriminatoire.
En mars 1965, il distribue une « notice individuelle pour touriste étranger » (Algériens, Maliens, Mauritaniens et Sénégalais). Alors qu’aucun étranger ou presque ne séjourne en France avec un visa, ce document fonctionne comme tel, quinze ans avant la lettre. Il permet de constituer un fichier des « oisifs », expulsables après trois mois passés en France.
Des files d’attente sont également réservées aux Algériens dans les ports et aéroports français, où l’arrivée de touristes est plafonnée à 250 puis 200 par semaine à partir de 1966.
Ce n’est qu’en 1968 qu’un véritable cadre bilatéral est établi, mettant fin au règne des circulaires du ministère de l’intérieur, alors seul maître de la régulation de l’immigration algérienne, par voie d’expulsions et de refoulements à la frontière. De ce point de vue, l’accord de 1968 est venu mettre un terme à un pouvoir arbitraire des forces de police qui nous paraîtrait aujourd’hui totalement exorbitant.
Le Matin d’Algérie : Vous avez soutenu récemment votre thèse de doctorat sur l’encadrement de l’émigration algérienne vers la France entre 1950 et 1970. De quelle manière avez-vous traité cet accord dans le cadre de votre travail de recherche ?
Baptiste Mollard : J’ai documenté les mécanismes de sélection instaurés par l’État algérien pour organiser, sur son propre sol, les départs vers la France. Contrairement à l’idée d’une pleine liberté de circulation après 1962, des responsables algériens réclament une limitation de l’émigration dès l’automne. Les premières mesures datent de mai 1963, avant même l’accord bilatéral de 1964 : délivrance de cartes de travailleurs par un office dédié (l’Office national algérien de la main-d’œuvre, ONAMO), restrictions des départs sous statut touristique (qui doivent présenter une attestation d’emploi en Algérie et déposer un pécule de 100 francs), encadrement accru des proches de travailleurs émigrés… Les contrôles policiers sont également renforcés.
Vis-à-vis de l’ensemble des trois statuts reconnus d’émigrant (travailleurs, touristes, membre de la famille de travailleurs), l’État algérien joue donc un rôle très actif, souvent sous-estimé par les autorités françaises, qui suspectent constamment ses services d’incompétence ou d’opportunisme. Les diplomates algériens doivent alors lier la question migratoire à d’autres dossiers et ne plus participer à certaines rencontres afin de peser dans la négociation. L’accord de 1968 consacre ce travail en autorisant une émigration importante d’Algériens sous un statut de travailleurs, jusque-là minoritaires.
Ce texte entérine un compromis entre le ministère du travail algérien – favorable à une émigration de travail importante et qui pourrait être planifiée – et le ministère de l’intérieur français – qui dès 1962, veut encadrer le séjour des Algériens par un « certificat de résidence ». Ces dispositions sur le séjour restent en vigueur, tandis que celles relatives à l’émigration de travail cessent en 1973.
Depuis, les Algériens sont restés durablement exclus de l’immigration pour motifs professionnels. En 2023, seuls 9% des titres qui leurs ont été délivrés concernaient le travail, contre 30% et 35% pour les Marocains et Tunisiens.
Le Matin d’Algérie : Comment situer l’accord de 1968 par rapport aux politiques françaises encadrant les immigrations européennes à la même époque ?
Baptiste Mollard : Depuis 1945, l’immigration algérienne est considérée comme la moins désirable, loin derrière les immigrations italienne, espagnole et portugaise. Dans les années 1960, les politiques migratoires divergent. Les travailleurs espagnols, qui représentent alors la première communauté étrangère, doivent présenter un contrat signé par un employeur.
Malgré ces conditions restrictives, leurs entrées dépassent régulièrement le chiffre de 70 000 par an, dont deux tiers de travailleurs agricoles saisonniers, c’est-à-dire le double du contingent prévu pour les travailleurs algériens par l’accord de 1968.
Pour les travailleurs portugais, un accord bilatéral qui instaure une immigration de travail sous contrat similaire, signé en 1963, n’a pas été appliqué. Les pouvoirs publics français tolèrent une immigration clandestine très importante, atteignant 900 000 personnes entre 1957 et 1974, dont 140 000 en 1969, comme l’ont montré les travaux de Victor Pereira. Ces chiffres sont, là encore, très nettement supérieurs aux 35 000 travailleurs annuels prévus par de l’accord de 1968.
Le recensement INSEE de 1982 révèle pourtant que les Algériens occupent la première place des communautés étrangères en France, avec plus de 800 000 ressortissants malgré l’arrêt de l’immigration de travail en 1973. Loin de se résumer au seul regroupement familial, cette croissance révèle la dépendance durable du patronat français à cette main-d’œuvre, notamment dans plusieurs secteurs clés (bâtiment, industrie, agriculture).
Typique d’un discours mythique des trente glorieuses, l’idée d’un ajustement harmonieux entre « besoins » français et « excédents » algériens de main-d’œuvre est trompeuse. L’immigration algérienne est régulée sur un plan strictement étatique, par des négociations d’Etat à Etat. Contrairement aux immigrations marocaines et tunisiennes, directement organisées par des entreprises françaises de l’autre côté de la Méditerranée, l’immigration algérienne peut s’autonomiser du marché de l’emploi. Cette situation, voulue par l’Etat français, permet d’utiliser l’immigration comme levier politique dans sa relation avec Alger.
Le Matin d’Algérie : Aujourd’hui, le discours des centristes et des droites dures et extrêmes présente les Algériennes et Algériens comme une caste migratoire au-dessus de tout. Factuellement, existe-t-il un « privilège » migratoire algérien ?
Baptiste Mollard : Des députés comme Éric Ciotti (LR) font comme si l’accord de 1968 s’était appliqué jusqu’à aujourd’hui, or, il est vidé de sa substance dès 1973, lorsque le président Houari Boumediène renonce à l’émigration de travail. Trois avenants sont ensuite signés en 1985, 1994 et 2001, alignant le séjour des Algériens sur le droit commun, souvent plus avantageux. Quelques dispositions dérogatoires subsistent aujourd’hui, plus favorables à une partie des Algériens, mais c’est surtout en raison du durcissement du droit des étrangers ces 25 dernières années.
En dehors des questions liées au séjour, les Algériens subissent de plein fouet les politiques migratoires restrictives : obligation de visa pour les ressortissants hors Schengen (1986), procédures Dublin limitant à une seule demande d’asile dans l’espace Schengen (1990, 2003 et 2013)… Ils sont également les premiers concernés par la baisse des visas délivrés par les consulats français (dès les années 1990), par l’allongement de l’enfermement dans les centres de rétention administratifs (dès 1998), ou encore l’introduction des Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF, 2006).
Le débat actuel a pris des dimensions trop abstraites. L’existence d’un droit au séjour dérogatoire ne suppose rien de son application !
L’étude des politiques migratoires montre que les préfectures conservent une marge de manœuvre considérable : plus que toute autre instance en France, elles « font » le droit au séjour. L’idée d’un accès automatique des Algériens à des titres de séjour est illusoire. Beaucoup en obtiennent un à l’issue de recours. Certes, ils sont les seuls étrangers à bénéficier d’un titre – en théorie de plein droit – après dix ans de présence en France. Mais prouver cette présence devant un tribunal, alors même qu’ils sont, de fait, exclus du marché du travail, n’a rien d’un privilège.
Le Matin d’Algérie : L’accord de 1968 relève du droit international et prime sur le droit français. Qu’il s’agisse de Bruno Retailleau, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, ou encore des forces politiques désormais menées par le Rassemblement national à l’Assemblée nationale, quels effets y aura-t-il à s’emparer unilatéralement d’un tel sujet ?
Baptiste Mollard : Cet accord n’est pas une entrave à notre souveraineté. Il n’est qu’un outil bilatéral de gestion des migrations parmi les 140 recensés en France en 2025, par un rapport d’information déposé le 5 février par les sénateurs Muriel Jourda et Olivier Britz. Il est reconnu par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Sa dénonciation unilatérale peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal international.
Cette tentation autoritaire dit beaucoup de nos institutions.
Depuis les années 1970, le ministère de l’Intérieur pèse de manière décisive sur les politiques migratoires, au détriment de ministères tels que ceux du travail et des affaires étrangères. Cette dynamique, plus précoce pour l’Algérie, s’est poursuivie jusqu’à ce que Bruno Retailleau s’autorise à lancer un ultimatum à une diplomatie étrangère !
Cette stratégie de la terre brûlée n’est pas à la hauteur des liens commerciaux et humains entre nos deux pays.
Les 18 consulats algériens en France (sur 42 dans le monde) administrent près de 900 0000 Algériens et interviennent dans l’exécution des OQTF. Les conditions institutionnelles sont donc déjà réunies pour la collaboration plus active que souhaite le ministère de l’Intérieur français. Même si l’on accepte de se placer du point de vue de ses services (ce qui n’est pas une mince affaire !), le plus urgent est donc la reprise de la relation diplomatique et la réinstallation des ambassadeurs français et algérien dont les absences, depuis juillet 2024, impactent durablement la coopération, et donc l’exécution des OQTF.
La crise tient aussi à des facteurs plus structurels, liés au poids de l’extrême droite sur le débat public français.
En Algérie, de nombreuses personnes souhaitant rendre visite à leurs proches en France se voient refuser des visas, malgré de bonnes garanties financières. Pendant ce temps, en France, les responsables qui cèdent à une xénophobie populiste parlent d’un « privilège » ou d’un « droit presque automatique à l’immigration ». L’impasse ne sera pas surmontée sans que l’on adopte un langage commun.
Le Matin d’Algérie : L’extrême droite est parvenue, le jeudi 30 octobre 2025, à faire voter une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968. Cet événement inédit de la 5e République a-t-il officialisé l’alliance des droites dites « républicaines » avec le parti cofondé par un ancien Waffen-SS et un cadre d’une organisation criminelle, l’OAS ?
Baptiste Mollard : Cette résolution est très inquiétante. Selon l’exposé des motifs qui la présente, 650 000 Algériens auraient reçu un titre de séjour en 2023… un chiffre aberrant, vingt fois inférieur à la réalité. Il ne faut pas non plus croire les différents responsables du parti Les Républicains sur la nécessité d’une alliance de circonstance et sans conséquence avec l’extrême-droite. Les 63 députés de droite extérieurs au RN qui ont voté ce texte ont aussi adoubé le projet politique du RN. Ils approuvent la notion d’« immigration illégale », plusieurs fois mentionnée et également au cœur de la proposition de loi instaurant un délit de séjour, présentée ce même 30 octobre. Le texte cite aussi le Danemark en exemple, un pays connu pour ses politiques d’accueil restrictives et liberticides (durcissement grave de l’accès à la nationalité, confiscation des biens des immigrés, tentative d’externalisation des demandes d’asile au Rwanda). Ce soutien pousse à l’escalade quelqu’un comme Guillaume Bigot, rapporteur de la résolution, qui envisage, dans une question écrite du 11 février 2025, de bloquer l’aide au développement ou les transferts d’épargne privés pour mettre Alger sous pression.
Cette percée parlementaire reçoit aussi le soutien du centre de l’hémicycle. Le député Charles Rodwell (REN) a en effet publié un rapport, largement repris par le RN, chiffrant le « coût » de l’immigration algérienne à deux milliards d’euros de prestations sociales. Le document ne précise nulle part les calculs qui permettraient d’arriver à une telle estimation. Il ne mentionne pas non plus la contribution des Algériens à la sécurité sociale ou au budget de l’Etat, par les cotisations, les impôts ou les frais de visa. Ses analyses sur l’immigration algérienne ne prennent pas non plus en compte l’exclusion durable du marché du travail qu’a amené l’application de l’accord de 1968 ces dernières décennies. Le plus grave réside sans doute dans l’adhésion implicite de ce texte à une idéologie qui interprète la présence étrangère comme « parasite » : une xénophobie d’Etat qui menace autant l’Etat de droit et l’Etat social que le droit des étrangers dans son ensemble. Il paraît urgent d’accorder un droit de vote aux étrangers résidant en France. Même limité aux élections locales, c’est une manière d’enrayer cette surenchère identitaire, populiste et électoraliste, menée par la droite et l’extrême droite et à laquelle le centre se rallie de fait.
Propos recueillis par Faris Lounis, journaliste indépendant