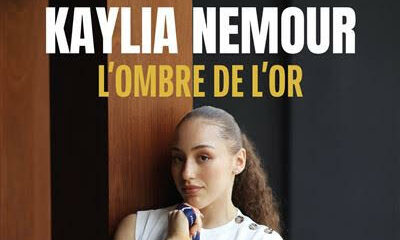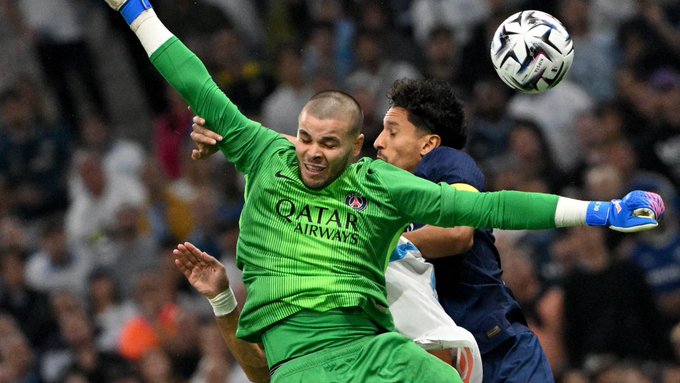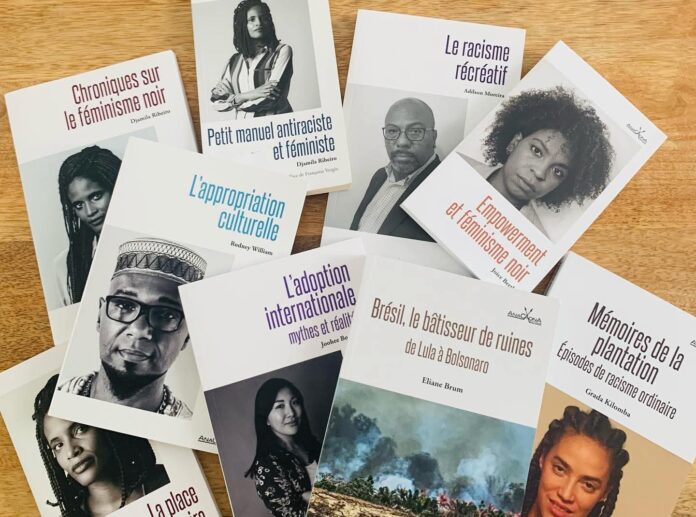En installant son sixième gouvernement depuis fin 2019, Abdelmadjid Tebboune a, une nouvelle fois, exposé une feuille de route qui tient davantage de la profession de foi que d’un programme réellement nouveau. Réunis dimanche au Conseil des ministres, les membres de l’exécutif ont reçu les habituelles injonctions à l’« efficacité », au « travail de terrain » et à la « coordination », leitmotiv répété depuis le début du premier quinquennat.
Le chef de l’État a insisté sur la « priorité absolue » du service au citoyen et la nécessité d’une « gestion intelligente » censée propulser l’Algérie au rang de pays émergents. Autant de formules déjà entendues lors des précédents remaniements, qui se sont succédé à un rythme moyen d’un gouvernement par an, sans qu’apparaissent les changements structurels promis.
Cette nouvelle équipe arrive dans un contexte économique et social tendu, marqué par une inflation persistante et des attentes fortes en matière d’emploi et de pouvoir d’achat. Pourtant, le président n’a avancé aucun chiffrage ni calendrier précis, se contentant de demander des « plans sectoriels » pour les prochaines réunions, comme à chaque relance ministérielle. Le rappel au rôle central du Premier ministre comme « courroie de transmission » traduit la volonté de resserrer les rangs, mais souligne aussi la fragilité d’une gouvernance qui peine à stabiliser ses équipes et à démontrer des résultats tangibles. À force de remaniements et de discours de méthode, le risque est grand que la feuille de route présidentielle reste perçue comme un catalogue d’intentions plus qu’une stratégie opérationnelle.
Un sixième gouvernement pour une même profession de foi
Sur le plan économique, quelques indicateurs (*) paraissent encourageants mais restent fragiles. En 2023, l’Algérie a enregistré une croissance de 4,1 % du PIB. Au premier trimestre 2025, elle atteint 4,5 %, tirée notamment par le secteur hors hydrocarbures, en hausse de 5,7 % contre 4,3 % un an auparavant. Cependant, le taux de chômage demeure élevé : 12,7 % en octobre 2024 selon l’ONS, même si certaines enquêtes évoquent 9,7 %, un chiffre contesté. L’inflation, après avoir frôlé 9,3 % en 2022-2023, devrait se modérer, mais rester autour de 5,3 % en 2024 et 5,2 % en 2025, d’après le FMI.
Ces données illustrent un contraste : une croissance réelle mais inégalement ressentie par la population, et un marché du travail qui ne parvient pas à absorber durablement la demande, notamment celle des jeunes.
Promesses récurrentes, résultats incertains
Dans ce contexte, la feuille de route présidentielle paraît familière. Les mots-clés – « efficacité », « gestion intelligente », « priorité au citoyen » – reviennent à chaque formation gouvernementale. La continuité est évidente, mais les ruptures moins claires. Les remaniements successifs donnent l’impression non pas d’une adaptation maîtrisée, mais d’un enchaînement de corrections de trajectoire face à des urgences sectorielles ou à des critiques publiques.
Les performances macroéconomiques, bien que positives dans certains secteurs, restent à relativiser : la croissance ne se traduit pas toujours par une amélioration du pouvoir d’achat ni par une baisse durable du chômage ou des inégalités régionales. La promesse d’une « gestion intelligente » doit désormais être jugée sur les faits : quelles mesures concrètes pour réduire l’inflation, stabiliser l’emploi, diversifier l’économie au-delà des hydrocarbures ?
Le discours du président Tebboune fixe un cap séduisant – renforcer la crédibilité gouvernementale, mettre le citoyen au cœur de l’action, coordonner mieux l’exécutif. Mais dans un pays où l’on change de gouvernement presque tous les ans, ces professions de foi finissent par paraître comme des rituels attendus plutôt que des engagements inédits. La question demeure : ce sixième gouvernement parviendra-t-il à dépasser la rhétorique pour produire des résultats tangibles, ou bien s’agira-t-il encore d’un nouveau départ sans ligne d’arrivée clairement visible ?
La Rédaction
(*) Les données proviennent de sources économiques reconnues
Croissance 2023 (4,1 % du PIB) – Ce chiffre a été publié par la Banque d’Algérie dans son rapport annuel 2024 (paru en juin 2025) et relayé par l’APS.
Croissance 2025 (4,5 %, hors hydrocarbures +5,7 %) – Estimation issue des communiqués récents du ministère des Finances et de la Banque d’Algérie, reprise par des médias économiques algériens. Ce sont des données de conjoncture, donc encore susceptibles de révision.
Chômage 12,7 % (octobre 2024) – Taux annoncé par l’Office national des statistiques (ONS) dans son enquête emploi.
Le chiffre de 9,7 % provient d’une enquête plus restreinte de l’ONS début 2025, qui a fait débat car la méthodologie (période et échantillon) diffère.
Inflation 2022-2025 (≈9,3 % puis 5,3 % et 5,2 %) – Projections du Fonds monétaire international (FMI) dans ses World Economic Outlook 2024-2025, reprises par le ministère algérien des Finances et par le site du Trésor français.
- Publicité -