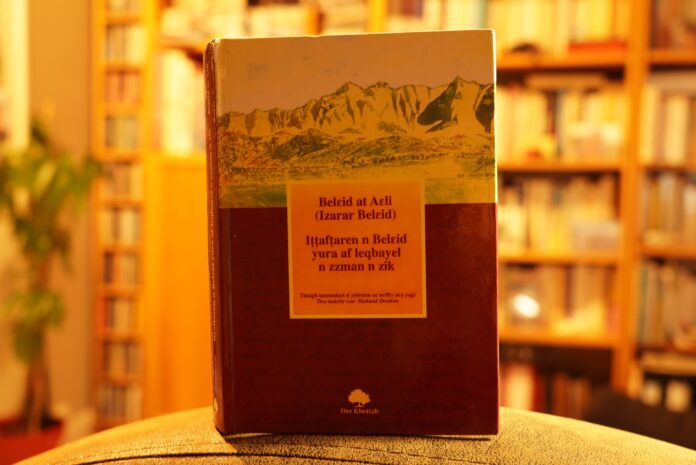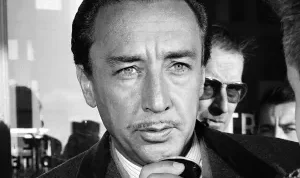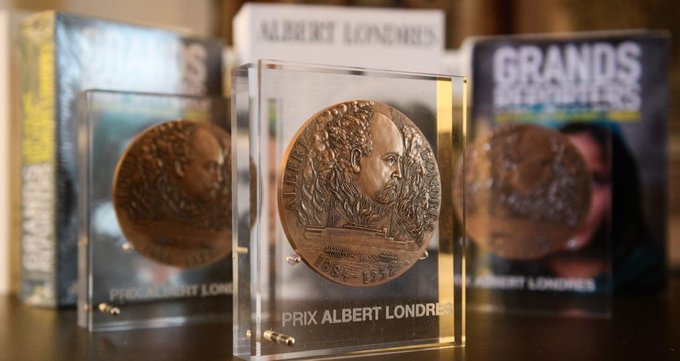Paru en août 2025 aux éditions Arcadia Tunisie Aimer n’a pas suffi… de Sam Bröcheler (Semia Setti) n’est pas seulement un roman sur l’amour : c’est une exploration des vies en mutation, des passions qui dévorent, des blessures qui se transmettent et des choix qui façonnent les destins. À travers Aline, Mia et Line, trois femmes de générations différentes, l’autrice peint la lutte constante pour aimer et être aimée, dans un monde où les sentiments refusent d’être domptés.
De Roubaix à Paris, de l’Algérie au retour à Paris, chaque lieu devient le miroir d’une introspection, d’une tension intérieure, d’un désir impossible à contenir. L’amour, dans ce roman, n’est jamais simple : il bouscule, consume, met à nu la fragilité et la force des personnages. Et pourtant, au cœur de ce tourbillon, Sam Bröcheler inscrit un fil conducteur universel : la tolérance et la bienveillance envers autrui, l’attention portée à la différence et à la complexité humaine.
Dans cet entretien pour Le Matin d’Algérie, l’autrice raconte comment ses personnages ont pris vie, comment ses mots sont devenus un espace pour comprendre la douleur, la passion et la liberté, et comment l’écriture elle-même est devenue un chemin vers l’intime et l’universel. Une plongée bouleversante dans un monde où aimer n’est jamais suffisant, mais toujours nécessaire.
Le Matin d’Algérie : Qu’est-ce qui vous a poussée à écrire Aimer n’a pas suffi… ? Était-ce un souvenir, une émotion ou une question qui ne cessait de vous habiter ?
Sam Bröcheler : En réalité, j’ai commencé à écrire Aimer n’a pas suffi… sans m’en rendre compte. J’écrivais sur plusieurs supports (cahier, téléphone, post-it). J’écrivais à n’importe quelle heure, quand je m’écoutais. Je me suis rendu compte que beaucoup d’idées affluaient dans ma tête, mais faute de disponibilité, je ne leur ai jamais prêté l’attention que je leur devais. Jusqu’au jour où j’ai décidé de ramasser mes supports (notamment audio) pour avoir une vue d’ensemble de ces idées éparpillées. Et là, a commencé à germer dans ma tête l’idée de poursuivre ce texte. Néanmoins, à aucun moment, je ne me disais qu’il s’agissait là d’un roman ! Qui suis-je pour prétendre écrire ! C’était le leitmotiv qui me revenait sans cesse pendant que j’écrivais.
Le Matin d’Algérie : Aline, Mia et Line traversent ce roman comme des échos l’une de l’autre. Comment les avez-vous façonnées, et y a-t-il un peu de chacune d’elles en vous ou autour de vous ?
Sam Bröcheler : Certainement qu’il y a une petite part de moi dans chacun de mes personnages. « Le roman, pour ne citer que Stendhal, est un miroir que l’on promène le long du chemin. » Cependant, je ne suis pas du tout « selfie ». Aussi, si je déteins sur mes personnages, c’est à mon insu que cela s’est fait. Par ailleurs, les personnages de Line, Mia et Aline se sont façonnés au fur et à mesure que la trame avançait. J’ai certes peaufiné les portraits via plusieurs retours au texte. Cependant, à aucun moment je ne me suis dit : « Line sera ainsi… ou Mia comme ceci ou comme cela… ». À un moment, j’ai compris que les personnages m’échappaient et que leurs personnalités respectives évoluaient seules, en échappant à ma surveillance.
Le Matin d’Algérie : Dans votre livre, l’amour n’est jamais un refuge tranquille mais une force qui bouscule et consume. Était-ce votre intention dès le départ de le montrer ainsi, ou le roman vous a-t-il guidée vers cette vision ?
Sam Bröcheler : Effectivement. Comme les personnages, la trame du roman m’a échappée. L’amour est un sujet vaste et très complexe car il s’agit d’un sentiment vivant qui évolue, qui mute, qui est incapable de se conformer aux lois préétablies par la société. Car il est sauvage, récalcitrant, imprévu. On ne peut le dompter. Une fois dompté, il entre dans nos cases. Il devient mariage, concubinage, usure et ennui. Autrement dit, l’amour ne peut se plier aux attentes de chacun sans être amoindri et donc sans être dénaturé. Dans ce cas, on ne parle plus d’amour, mais de compromis, de concessions, d’habitudes, de rituels qui sécurisent les couples. Ainsi, l’amour dans mon roman est très précaire et source de nombreux défis pour les personnages. Et fort heureusement ! Car lorsque l’amour est heureux, il n’y a plus d’histoires à raconter. Je cite Alfred de Musset : « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j’en connais d’immortels qui sont de purs sanglots. »
Le Matin d’Algérie : Rafet est un personnage à la fois séduisant et inquiétant. Comment avez-vous imaginé cette emprise subtile, qui s’infiltre presque à votre insu dans la vie de Mia ?
Sam Bröcheler : Le personnage de Rafet Marsli est le mélange d’un ours mal léché et d’un immigré qui ressent le besoin de toujours se justifier, de faire ses preuves et d’exceller dans ce qu’il fait pour mériter ce dont il dispose (sa femme, ses enfants, sa position…). Cependant, Rafet est également un pervers narcissique. Son portrait s’est imposé au fur et à mesure que l’amour qu’éprouvait Mia mutait. Dans le 15ᵉ chapitre, j’ai compris qu’évoquer l’enfance et le parcours de Rafet devenait primordial pour que le personnage puisse continuer à évoluer dans la trame. Sinon, il n’aurait pas pu endosser le rôle parfait de papa, de mari et de médecin.
Le Matin d’Algérie : Les douleurs et les cicatrices traversent les générations. Pour vous, qu’est-ce qui fait que l’amour peut devenir un héritage lourd à porter ?
Sam Bröcheler : L’amour n’est pas forcément un héritage. Dans le roman, on est face à trois scénarios possibles et les trois évoluent différemment. Ni les personnages, ni le poids de l’héritage ne sont responsables des déconfitures ou des succès en amour. L’amour en lui-même porte les fruits de ses propres échecs. Il n’a guère besoin de catalyseur. Que l’amour ait touché trois personnages de la même famille n’en fait pas un héritage familial puisque l’amour touche énormément de personnes. Les parcours et les tenants et aboutissants de chacune des trois histoires sont très différents. Chacune se démarque de l’autre par la manière dont elle a appréhendé le sentiment amoureux.
Le Matin d’Algérie : De Roubaix à Istanbul, de Paris à New York, vos personnages voyagent autant qu’ils s’égarent. Quelle place tient le déplacement géographique dans la construction de leur histoire intérieure ?
Sam Bröcheler : Le voyage occupe une place importante dans le roman et influe directement sur l’histoire de chacun. En voyageant, certains rencontrent un partenaire (Mia, Alain…), ou le fuient. D’autres découvrent une opportunité professionnelle (Dalhia, Abuzer). D’autres encore fuient leur vie pour se donner la chance de découvrir ce que la vie a de surprenant à offrir (Alyssa).
Le Matin d’Algérie : On sent, on touche presque les émotions dans votre style, comme dans « Je suis ivre d’un alcool inconnu… ». Comment travaillez-vous cette écriture qui plonge le lecteur dans les sensations et l’intime ?
Sam Bröcheler : Votre question me flatte dans le sens où je réussis, par le biais de mon style, à transmettre des sensations.
Ceci dit, je pense que travailler ses phrases, choisir ses mots, effacer, recommencer, réécrire… sont le seul moyen pour produire un texte assez proche des images et des dessins que l’on a en tête lorsqu’on écrit.
Le Matin d’Algérie : Vos personnages cherchent une forme de liberté au cœur de leurs passions et de leurs douleurs. L’écriture est-elle pour vous un chemin vers cette liberté, personnelle et universelle ?
Sam Bröcheler : L’écriture en tant que thérapie ? Oui, probablement, mais pas seulement ! L’écriture est avant tout un besoin instinctif chez moi. J’ai toujours réglé mes problèmes avec les gens ou avec moi-même par le biais de l’écriture.
Si j’ai un différend avec un proche qui compte vraiment dans ma vie, ou un ami qui a une place privilégiée dans mon cœur, je prends toujours la plume pour expliquer, justifier et, pourquoi pas, présenter des excuses. Écrire a toujours été un réflexe.
Concernant la douleur de mes personnages, je ne pense pas que cela soit un exutoire à mes propres douleurs. D’une part, ce n’est pas le même parcours. D’autre part, il n’y a rien d’autobiographique dans ce premier roman, quoiqu’en pensent certains lecteurs en conférant à un premier ouvrage une dimension biographique. Je pense que la douleur de mes personnages, je l’ai cueillie au fur et à mesure que la trame avançait dans mon imagination, dans le comportement des gens autour de moi… que sais-je !
Le Matin d’Algérie : Line traverse des zones d’ombre extrêmes. Était-il essentiel pour vous de montrer les conséquences de la passion mêlée à la douleur, ou est-ce surtout une métaphore du poids de l’héritage familial ?
Sam Bröcheler : Line est la version féminine actuelle de sa grand-mère et de sa mère. Elle est un bout de femme en quête de sa féminité changeante, en quête de son identité, de sa personnalité… À travers elle, j’ai peut-être voulu traduire le mal-être des jeunes actuels et surtout la confusion des messages qu’ils reçoivent à travers les réseaux sociaux.
Je pense qu’elle est le symbole d’une jeunesse en perdition, dans le sens où les parents sont tout de même démissionnaires puisqu’ils doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille, et qu’ils ne savent plus comment « prendre » leurs enfants pour les guider et les éduquer à cause du matraquage actuel concernant la façon d’élever les enfants sans les brusquer, sans les toucher, sans les contraindre… Par ailleurs, ces mêmes parents ont leurs propres soucis à gérer et pensent souvent que leurs enfants seront capables d’affronter seuls leur vie de jeunes. Mais c’est sans compter la fragilité inhérente à ces jeunes qui sont encore, malgré leur attitude sur la défensive, dans la demande de l’attention parentale.
Le Matin d’Algérie : Trois générations se déploient sous nos yeux. Comment avez-vous travaillé le rythme du récit pour que le temps qui passe soit ressenti autant que les émotions des personnages ?
Sam Bröcheler : Travailler le rythme a été effectivement un gros souci. D’une part, parce que les chapitres ont été écrits en dehors de la trame du roman. D’autre part, à cause de mon souci vis-à-vis du lecteur. J’avais peur qu’il ne puisse pas suivre le cours des événements. Ordonner les chapitres et les faire suivre a été, je l’avoue, un vrai casse-tête. Mais, in fine, je me suis dit : « Allez ! Je vais faire confiance à l’intelligence émotionnelle du lecteur. » J’ai opté pour ces allers-retours dans le temps et dans les événements, où chaque situation fait écho à une autre pour que l’harmonie de la trame en soit plus riche.
Le Matin d’Algérie : Sam Bröcheler n’est pas Semia Setti. Que vous apporte ce pseudonyme ? Est-ce un autre visage de vous-même, un souffle de liberté ou une protection de l’intime ?
Sam Bröcheler : Sam Bröcheler n’est pas si étranger à ma propre identité. Disons que c’est mon joker ! Sam est le diminutif avec lequel on m’appelle dans mon cercle intime, familial ou amical. Bröcheler est le nom de jeune fille de ma mère, qui est d’origine néerlandaise et qui n’est plus à mes côtés depuis des années. Mettre son nom en guise de nom d’auteur est ma façon de lui rendre hommage à elle et à mes grands-parents que je n’ai pas pu revoir avant leur mort. Ils m’ont tellement apporté durant mon enfance ! Quand j’écris, je puise ma force et toute ma confiance dans les six premières années de ma vie où j’ai eu la chance de les côtoyer.
Le Matin d’Algérie : Le lecteur est parfois troublé, parfois bouleversé par vos personnages. Cherchiez-vous à provoquer une émotion particulière, ou simplement à refléter la complexité de l’amour et de la douleur humaine ?
Sam Bröcheler : Mes personnages sont troublants ? Peut-être, mais n’est-ce pas le reflet de la réalité ? Nous sommes tous complexes et troublants à des degrés différents. Chacun d’eux peut très bien exister dans la réalité et, d’ailleurs, je pense qu’ils existent ! Il s’agit de personnages fictifs certes, mais qui ne sont pas très loin de la réalité, car après tout, je n’ai fait que reproduire le réel à travers mon prisme personnel.
Le Matin d’Algérie : Si vous deviez laisser au lecteur une seule résonance, une émotion ou une pensée en refermant le livre, laquelle serait-elle ?
Sam Bröcheler : Voilà une question bien compliquée. Je ne peux pas résumer trois cents pages en une idée. Mais, s’il faut retenir quelque chose, ce serait : la tolérance et la bienveillance envers autrui.
Chacun des personnages a vécu sa vie avec les cartes qu’il a reçues. Certains ont été plus intelligents que d’autres, dans le sens où ils ont vécu de meilleures situations en améliorant leur vie. Cependant, ils ont tous fait du mieux qu’ils pouvaient. Aucun n’a fait preuve de malveillance. La vie, c’est un peu cela. Il est essentiel de donner à l’autre le bénéfice du doute et de tolérer sa différence. Aline est allée au fond de ses tripes pour trouver la solution à son malaise. Elle croyait accomplir un acte héroïque et bien faire. À aucun moment, elle n’a soupçonné les dégâts et les préjudices que son acte irréversible entraînerait. Et cela est valable pour chacun de mes personnages. Ils pensent tous avoir bien fait et bien agi.
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Née le 27 janvier 1973 à Versailles, d’un père tunisien et d’une mère néerlandaise, Sémia Abdellatif Bröcheler a grandi entre Paris et Tunis. Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes, elle a enseigné le français pendant trente ans dans un lycée réputé en Tunisie.
Écrivaine et poétesse, elle a longtemps hésité avant de se consacrer pleinement à l’écriture, partagée entre son métier d’enseignante et son désir de créer. Aimer n’a pas suffi, son premier roman, est aujourd’hui disponible sur la plateforme Ceresbookshop.com. Elle vient également d’achever un recueil de poésie où elle explore, avec une plume sensible, des fragments de vie entre mémoire intime et quête universelle.
- Publicité -