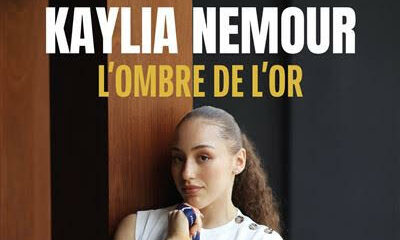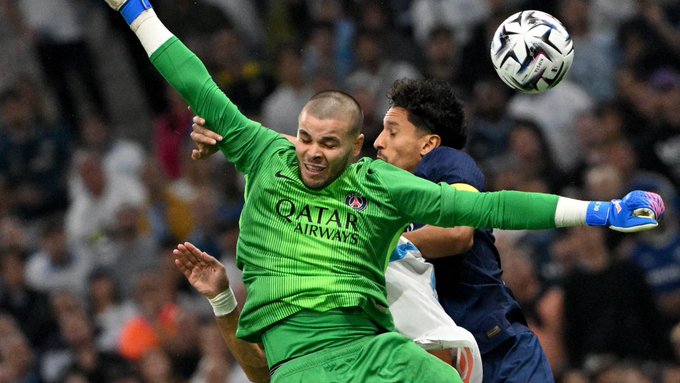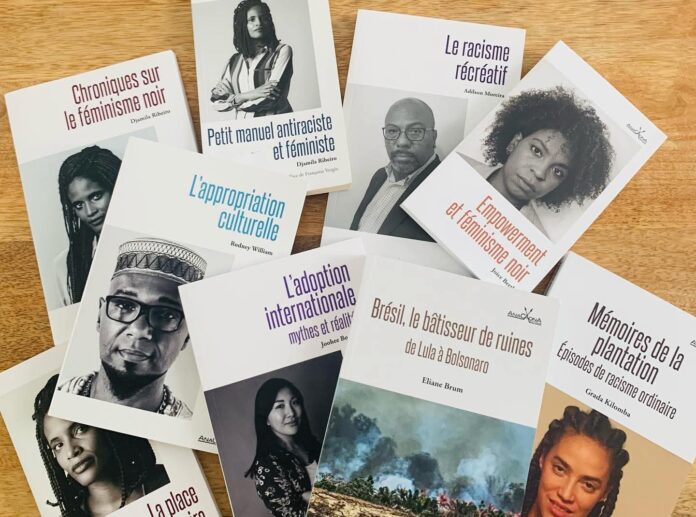Les « médias d’intérêt public », définis comme fournissant des informations factuelles et fiables, et indépendants sur le plan éditorial, « jouent un rôle crucial » et « pourtant, partout dans le monde, [ils] sont menacés », constate une dizaine d’économistes.
Une dizaine d’économistes de renom, dont les Nobel Joseph Stiglitz et Daron Acemoglu, ont mis en garde lundi contre un risque d' »effondrement du journalisme d’intérêt public » qui apporte une information de qualité, avec des « conséquences considérables » notamment sur l’économie.
« L’accès à des informations fiables est la ressource fondamentale qui alimente l’économie du XXIe siècle », comme « les époques précédentes dépendaient de la vapeur ou du charbon pour leur développement industriel », estiment-ils dans une déclaration collective publiée par le Forum sur l’information et la démocratie.
« Cette ressource sera encore plus essentielle dans l’économie future, axée sur l’intelligence artificielle », soulignent ces économistes, parmi lesquels figurent également Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle et Francesca Bria.
Les « médias d’intérêt public », définis comme fournissant des informations factuelles et fiables, et indépendants sur le plan éditorial, « jouent un rôle crucial » et « pourtant, partout dans le monde, [ils] sont menacés », constatent-ils.
Ils souffrent de difficultés financières, en raison de « la concurrence de plus en plus déloyale exercée par les géants de la technologie » et les plateformes, et subissent une « ingérence croissante des gouvernements, notamment des gouvernements autoritaires, mais pas exclusivement ».
Les économistes en appellent aux pouvoirs publics pour « investir dans un journalisme libre et indépendant », via des subventions directes ou indirectes, des « coupons citoyens » (montant à dépenser chaque année) ou en instaurant des « taxes numériques sur les principales plateformes ».
Ils préconisent aussi de « modeler les écosystèmes de l’information dans l’intérêt public », avec en particulier une « règlementation appropriée » des groupes technologiques et d’IA.
Ces mesures permettraient d’éviter « une trajectoire qui semble mener à l’effondrement du journalisme d’intérêt public, avec des conséquences considérables pour notre économie, notre société et nos démocraties », selon eux.
Leur coût est « relativement faible » et elles devraient être menées « en concertation avec la société civile et le secteur privé ».
Le Forum sur l’information et la démocratie découle d’un partenariat lancé en 2019 par la France et l’ONG Reporters sans Frontières (RSF), auquel une cinquantaine d’États ont adhéré.
AFP