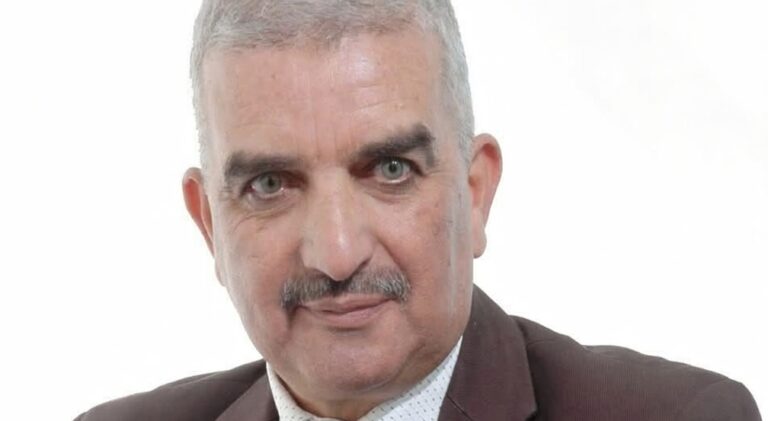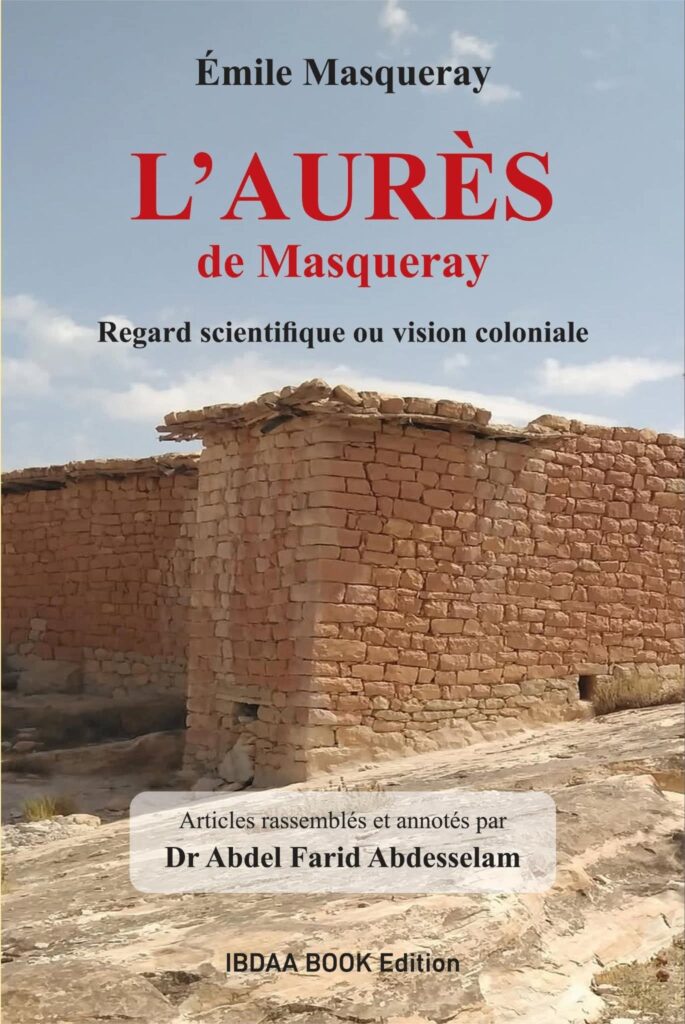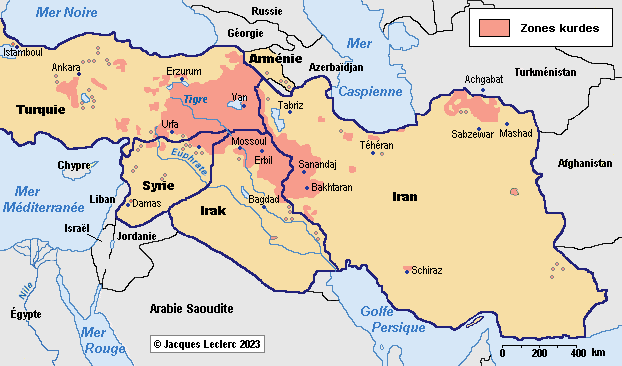En 1945, le Plan Marshall pose les bases d’un ordre international où l’Amérique échange sécurité et prospérité contre une centralité durable ; aujourd’hui, avec une dette proche de 39 000 milliards de dollars, cet investissement fondateur s’est mué en contrainte structurelle, révélant le dilemme d’une puissance dont le rôle de garant du système devient lui-même un facteur de vulnérabilité voire de déclin.
Derrière ce chiffre de la dette se cache une histoire humaine, celle de régions désindustrialisées, de classes moyennes fragilisées et de sociétés sommées de financer, génération après génération, le coût d’un rôle mondial dont les bénéfices se diffusent au-delà de leurs propres frontières.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l’ordre international s’est présenté comme une promesse de stabilité, de prospérité et de règles partagées, mais il s’est en réalité construit comme une architecture portée par un pays, les États-Unis fournissant au monde des biens publics qu’aucune autre puissance ne pouvait assumer seule — monnaie de référence le dollar, sécurité des routes maritimes, liquidité des marchés, crédibilité des institutions multilatérales. Ce système a permis l’essor des échanges, l’intégration des économies émergentes et l’expansion sans précédent des chaînes de valeur, mais il a aussi concentré sur les Etats-Unis les coûts de la stabilité globale, transformant le leadership en charge budgétaire, sociale et politique. À mesure que la dette s’accumule – aujourd’hui près de 39 000 milliards de dollars – que les fractures intérieures se creusent et que la concurrence stratégique s’intensifie, la question n’est plus de savoir si l’ordre international est juste ou injuste, mais s’il demeure soutenable pour ceux qui en ont été les principaux garants — et ce que signifie, pour le reste du monde, une Amérique qui ne cherche plus à préserver l’architecture entière, mais à en sauver la part qu’elle peut encore porter.
La charge de la stabilité
Dans la mondialisation actuelle, les États-Unis constituent un pilier structurel du système avec leur monnaie, leurs marchés et leur capacité de projection stratégique formant une infrastructure invisible sur laquelle repose une part décisive de la circulation mondiale des biens, des capitaux et de la confiance. Le dollar est devenu l’ossature monétaire d’un ordre international où la liquidité, le refuge et la prévisibilité sont fournis comme des biens publics informels à l’ensemble des économies, des centres financiers aux périphéries émergentes. Cette centralité confère à Washington une influence qui dépasse la logique classique de la puissance, mais elle l’enchaîne aussi à une responsabilité systémique d’absorber les excédents du monde, recycler ses déséquilibres en dette souveraine et garantir, souvent au-delà de ses intérêts immédiats, la continuité d’un espace économique global dont la stabilité conditionne l’accès au financement, la trajectoire de développement et la sécurité monétaire de la majorité des nations.
Concrètement, ce rôle de garant s’est traduit dans une chaîne continue de coûts visibles et différés — budgets de défense pour entretenir un maillage mondial de bases militaires et d’alliances, guerres lointaines de la péninsule coréenne aux déserts du Moyen-Orient, soins et pensions versés à des générations de vétérans, intérêts d’une dette contractée pour financer la stabilité globale. À cela s’ajoute une diplomatie de l’aide et des institutions, destinée à contenir les crises avant qu’elles ne deviennent systémiques. Additionnée et corrigée de l’inflation, cette facture à plus de 60 000 milliards de dollars, oscillant, selon les époques, entre 3% et 10% (guerre froide) de la richesse produite chaque année par les États-Unis.
L’ordre international peut se lire comme un contrat d’assurance implicite dont les États-Unis sont devenus l’assureur de dernier ressort. En temps de crise, le monde se tourne vers leur liquidité, leur sécurité et leurs marchés, tandis que les primes se transforment en dettes, déficits et engagements supportés par ce même pays au bénéfice de l’ensemble du système.
Ainsi, ce qui apparaît comme un privilège hégémonique se révèle être une charge structurelle, où la capacité de tenir le centre devient la condition même de la survie de l’ordre international qu’il soutient. Giovanni Arrighi, théoricien des cycles hégémoniques, nous avertit que les puissances déclinantes s’effondrent non par des menaces extérieures, mais par une résistance interne à l’adaptation – un avertissement qui s’applique à l’Amérique, enchaînée à son rôle systémique.
La facture du leadership mondial
La centralité américaine a inscrit la stabilité du monde dans le bilan de sa propre société, où la liquidité, la sécurité et l’ouverture se sont progressivement traduites en dettes, en déficits et en lignes de fracture. Le privilège du dollar a longtemps différé les choix entre puissance extérieure et investissement intérieur, faisant de l’endettement le régulateur silencieux d’un ordre international aux bénéfices mondialisés mais aux coûts largement supportés par les Etats-Unis. À cette pression financière s’est ajoutée une géographie des gagnants et des perdants, où certaines régions se sont intégrées aux flux globaux tandis que d’autres – comme l’Amérique – se sont désindustrialisées. Dès lors, la soutenabilité n’est plus un débat comptable, mais une épreuve politique, jusqu’où une démocratie peut-elle porter la stabilité du monde sans entamer la cohésion qui fonde sa propre légitimité ?
La mondialisation asymétrique
L’ordre économique mondial s’est construit comme un mécanisme d’expansion collective reposant sur une dissymétrie structurelle, où les gains de la croissance ont été largement diffusés tandis que les coûts de la stabilité se sont progressivement concentrés sur le pays capable d’absorber les déséquilibres du reste du système. Les excédents industriels et commerciaux de l’Asie, les stratégies d’accumulation de réserves des économies émergentes et la recherche globale d’actifs sûrs ont trouvé dans la dette américaine un réceptacle naturel, transformant les déficits des Etats-Unis en contrepartie financière de la prospérité mondiale. Ce schéma a offert aux pays du Sud un accès inédit aux marchés, au capital et aux chaînes de valeur, mais il les a aussi arrimés aux cycles monétaires et budgétaires des Etats-Unis, faisant de chaque inflexion de la politique américaine une onde de choc transmise aux monnaies, aux investissements et aux équilibres sociaux des pays du Sud. Ainsi, la mondialisation apparaît comme une architecture hiérarchisée de dépendances – et non un espace neutre d’échanges – où la promesse d’intégration s’accompagne d’une vulnérabilité systémique, et où la soutenabilité de la croissance de tous demeure étroitement liée à la capacité des Etats-Unis à continuer de porter le poids financier et politique de l’ensemble.
L’histoire offre un miroir troublant. Athènes finançait la sécurité de la mer Égée au prix de son trésor, Venise garantissait les routes du Levant en échange de sa prospérité, l’Empire britannique garantissait les mers au prix d’un endettement croissant.
Toutes ont découvert que le centre du monde devient aussi son principal point de fatigue. L’Amérique s’inscrit aujourd’hui dans cette lignée, où la stabilité globale fut à la fois la source de la grandeur et la semence du déclin.
Droit international et survie stratégique
À mesure que l’ordre international se complexifie et empile les règles, les traités et les institutions, une tension s’exacerbe entre l’universalité proclamée du droit international et la réalité des intérêts vitaux des grandes puissances, pour lesquelles la sécurité nationale, la continuité économique et la stabilité intérieure demeurent des lignes de survie non négociables. En Ukraine, à Gaza ou au Venezuela, le droit international se heurte aux impératifs de sécurité, de dissuasion et d’accès aux ressources stratégiques, révélant les limites d’un ordre international fondé sur des règles, oubliées lorsque celles-ci entrent en conflit avec les intérêts des grandes puissances. Cette fracture interroge sur la soutenabilité de l’ordre international lorsque ses garants – Etats Unis – considèrent que le respect strict du droit international affaiblit leur capacité à maintenir l’équilibre global.
La géopolitique des nœuds vitaux
Le Moyen-Orient – avec 30 % du pétrole mondial et 17 % du gaz naturel – demeure le cœur énergétique du monde, dont la stabilité conditionne l’inflation mondiale et les équilibres budgétaires des États importateurs. La mer de Chine méridionale – où transite plus de 20% du commerce mondial dont 45 % de pétrole brut – concentre les chaînes technologiques et industrielles dont dépendent les industries numériques et de défense.
Enfin, l’Arctique avec une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, s’ouvre comme une frontière d’un avenir proche en raison de la fonte accélérée de la calotte glaciaire, où l’émergence de routes transpolaires, l’accès à des ressources critiques et le déploiement de capacités de dissuasion modifient la cartographie des corridors de navigation maritimes et aériens. Dans cette configuration des espaces stratégiques, le Groenland s’impose comme un point de jonction entre la sécurité nord-américaine, la gouvernance des nouvelles routes et la définition des règles des espaces émergents. L’intérêt américain pour le Groenland s’inscrit dans une logique ancienne de prévention stratégique, dès 1940, après l’invasion du Danemark par l’Allemagne, les Etats-Unis s’y sont positionnés pour empêcher que cette dernière ne fasse de l’Atlantique Nord et de l’Arctique une zone de projection contre le continent nord-américain.
Pour l’Administration de Trump, sécuriser ces différents points d’appui revient à protéger l’infrastructure physique de l’ordre international ; pour les pays du Sud, dont près de quatre cinquièmes du commerce transitent par ces corridors maritimes et numériques, chaque tension dans ces espaces se traduit par des coûts immédiats sur les prix, les devises et l’accès aux marchés.
L’ «affaire» du Groenland
Le Groenland dépasse la seule question des territoires et des ressources, il révèle une mutation de la puissance au XXIᵉ siècle, où l’influence se mesure autant à la capacité de définir les règles des espaces émergents qu’à la maîtrise des zones déjà intégrées à l’économie mondiale. Tandis que le réchauffement climatique ouvre des routes transarctiques, rapproche l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord et rend accessibles des minerais critiques pour la transition énergétique et les technologies avancées, l’enjeu central devient la maîtrise stratégique de ces nouveaux espaces.
Les corridors transarctiques offrent des trajets jusqu’à trois fois plus rapides entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord, tout en réduisant l’exposition aux goulets d’étranglement et aux vulnérabilités sécuritaires qui caractérisent aujourd’hui des passages comme le canal de Suez ou Bab El Mendeb (mer rouge).
Pour les États-Unis, investir le Groenland, c’est projeter la sécurité nord-américaine dans le futur, sécuriser les corridors de demain et éviter que des puissances concurrentes ne définissent seules les standards d’accès, d’exploitation et de navigation.
Pour les pays émergents, cette reconfiguration annonce un monde où les centres de gravité du commerce et de l’influence peuvent se déplacer brutalement, reconfigurant les avantages comparatifs et les dépendances.
À mesure que ces recompositions se dessinent, une question s’impose, un ordre international peut-il durer lorsque la charge de sa stabilité devient plus lourde que les bénéfices qu’en retirent ses garants, et lorsque ceux qui en dépendent le plus n’en participent que marginalement à sa gouvernance ? La soutenabilité devient une épreuve morale et institutionnelle, où se confrontent la promesse d’un monde régi par des règles communes et la réalité d’un système structuré par des rapports de force. Préserver l’ordre international implique d’en redistribuer les coûts, d’en élargir la légitimité et d’en pluraliser les centres de décision ; assumer la rupture, c’est accepter une fragmentation où la stabilité cède la place à des équilibres régionaux concurrents, plus flexibles mais aussi plus instables. Entre ces deux voies se joue le destin des décennies à venir. L’histoire ne jugera pas l’Amérique sur la puissance qu’elle a exercée, mais sur la capacité du monde à rester stable le jour où elle cessera d’en porter seule le poids.
Ould Amar Yahya
Economiste, banquier et financier