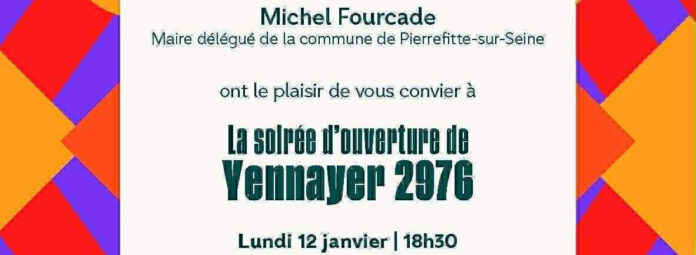Donald Trump revendique le Groenland parce qu’il veut un gros glaçon dans son whisky. Et quel autre terrain de golf aussi magnifique pourrait-il construire en rapport avec sa gigantesque mégalomanie ?
Dans cette affaire, comme pour toutes les crises quotidiennes du Président, il faut savoir prendre du recul avec l’humour qui protège des drames incompréhensibles.
Laissons ce démoniaque pour un instant et penchons-nous vers la connaissance, même très succincte, de la population de ce si beau pays. Car Donald Trump se fiche de l’existence d’un peuple autochtone et encore moins de la richesse humaine si ce n’est que dans son pétrole et autres revenus du sous-sol.
Le Groenland, un gros glaçon sur une terre qui est encore un de ces rares lieux qui éveille notre imaginaire sur le lointain, l’inconnu et l’insolite. C’est toujours ce qui s’empare des sociétés humaines lorsque les populations, les lieux ou les cultures ne sont connus que dans une vague représentation de l’esprit. Place est toujours dans ce cas laissée aux rêves de l’aventure impossible.
C’était bien le cas avec la Chine, l’Inde ou les « Amériques » dans les siècles passés. Bien entendu que nous connaissions l’existence de ce pays du bout du monde et un minimum de son histoire mais je suis sûr que les populations de la planète se sont ruées vers les documentations pour comprendre un peu plus.
Cette malheureuse communauté de moins de 56 000 habitants voulait seulement vivre dans la libre souveraineté de son destin qui a traversé tant de périodes soumises à la colonisation brutale depuis des siècles. Elle voulait juste la paix et la tranquillité que créent si bien les immenses territoires de beauté et de préservation de la nature, aussi contraignante soit-elle.
Son histoire est millénaire et assez bien documentée à partir de la venue des Inuits, peuplades que nous retrouvons au fin fond des frontières de l’océan Arctique. Puis ce fut la conquête des Vikings au 10 ème siècle, comme ils le firent à ce moment en Europe.
On peut s’imaginer combien l’histoire édulcorée du brassage des cultures de cette période est romancée, allez raconter aux Inuits qu’elle aurait été riche en échanges culturels et de pratiques sociales.
Même si le Danemark et la Norvège avaient revendiqué la possession du territoire bien avant, la colonisation débuta réellement au début du 18ème siècle suite à l’arrivée d’un pasteur missionnaire norvégien aux fins d’une évangélisation. Pourquoi dit-on alors que la colonisation est danoise ? Tout simplement parce qu’à cette époque se forma l’Union Danemark-Norvège sous l’autorité du roi du Danemark. Ainsi, comme attendu, le roi du Danemark avait revendiqué ses droits sur les terres du Groenland. Fermé (par la géographie notamment), le pays devint donc un domaine colonial exclusif où avaient prospéré de nombreux commerces comme celui des fourrures et des graisses.
Comme les colonisations d’intérêts en arrivent toujours à la domination brutale, c’est au 20ème siècle que l’horreur danoise avait atteint le pic de la barbarie coloniale. Quatre des plus horribles événements resteront à jamais gravés dans la mémoire de ce paisible peuple.
En 1951, 22 enfants avaient été arrachés à leurs familles pour être envoyés au Danemark afin d’en faire des « élites » qui, bien entendu, étaient destinés à être le relais pour la cause coloniale. Á leur retour ils avaient été entièrement déracinés, y compris par la perte de leur langue maternelle et ont eu des destins brisés. Une expérience identique à celles que font subir les scientifiques du comportementalisme aux animaux.
En 1953, des familles entières de chasseurs Inuits ont été chassées de leur terre afin de construire la base militaire américaine de Thulé. C’est dire le souvenir qu’a ce peuple envers les américains.
En 1960, arrive le « parcage » de la population dans des villages côtiers, particulièrement dans des immeubles qui nous font rappeler la naissance de l’expression en France « les quartiers ». Il s’en est suivi une déculturation profonde qui mène au cercle vicieux de la déchéance sociale comme celle provoquée par l’alcool ou la dépression. En tout cas vers tout sauf vers une véritable instruction.
Mais le pire, l’abominable, fut dans les années 60-70, c’est-à-dire à notre période contemporaine, ce qu’on appelle « l’affaire des stérilets ». Le Danemark avait organisé une campagne de pose de stérilets, très souvent sans consentement des jeunes filles et des femmes, afin de limiter la croissance démographique dans les populations autochtones.
Nous étions là dans le domaine des abominables exploits du nazisme. Les témoignages des femmes de cette époque sont édifiants. Certaines disent qu’elles ont mis longtemps à comprendre l’origine de leur stérilité.
La population du Groenland avait fini par accepter l’accord avec le Danemark pour une autonomie partielle. Des représentants locaux élus et institutions lui permettent de vivre une relative autonomie, le Danemark restant souverain pour la diplomatie et la défense.
Intégrés dans l’Union européenne, les Groenlandais sont divisés entre leur souhait d’obtenir leur indépendance totale et celui d’être protégés militairement et financés pour une partie de leur dépendance économique. Il est évident que le souhait d’indépendance l’emportera un jour ou l’autre.
Nous voilà revenus à l’actualité du moment. Imaginez la tête des populations locales lorsqu’un loufoque excité vient leur dire qu’il les achète, eux et leur terre natale, pour garantir la sécurité des Etats-Unis. Eux qui avaient pourtant signé des accords pour la localisation de bases américaines, autant qu’ils le souhaitaient ainsi que des partenariats économiques qui auraient largement alimenté l’appétit du démon américain pour l’argent.
Les Groenlandais ont exprimé majoritairement leur refus d’être achetés, en paquet avec leur pays, comme un hamburger. Ils avaient avalé l’histoire peu joyeuse avec le Danemark et finalement y ont trouvé un moindre mal avec la protection de l’Europe et de l’Otan ainsi qu’un financement qui n’était pas des moindres avantages.
Ils avaient le meilleur refuge possible en attendant ce qu’ils désirent le plus, d’une manière majoritaire dans la population, leur indépendance.
Par son offre, le bulldozer Trump leur propose une annexion définitive. Ils n’auraient ni la prospérité ni l’honneur d’une perspective d’une souveraineté chèrement espérée depuis des siècles.
J’attends que Donald Trump revendique l’annexion de la Place d’armes à Oran. Toute son armée ne viendrait jamais à bout de nos farouches lions.
Je vous l’avais dit, le comique nous permet de prendre de la distance envers ce qui est dramatique et folle aventure.
Boumediene Sid Lakhdar
PS : on entend souvent le terme « esquimau » pour le nom des habitants du Grand Nord. Un habitant du Groenland vous rectifiera (s’il parle en français) en vous disant qu’il est d’origine Inuit et que l’appellation « esquimau » est le nom qui leur a été donné par les Danois ou les Français et qui leur semble être connoté de mépris. Ce qui est vrai mais j’invite cependant le lecteur à m’en préciser le sens exact car ma connaissance peu érudite est peu assurée par la profusion de traductions que j’ai pu lire.
Méfiez-vous de la première proposition, même si elle est répétée, qui vous tombe sous les yeux.
- Publicité -