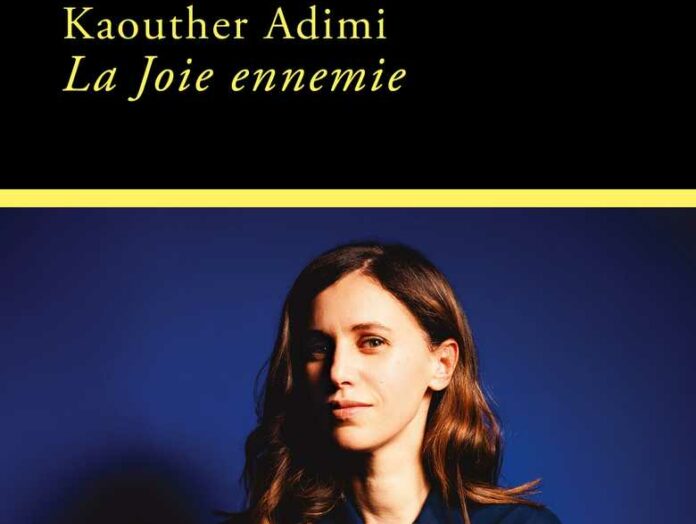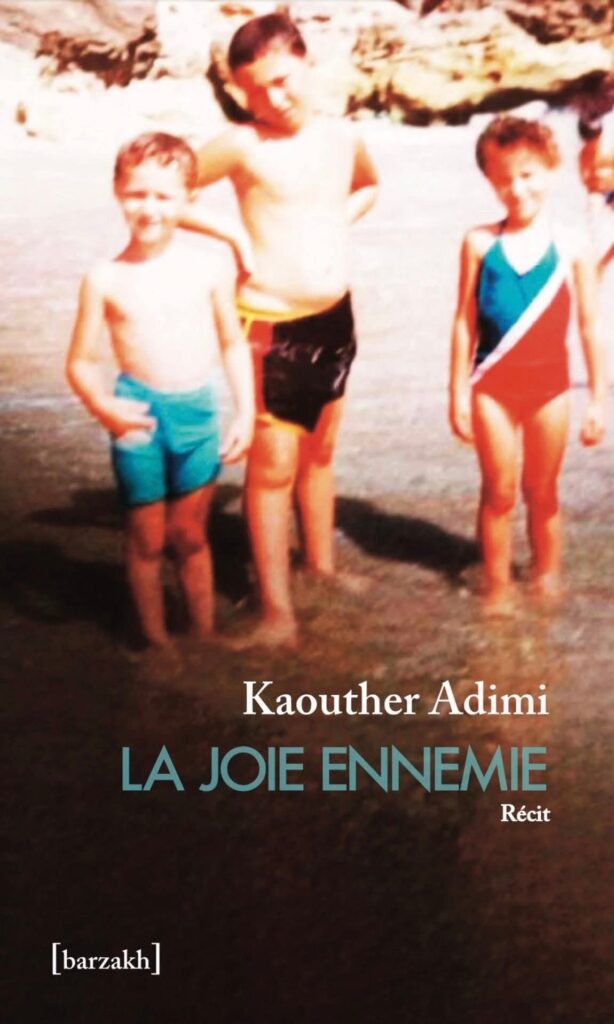À l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, le Sénat algérien – le Conseil de la Nation – a publié un long communiqué célébrant « l’Algérie victorieuse» et réaffirmant son attachement aux idéaux démocratiques et à l’égalité entre les sexes.
Un texte au ton volontiers triomphaliste, qui salue « les pas franchis » pour l’émancipation des femmes et magnifie « l’ancrage démocratique » du pays. Mais derrière cette rhétorique officielle, la réalité politique et sociale algérienne demeure bien plus contrastée.
Un discours officiel volontariste
Le communiqué, signé par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, reprend les thèmes chers au pouvoir : consolidation du cadre institutionnel, promotion de la femme « dans toutes les sphères », soutien du président Abdelmadjid Tebboune. L’égalité entre les sexes y est érigée en « droit humain fondamental », et la démocratie présentée comme un processus « inclusif et irréversible ». Cette déclaration s’inscrit dans une stratégie de communication qui vise à montrer une Algérie moderne, attachée aux standards internationaux et à l’idéal d’égalité.
Libertés publiques sous tension
Pourtant, le tableau dressé par les organisations de défense des droits humains diverge nettement. Depuis le mouvement du Hirak (2019-2021), la scène politique est marquée par la répression des libertés publiques : arrestations de militants, restrictions du droit de manifester, contrôle strict de la presse indépendante. Les partis d’opposition demeurent sous surveillance et la société civile, la vraie , peine à se faire entendre. L’ouverture démocratique vantée par le Sénat contraste ainsi avec un climat politique où l’expression critique reste risquée.
L’égalité femmes-hommes à l’épreuve du droit
Sur le plan juridique, l’égalité entre femmes et hommes se heurte toujours à des pesanteurs structurelles. Le Code de la famille, inspiré de la charia, continue de régir les rapports privés et intra-familiaux, conférant à l’homme un rôle prééminent dans le mariage, la garde des enfants ou l’héritage. Certes, le gouvernement a récemment levé certaines réserves sur la Convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Mais cette initiative a déclenché une vive opposition des courants islamistes, qui y voient une menace pour la « cohésion de la famille » et un pas contraire aux « principes de l’islam ».
Cette polémique illustre la tension permanente entre les engagements internationaux de l’Algérie et les résistances internes à une pleine égalité juridique. Les réformes demeurent fragiles, et l’émancipation réelle des femmes reste entravée par les normes sociales et la force du conservatisme religieux.
Un paradoxe persistant
En célébrant la Journée internationale de la démocratie, le Conseil de la Nation entend projeter l’image d’un État sûr de son cap. Mais le contraste entre le discours officiel et l’expérience vécue par la société algérienne est manifeste. La démocratie proclamée peine à se traduire en pratiques effectives, et l’égalité hommes-femmes, présentée comme une « victoire », reste largement inachevée. Le paradoxe algérien se résume peut-être ainsi : une rhétorique ambitieuse face à une réalité où les libertés publiques et les droits des femmes demeurent étroitement encadrés.
Samia Naït Iqbal
Lien pour lire la déclaration du Sénat algérien a la source
https://www.majliselouma.dz/ara/events