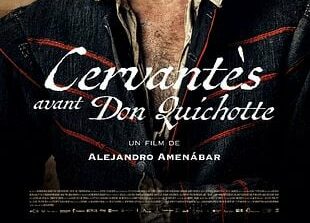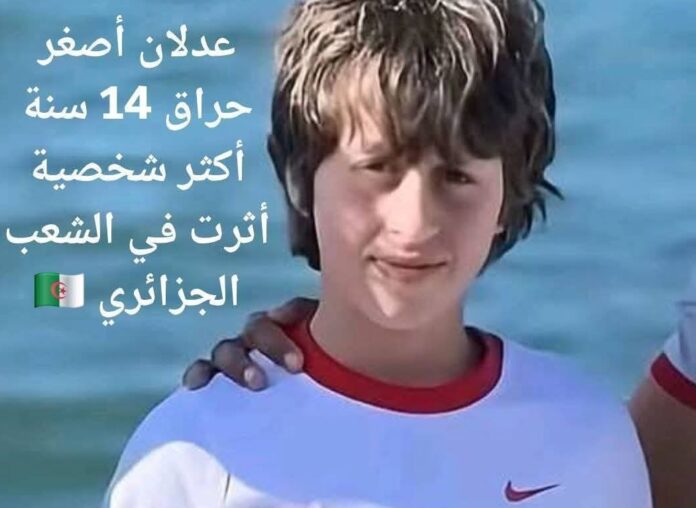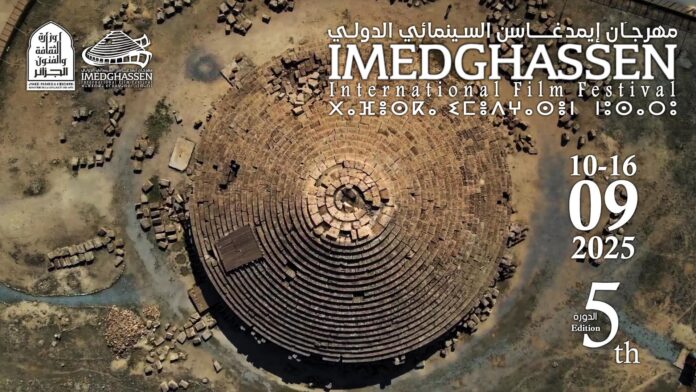Je sors du film Sirāt. Et je ne suis pas seul. Autour de moi, les visages sont graves, les regards absents. Personne ne parle. On dirait que chacun revient d’un lieu – d’un non-lieu, plutôt – que les mots ne peuvent nommer. Je les observe, je me reconnais. Nous avons tous le visage de ceux qui ont traversé quelque chose. De mystique, brûlant. Indicible.
Sirāt n’est pas un film, non. C’est une épreuve. Une traversée intérieure. On y marche comme Moïse dans le désert, comme Jésus dans la solitude, comme Muhammad dans la grotte de Hira. Mais aussi comme Ulysse errant sur les mers, comme Orphée descendant aux Enfers, comme Œdipe aveuglé par sa propre vérité. Tous ces héros, qu’ils soient bibliques, coraniques ou grecs, ont affronté un destin, des forces qui les dépassent, traversé des limbes — ces zones d’attente, de suspension, où l’âme vacille entre deux mondes.
Dans Sirāt, les personnages ne sont pas guidés par une quête obscure. Ils errent dans un espace qui ressemble aux limbes : ni enfer, ni paradis, mais un entre-deux brûlant, minéral, tenu. Le récit est là, discret, presque effacé. Il ne guide pas, il est juste le fil d’Ariane d’une introspection douloureuse, tendue entre la fête et la fin, entre la vie et la mort.
La rave qui ouvre le film est une convulsion. Une célébration sans joie, une transe collective au cœur du désert marocain. Les corps s’agitent comme pour conjurer une fin imminente. Ce n’est pas la fête qui les anime, mais une prescience urgente : se perdre avant d’être englouti.
La musique techno, lancinante, martèle le sol comme un tambour des enfers. Elle ne libère pas, elle boucle à double tour. Elle creuse. Elle transforme la danse en rituel de désintégration.
La techno est le son mitoyen de la mort. Elle pulse comme un battement funèbre, une vibration qui sépare les vivants des ombres. Elle ne célèbre pas la vie, elle sonne sa dissolution.
Et pourtant, de cette rave, quelque chose de sacré surgit. Les corps tournoient, s’élèvent et chutent dans la même équation. Les images de la fête se superposent aux visions télévisées du pèlerinage à La Mecque : mêmes foules costumées selon les canons édictés par l’archange, même mouvement circulaire, même ferveur. Mais ici, pas de Kaaba, et son attrait cosmique de morceau de météorite, au centre — seulement le vide, un autre vide, dénué des clameurs des anges et du fer des purificateurs. Ce vide-là aspire, consume, inspire.
Dans ces paysages d’apocalypse et de paradis entremêlés dans l’instant abasourdi, le voisinage entre le gnawa et la rave devient saisissant : deux formes de transe, deux appels à l’invisible. Mais là où le gnawa invoque les esprits pour les apaiser, la rave les convoque pour les affronter. Danse féroce et appel à la transcendance. Les corps ne cherchent pas à s’élever, mais à se dissoudre. Et lorsque la danse cesse, quelque chose bascule.
L’abandon de la danse est le début du cheminement dans la mort. Le silence qui suit est plus lourd que la musique.
Et puis, le désert. Ocre et immense, indifférent. Il n’est pas un décor, il est une énigme. Une entité lunaire qui absorbe les cris, les pas, les prières pour les régurgiter en accidents géologiques. Dans Sirāt, le désert est le lieu de la solitude absolue. Pas celle qui repose, mais celle qui se morfond, se ronge le cortex. Il n’offre aucun refuge, aucun repère. Aucune porte. Miroir du néant balisé, il oblige à se regarder en face, à marcher sans but, à écouter le silence comme un écho de soi-même résonnant dans les monstrueuses baffles de la rave.
Mais le désert est aussi le lieu de l’inattendu. Il ne promet rien, mais il ne révèle rien d’autre que le leurre et l’invisible, le mirage et le virage. Il est le théâtre du surgissement — de la mémoire, du deuil, de la vérité. C’est là que le père, cherche sa fille disparue, le folie cherche une pause de raison, la foi un Dieu. Et c’est là que le film se déploie : dans les interstices des mirages, dans les éclats de sables échappés au Big Bang originel, dans les spectres fugaces fugaces. Le désert ne donne pas de réponses, mais il impose des questions. Il est l’espace du vertige, du basculement, du face-à-face avec soi.
La rave, dans ce contexte, devient une tentative désespérée de faire du bruit dans un monde qui ne répond plus. Mais le désert ne danse pas. Il observe. Il attend. Il avale.
Et c’est là que Sirāt devient mystique. Car dans cette solitude, dans cette fête qui s’effondre, quelque chose se révèle. Une vérité nue, douloureuse, mais nécessaire. Le fil du Sirāt se tend. Et chacun, seul, doit décider s’il continue à marcher.
Le Sirāt, c’est aussi cette route étroite entre les mines du désert. Seule la foi, les yeux fermés sur la confiance aux Dieux de cet Olympe déchue, sécurise le mince ru de confiance vers la paix et la vie. Le faux pas qui danse sur la mine est le pas de coté pour revenir dans l’axe de l’univers.
D’un côté, les rochers inexpugnables. De l’autre, le ravin vertigineux. C’est le chemin de crête, invisible, où chaque pas menace de basculer. Une traversée entre la menace et le salut, comme Iphigénie sacrifiée pour un vent propice, ou Orphée se retournant pour perdre à jamais son amour. Le film ne le montre pas littéralement, mais il le fait ressentir — dans la tension des corps, dans la lumière qui aveugle, dans le vertige moral.
Le véritable personnage principal ici, c’est la lumière. Celle de la nuit, trouée par les phares des véhicules comme autant de balises dans l’obscurité morale. Celle du soleil, qui ne réchauffe plus mais s’effondre dans sa propre incandescence, noyé dans une blancheur spectrale — une vision diaphane, presque irréelle, des ombres de la mort. La lumière ici n’éclaire pas le chemin, elle le rend plus étroit. Elle est le fil du Sirāt, tendu entre les vivants et les morts. Elle est ce halo qui entoure les âmes comme une menace, ou une promesse de chute.
Le premier mort est un enfant. L’innocence, épargnée par l’enfer. Il ne traverse pas le Sirāt — parce qu’il est déjà ailleurs. Et nous, les vivants, nous marchons encore. Vacillants. À un souffle de la chute.
Le film, dans sa forme, est paradoxal. D’un côté, il y a très peu de dialogues — on pense à L’Île nue de Shindō Kaneto — et c’est là la vocation du cinéma : faire parler l’image. Et en même temps, c’est du cinéma qui vous emporte en vous faisant oublier que c’est du cinéma. Il ne se regarde pas, il se traverse. Il ne se commente pas, il se vit.
Je ne prétends pas comprendre Sirāt. Je ne peux que témoigner de ce qu’il m’a fait. Il m’a laissé silencieux, troublé. Et surtout, il m’a fait comprendre que la fête, parfois, n’est pas la célébration de la vie, mais la préparation à une autre traversée.
Arezki Metref
- Publicité -