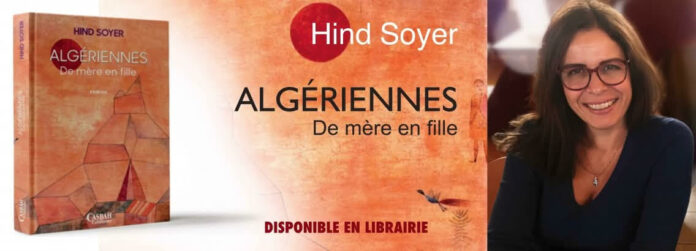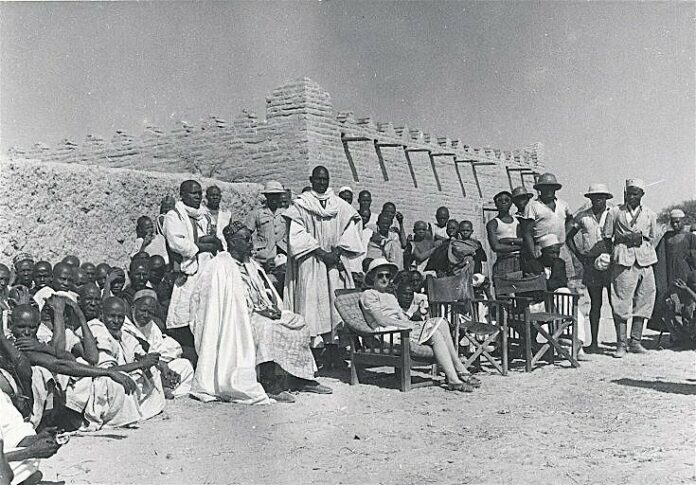Entre 1968 et 1973, le Royaume-Uni a expulsé le peuple chagossien de son archipel, un acte qualifié de déportation forcée relevant du crime contre l’humanité par Human Rights Watch. Cette expulsion a violé des principes fondamentaux du droit international, notamment le droit à l’autodétermination, les droits des peuples autochtones et les droits humains essentiels tels que la liberté de circulation, le logement, la culture et la dignité.
Aujourd’hui, les Chagossiens continuent de revendiquer leur retour et la pleine reconnaissance de leurs droits. L’avocat et conseiller du Gouvernement de Transition de la République de l’Archipel des Chagos (GTRAC), Saïd Larifou, revient sur les violations subies, les instruments juridiques et diplomatiques disponibles, ainsi que sur la création du GTRAC comme expression politique de l’autodétermination. Il explique également comment les Chagossiens peuvent engager des recours devant les juridictions nationales et internationales, réclamer réparation, préserver leur culture et leur langue, et renforcer leur visibilité diplomatique.
Cet entretien met en lumière les démarches juridiques, politiques et diplomatiques visant à restaurer la souveraineté du peuple chagossien, tout en soulignant l’importance de la reconnaissance internationale de leur droit inaliénable à disposer de leur archipel.
Le Matin d’Algérie : Du point de vue du droit international, comment qualifiez-vous l’expulsion des Chagossiens par le Royaume-Uni entre 1968 et 1973 ?
Said Larifou : Le terme « expulsion » peut paraître relativement disproportionnée au regard de la violence,de la brutalité et du mépris à la fois du Droit et du peuple Chagossien consécutivement à l’acte commis par les britanniques. Le peuple Chagossien est victime d’un acte manifeste de déportation forcée d’une population autochtone, relevant du crime contre l’humanité, comme l’a reconnu Human Rights Watch en 2023. Les Chagossiens ont été victimes de déportation violente. Cela constitue une violation grave et continue du droit international et de la Charte des Nations Unies. En outre, dans ce dossier, le Royaume-Uni, membre du conseil de sécurité, continue à agir en contradiction avec la Charte des Nations Unies (articles 73 et 74 sur la décolonisation), avec la Déclaration universelle des droits de l’homme (articles 9 et 13) ainsi qu’avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit le droit de choisir librement sa résidence et le droit au retour.
Le Matin d’Algérie : Quels principes de droit international ont été violés à cette occasion (autodétermination, droits des peuples autochtones, droits humains…) ?
Said Larifou : Plusieurs principes essentiels ont été bafoués. Le premier est le droit à l’autodétermination consacré par la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU de 1960. Le second concerne le droit des peuples autochtones à rester sur leurs terres ancestrales. Enfin, les droits humains fondamentaux tels que le droit à la dignité, à la liberté de circulation, au logement et à la culture ont été gravement violés. À cela s’ajoute l’interdiction des déplacements forcés, inscrite dans le droit coutumier humanitaire.La volonté d’effacer le peuple Chagossien de la carte, le déni de leur existence, à leur culture, à leur histoire et les obstacles érigés pour les empêcher, souvent par des manœuvres, des mensonges, des manipulations ne résistent à l’aspiration de ce peuple à l’autodétermination, à prendre son destin en main et prendre pleinement possession de ses terres.
Le Matin d’Algérie : Quels sont les instruments juridiques internationaux les plus pertinents pour soutenir la revendication du retour des Chagossiens et à l’autodétermination ?
Said Larifou : Le peuple Chagossien aspire à devenir pleinement souverain et leur archipel devenir un État au sens du droit international car il remplit tous éléments constitutifs requis. L’absence de ce peuple sur son territoire est, en réalité, la conséquence directe de son extradition forcée par la puissance occupante qui est illicite au regard du droit international. En plus du droit international, plusieurs instruments juridiques et décisions viennent renforcer les revendications légitimes des Chagossiens. La résolution des Nations unies a défini la période 2020-2030 comme la quatrième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme, appelant à une décolonisation rapide et définitive des territoires encore occupés.
La Charte des Nations Unies (chapitre XI), les nombreuses résolutions de l’Assemblée générale — en particulier la résolution 73/295 adoptée en 2019 — ainsi que l’avis consultatif rendu la même année par la Cour internationale de Justice (CIJ), ont clairement établi le caractère illicite de la séparation de l’archipel des Chagos d’avec Maurice en 1965. À cela s’ajoutent d’autres instruments internationaux : la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui s’impose au Royaume-Uni, et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007, qui consacre le droit des communautés autochtones à disposer de leur territoire, à préserver leur culture et à exercer leur droit à l’autodétermination. Ce corpus juridique forme une base solide en faveur des Chagossiens et légitime leur droit au retour, à la réparation et à la reconnaissance de leur souveraineté.
Le Matin d’Algérie : La résolution 73/295 de l’ONU et l’avis de la CIJ sur l’archipel des Chagos ont-ils un poids contraignant pour la restitution des terres ?
Said Larifou : L’avis consultatif de la CIJ n’a pas de force contraignante directe, mais il possède une autorité morale et juridique considérable. Quant à la résolution 73/295 de l’ONU, elle n’est pas juridiquement contraignante, mais elle reflète néanmoins la volonté de la majorité de la communauté internationale. Ensemble, ces deux instruments renforcent considérablement la légitimité des revendications des Chagossiens et exercent une pression diplomatique croissante sur Londres.
Le Matin d’Algérie : Les Chagossiens peuvent-ils engager des recours devant les juridictions britanniques ou internationales pour obtenir réparation et restitution ?
Saïd Larifou : Oui, des actions judiciaires engagées devant les juridictions britanniques, pas forcément pour les mêmes objectifs, ont eu des résultats mitigés. Des Chagossiens ont déjà intenté plusieurs actions entre 1998 et 2008, mais ils ont été déboutés. Il leur est néanmoins possible de s’adresser aux juridictions internationales afin de solliciter l’application de la Convention ainsi que la reconnaissance du droit international à l’autodétermination. Au niveau international, la piste la plus solide reste la Cour pénale internationale, qui pourrait être saisie pour crime contre l’humanité, une option déjà évoquée par Maurice en 2020.
Le Matin d’Algérie : La création du Gouvernement de Transition de la République de l’Archipel des Chagos (GTRAC) a-t-elle une valeur juridique dans le cadre de l’autodétermination ?
Saïd Larifou : La création du GTRAC est un acte historique qui replace le dossier de Chagos dans un angle explicitement politique, une démarche complètement différente des actions menées jusqu’à maintenant par des organisations et des personnalités de la société civile avec le soutien du gouvernement Mauricien qui, il faut le reconnaître, constitue un soutien précieux au peuple Chagossien. Ce gouvernement incarne une expression politique et sa création traduit les aspirations légitimes d’autodétermination de ce peuple. Bien qu’il ne soit pas encore reconnu officiellement par l’ONU, sa reconnaissance certaine s’appuiera sur le droit international des peuples à disposer d’eux-mêmes et constitue donc un élément fort sur le plan symbolique et juridique.
Le Matin d’Algérie : Comment cet acte peut-il être utilisé dans des procédures diplomatiques ou juridiques pour renforcer les droits des Chagossiens ?
Saïd Larifou : En ma qualité d’avocat conseil, constitué par le Gouvernement de transition de Chagos, il me semble important de souligner que cet acte politique n’est pas une déclaration de guerre faite contre qui que ce soit. Ce Gouvernement m’a donné comme mission de rappeler que le peuple Chagossien est seul habilité à prendre des décisions concernant le destin de leur archipel. Pour la bonne administration de la colonie britannique, l’archipel de Chagos était rattaché administrativement à l’île Maurice.
Pendant la colonie les actes de souveraineté sur le territoire de Chagos ont été exercés par le gouvernement britannique. Désormais, le GTRAC se positionne comme un interlocuteur officiel représentant la communauté Chagossienne dans les négociations devant conduire à l’indépendance effective de l’archipel. Des actions judiciaires et des initiatives diplomatiques sont prévues pour obtenir la révision de certains accords sur le destin de Chagos conclus sans consultation du peuple Chagossien. Enfin, il peut renforcer la visibilité diplomatique de la cause, notamment auprès de l’ONU, de l’Union africaine et de la Cour africaine des droits de l’homme et faciliter les démarches diplomatiques vue de la reconnaissance internationale du Gouvernement de Transition de l’archipel de Chagos.
Le Matin d’Algérie : Quels mécanismes juridiques pourraient permettre la restitution effective des terres et des ressources aux Chagossiens ?
Saïd Larifou : Plusieurs mécanismes sont envisageables. L’un d’eux est la révision de l’accord conclu entre la République de Maurice et le Royaume-Uni sans consultation ni consentement du peuple Chagossien.
Le Gouvernement de transition de l’archipel de Chagos, soutenu par le peuple souverain, engage actuellement des procédures judiciaires et agit diplomatiquement pour exiger que le peuple Chagossien soit reconnu comme seul habilité à prendre des décisions sur le destin et la gestion de son territoire. Il existe des instruments juridiques internationaux et diplomatiques adéquats qui peuvent être mis à la disposition des Chagossiens qui exigent de gérer eux-mêmes leurs affaires.
Enfin, un recours à un arbitrage international, notamment devant la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, est sérieusement envisagé. Dans ses démarches, le Gouvernement de transition de l’archipel de Chagos bénéficie du soutien massif des forces vives africaines notamment des écrivains, des historiens, des artistes et des organisations politiques. Des institutions internationales spécialisées dans les actions de décolonisation soutiennent également les initiatives du gouvernement de transition de l’archipel de Chagos.
Le Matin d’Algérie : Le droit international permet-il de réclamer des réparations financières ou matérielles pour les pertes subies depuis l’expulsion ?
Saïd Larifou : Oui je le répète, il s’agit bel et bien d’une déportation forcée, d’un déracinement imposé et d’une véritable opération d’épuration culturelle. Plus de soixante ans après ce crime contre l’humanité, le peuple chagossien demeure toujours interdit de retour sur ses terres ancestrales.
Conformément au principe de la responsabilité internationale des États, tel que codifié par les articles de la Commission du droit international (2001), le Royaume-Uni a l’obligation de réparer intégralement les préjudices causés. Cette réparation englobe non seulement la compensation des pertes financières, matérielles et culturelles, mais également l’obligation de garantir la non-répétition de telles violations. Cependant, la réparation la plus précieuse serait avant tout la fin du déni de l’existence même du peuple chagossien. Sa pleine reconnaissance sur la scène internationale constituerait un acte de justice historique, la véritable réparation qu’attendent, depuis plus d’un demi-siècle, des générations entières de Chagossiens.
Le Matin d’Algérie : En tant qu’avocat, comment évaluez-vous la protection des droits culturels et identitaires des Chagossiens en exil ?
Saïd Larifou : Ces droits naturels qui existent avant la colonisation britannique sur cet archipel ont été gravement méprisés. Certains, pour des intérêts géopolitiques, tentent de nier leur existence. L’exil a provoqué une perte de repères identitaires, linguistiques et culturels, fragilisant la mémoire collective. Pourtant, le droit international, à travers l’UNESCO et le Pacte international relatif aux droits culturels, impose aux États de préserver la culture des peuples déplacés.
Le Matin d’Algérie : Quelles mesures pourraient être prises pour garantir la préservation de leur langue, culture et mémoire collective ?
Saïd Larifou : Plusieurs mesures concrètes pourraient être envisagées. La première consisterait à créer des programmes éducatifs en langue chagossienne afin de la transmettre aux jeunes générations. La seconde serait de mettre en place un soutien institutionnel à la culture, à la musique et aux traditions orales. La troisième passerait par la création de centres de mémoire et de recherche consacrés à l’histoire chagossienne. Enfin, il serait possible d’intégrer un droit au retour culturel, permettant un lien avec la terre même si le retour physique demeure limité.
Le Matin d’Algérie : Selon vous, quelles seraient les étapes clés pour que le peuple chagossien obtienne justice et reconnaissance de ses droits, à la fois sur le plan juridique et diplomatique ?
Saïd Larifou : La commission d’admission des nouveaux membres des Nations Unies sera saisie pour reconnaitre l’existence du peuple Chagossien et son droit à l’autodétermination. Cette reconnaissance ne dépend pas de l’approbation d’une puissance étrangère ou régionale ce qui reviendrait à accorder aux puissances responsables des crimes un droit de veto, à s’opposer sur le droit INALIÉNABLE du peuple Chagossien à l’autodétermination. Les étapes clés sont multiples et complémentaires. Il convient tout d’abord de consolider la légitimité du GTRAC en tant que représentant politique du peuple chagossien.
Ensuite, il faut multiplier les recours juridiques, qu’il s’agisse de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour pénale internationale ou encore des comités onusiens.
Parallèlement, il est essentiel de renforcer les alliances diplomatiques avec l’Union africaine, les pays du Sud, les forces vives africaines et les pays de l’océan Indien. L’implication de la société civile et des ONG internationales demeure également cruciale pour accentuer la pression.
Enfin, il faut exiger la mise en œuvre effective de l’avis de la CIJ de 2019 et de la résolution 73/295 de la même année, tout en exigeant la révision de l’accord conclu entre Maurice, le Royaume-Uni sur l’avenir de Chagos. Des recours en révision seront introduits devant la Cour de justice internationale, les représentants Chagossiens ont décidé d’intensifier des actions, afin de garantir la restitution de leurs terres, la préservation de leur culture, leur histoire et exercer leur droit à l’autodétermination.
Entretien réalisé par Mourad Benyahia
- Publicité -