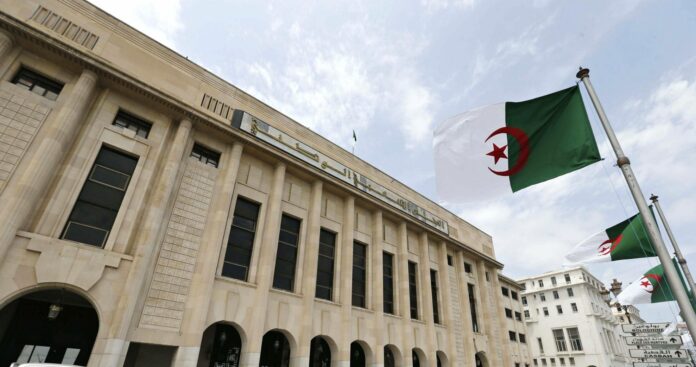Le livre Aurès–Nememcha, témoignages des compagnons de Mustapha Ben Boulaïd, éditions Chihab de Moncef Djenadi restitue la mémoire vivante de la révolution dans la wilaya I, à travers le récit de ceux qui ont vécu les événements de première main.
Né de plusieurs années de rencontres avec les moudjahidine de la première heure, l’ouvrage éclaire le rôle central de Ben Boulaïd et de ses compagnons dans le déclenchement du 1er Novembre 1954 et les combats de l’Aurès–Nememcha, notamment les batailles d’Ifri Leblah, Khengat Maache, Akrich à T’kout, Kimel, Tababoucht et El Djorf.
L’ouvrage a pour objectif de rétablir certaines vérités et de corriger les rumeurs propagées par des personnes malveillantes qui ont terni la glorieuse épopée de Mostefa Ben Boulaïd et de ses valeureux compagnons, tout en rendant hommage aux chouhada et en rappelant l’importance de défendre l’histoire et l’indépendance de l’Algérie. Écrit en français et traduit en arabe à la demande des lecteurs, le livre s’adresse à toutes les générations et entend transmettre une mémoire vivante.
Le Matin d’Algérie : Comment l’idée de ce livre a-t-elle germé en vous, et pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de le publier ?
Moncef Djenadi : L’idée m’est venue très tôt, mais j’ai dû interrompre le projet à cause de la montée du terrorisme à Bouira, où j’ai été engagé pour le combattre. Après ces événements, je n’ai pas pensé à l’édition. À mon retour à la daïra de T’kout, j’ai vécu au quotidien avec les moudjahidine du 1er Novembre, notamment Mostepha Boucetta, surnommé « Amine, le détenteur des secrets », bras droit de Ben Boulaïd. Après ma retraite, j’ai repris complètement mon manuscrit. Comme on dit, à quelque chose malheur est bon : j’ai décidé de l’éditer et de me lancer dans l’écriture, en 1988.
Le Matin d’Algérie : Vous citez plusieurs figures de la Révolution que vous avez côtoyées. Comment avez-vous recueilli et vérifié leurs témoignages ?
Moncef Djenadi : En tant qu’officier d’administration au secteur militaire de Batna, j’ai rencontré la plupart des moudjahidine de la première heure. Ensuite, au cabinet du wali de Batna, le défunt Mohamed Seradj, ces rencontres se sont multipliées. Tout a commencé lors de la commémoration du martyre de Ben Boulaïd, les 22 et 23 mars 1984 : j’ai voulu connaître la vérité sur sa mort. Pour vérifier les informations, j’ai recoupé les témoignages, en interrogeant chaque témoin individuellement sur les mêmes faits.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi avoir centré votre ouvrage sur la région des Aurès–Nememcha, souvent méconnue dans les grands récits de la guerre d’indépendance ?
Moncef Djenadi : L’Aurès–Nememcha constitue le cœur de la Révolution du 1er Novembre. Ben Boulaïd avait pour objectif de tenir dix mois pour permettre aux autres zones de s’organiser. Ce défi a été relevé par les combattants et la population, qui ont résisté à la répression de l’armée française. Si cette région reste méconnue, c’est parce qu’on a voulu qu’elle le soit : l’Aurès n’a pas écrit son histoire, laissant ce vide profiter à d’autres par jalousie ou sectarisme.
Le Matin d’Algérie : Comment décririez-vous le rôle spécifique de Mostefa Ben Boulaïd dans le déclenchement du 1er Novembre 1954 ?
Moncef Djenadi : Ben Boulaïd a été le véritable artisan du soulèvement. Né dans une région indomptable, marquée par des insurrections successives depuis le XIXe siècle, il a milité très tôt pour l’indépendance par les armes. Il a fondé l’Organisation Spéciale en 1947 et, après son démantèlement en 1950, a su préserver sa structure par le secret et le cloisonnement. Il a financé les armes avec ses propres moyens et choisi les hommes qui allaient constituer son armée. Sans lui, le 1er Novembre n’aurait pas été possible.
Le Matin d’Algérie : Vous consacrez un chapitre aux batailles de la région. Que symbolisent-elles dans l’histoire de la lutte armée ?
Moncef Djenadi : Ces batailles sont essentielles pour comprendre la résistance dans l’Aurès–Nememcha. La bataille d’Ifri Leblah a duré trois jours avec des accrochages à Ifri Leblah, Sakiet Cheurfa et Hmarkhadou. Khengat Maache, Akrich à T’kout, Kimel et Tababoucht montrent l’héroïsme des combattants de l’ALN face à un ennemi supérieur en nombre et en armement. À Akrich, plus de 150 soldats français ont été tués par seulement 6 combattants de l’ALN. La bataille d’El Djorf, en septembre 1955, est encore plus marquante. Encerclés par plus de 30 000 soldats français, 300 combattants de l’ALN, dirigés par Abbas Laghrour, Adjel Adjoul, Sidi Hani Louardi, Guetal et d’autres, ont infligé de lourdes pertes à l’ennemi : 700 tués, 450 blessés, 3 avions abattus et 3 chars détruits. Du côté de l’ALN, 75 chouhadas et un blessé. Cette bataille est étudiée à ce jour à l’école prestigieuse de Saint-Cyr et est considérée comme la mère des batailles de l’ALN.*
Le Matin d’Algérie : Quel témoignage vous a le plus bouleversé ou marqué parmi ceux recueillis ?
Moncef Djenadi : Les récits des hommes et femmes qui ont choisi la mort plutôt que la capture sont bouleversants. Ces sacrifices, comme celui de Zerouali Amria, montrent l’extrême courage des moudjahidine et donnent un visage humain à la lutte, rappelant le prix de notre indépendance.
Le Matin d’Algérie : Pourquoi avoir choisi d’écrire en français ?
Moncef Djenadi : Ce choix n’est pas politique. C’est avant tout pédagogique et personnel. Mes études, du primaire à l’université, se sont déroulées en français, que je maîtrise parfaitement. Cela permet de toucher un public plus large et d’assurer la rigueur du récit.
Le Matin d’Algérie : Avez-vous hésité à mêler récit historique et témoignages personnels ?
Moncef Djenadi : Non. L’écriture de l’histoire repose sur les archives et les témoignages de ceux qui ont vécu les événements. J’ai vécu avec les moudjahidine de la première heure et j’ai pu rapporter le bon comme le mauvais. Il était essentiel de raconter l’histoire avec objectivité, en donnant vie aux personnages et en rappelant leurs exploits, comme ceux d’Abbas Laghrour, surnommé « le général », traqué par des parachutistes et des légionnaires.
Le Matin d’Algérie : Quel public espérez-vous toucher à travers ce livre ?
Moncef Djenadi : Tous les Algériens, sans limite d’âge, mais surtout les jeunes. Ils doivent connaître et défendre l’histoire de leur pays pour qu’il ne redevienne jamais colonisable. Ce livre est ma modeste pierre à l’édifice de notre mémoire collective, pour honorer nos chouhada et rétablir la vérité sur la glorieuse épopée de Mostefa Ben Boulaïd et ses compagnons.
Le Matin d’Algérie : La traduction vers l’arabe est en cours : que représente cette étape pour vous ?
Moncef Djenadi : La traduction est déjà disponible sur le marché, réalisée à la demande des lecteurs. Elle permet de toucher un public plus large, notamment les jeunes, et de transmettre cette mémoire dans leur langue.
Le Matin d’Algérie : Comment percevez-vous aujourd’hui la mémoire de la guerre d’indépendance en Algérie ?
Moncef Djenadi : Mi-figue, mi-raisin. Il y a du mieux ces cinq dernières années, mais le problème reste la diffusion et la réglementation. Les auteurs perçoivent très peu : pour un ouvrage vendu 1 200 dinars, l’auteur reçoit seulement 120 dinars. Les médias privilégient la poésie ou le roman plutôt que l’histoire. Beaucoup de jeunes ignorent les grandes figures de 1954. Il faut enseigner cette histoire à tous les niveaux et dans les médias, pour qu’elle soit vivante et non seulement commémorative.
Le Matin d’Algérie : En tant qu’ancien cadre de l’administration, pensez-vous que l’État fasse assez pour valoriser ces mémoires locales et ces héros méconnus ?
Moncef Djenadi : Des efforts existent, mais ils restent insuffisants. La mémoire nationale doit être un travail quotidien, partagé entre les ministères des moudjahidine, de la culture, de l’éducation et de l’information. Il faut revoir les programmes scolaires, impliquer les élèves dans les commémorations, créer des concours, et ajuster même les dates de vacances pour permettre la participation directe. La mémoire nationale doit rester vivante.
Le Matin d’Algérie : Si vous aviez la possibilité de vous adresser une dernière fois à Mostefa Ben Boulaïd, que lui diriez-vous ?
Moncef Djenadi : Père de la Révolution, votre nom incarne le courage et le don total. Vous avez placé vos biens, vos convictions et votre existence entière au service de l’indépendance de notre peuple. Mon admiration est sans limite. J’aurais voulu naître à votre époque pour combattre à vos côtés et partager votre destin. Aujourd’hui, je vous rends hommage par ces pages : ce livre est mon acte de reconnaissance pour votre combat et votre sacrifice. Tant qu’il restera un souffle en nous, avec mes compatriotes, nous défendrons l’Algérie et sa mémoire jusqu’à la dernière goutte de notre sang.
Entretien réalisé par Djamal Guettala
Brève biographie de l’auteur
Moncef Djenadi, ancien chef de daïra de T’kout dans les années 1990 et officier de réserve, a consacré plusieurs années à recueillir les témoignages des moudjahidine de la première heure de la région des Aurès–Nememcha. Son ouvrage Aurès–Nememcha, témoignages des compagnons de Mustapha Ben Boulaïd a été publié en français aux éditions Chihab en 2021 et traduit récemment en arabe. Il a voulu rétablir certaines vérités et corriger les rumeurs malveillantes qui ont terni l’épopée de Mostefa Ben Boulaïd et de ses compagnons.
- Publicité -