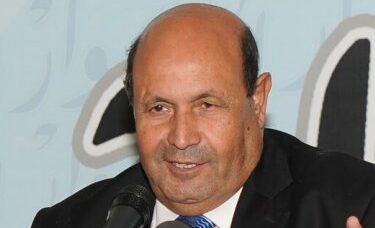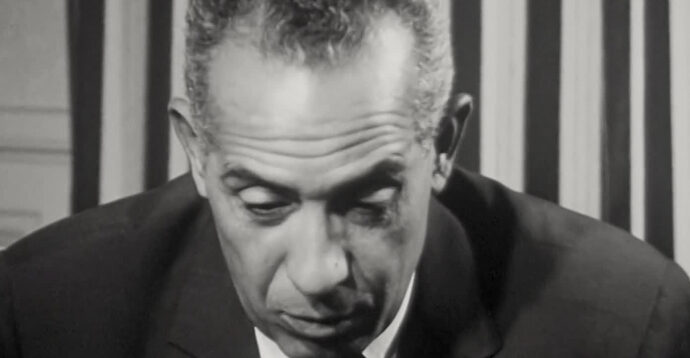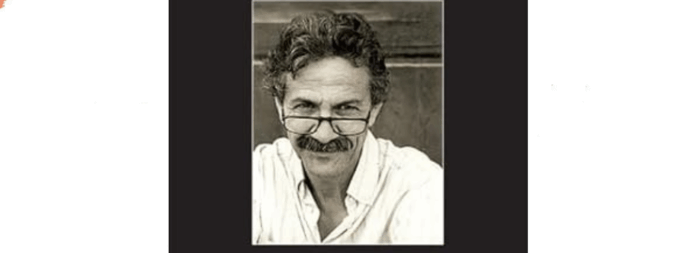Le conseil d’administration de la célèbre université parisienne a voté lundi 1er décembre en faveur d’une augmentation des frais d’inscription de certains étudiants étrangers extra-communautaires. La mesure est contestée par une partie des étudiants et des enseignants.
Le vote a eu beau être serré – 18 voix pour, 15 voix contre et trois abstentions -, le résultat s’annonce radical. Dès la rentrée 2026, certains étudiants étrangers paieront plus cher leurs frais d’inscription à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. La mesure concerne tous les étudiants étrangers, sauf les ressortissants des pays membres de l’Union européenne, les étudiants en exil et ceux provenant de 44 pays définis par l’Organisation des Nations unies (ONU) comme les « moins avancés ».
Une large majorité de ces pays se situent en Afrique. Ainsi, les étudiants issus du Sénégal, de la République centrafricaine (RCA), de la République démocratique du Congo (RDC) ou de Madagascar continueront à bénéficier des mêmes tarifs que les étudiants français. En revanche, d’autres États, notamment africains, ne figurent pas sur la liste établie par l’ONU, comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l’Égypte. Leurs étudiants seront concernés par la hausse des frais d’inscription : à la rentrée 2026, ils devront débourser 2 900 euros pour une inscription en licence, contre 180 euros actuellement, et près de 4 000 euros pour une inscription en master, contre 250 euros aujourd’hui.
Difficultés budgétaires
Sollicité par RFI, l’établissement parisien justifie cette hausse par la dégradation de sa situation budgétaire : « L’université subit depuis plusieurs années les effets de décisions prises par l’État, pour certaines nécessaires dans l’intérêt des agents de l’établissement, mais qui n’ont été que partiellement ou pas compensées financièrement par l’État. » En déficit, l’université a été sommée par le rectorat de réaliser un plan d’économies de 13 millions d’euros d’ici à la fin de l’année.
Un contexte similaire à celui que connaissent d’autres établissements supérieurs en France. Depuis le début de l’année, plusieurs responsables d’universités alertent sur leurs difficultés budgétaires. Les trois quarts d’entre elles seraient en déficit. Et si le projet de financement de l’enseignement supérieur pour l’année 2026 prévoit une rallonge de 175 millions d’euros, celle-ci ne permettra pas de compenser la hausse de l’inflation, estime la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture, affiliée au syndicat CGT, dans un communiqué.
« Les universités sont à l’os », admet auprès de RFI Marie-Emmanuelle Pommerolle, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. « Notre université a stoppé 90 % de ses investissements dans la documentation, nous n’achetons plus de livres. » Pour autant, faire payer davantage les étudiants extra-communautaires n’est pas la solution, estime cette professeure, qui juge la mesure discriminatoire : « Cette différenciation selon l’origine est inacceptable, d’autant que ces étudiants auront les mêmes conditions de travail et d’enseignement que leurs camarades qui auront payé leur année pour quelques dizaines d’euros. »
Conséquences « catastrophiques »
Plusieurs enseignants – dont Marie-Emmanuelle Pommerolle – et étudiants de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne contestent la mesure. Ils sont une centaine à avoir signé une lettre ouverte adressée à la présidente de l’université, Christine Neau-Leduc. Ces derniers redoutent les conséquences « catastrophiques » d’une mesure qui précariserait davantage ces étudiants étrangers déjà confrontés à des difficultés économiques et administratives : « Certains ont des difficultés à réunir le budget pour venir en France, d’autres font face à des restrictions d’accès aux visas ou patientent des jours avant d’obtenir un titre de séjour. Cette hausse ne va rien arranger », cingle Marie-Emmanuelle Pommerolle.
Une autre difficulté pourrait noircir le tableau : le projet de loi de finances 2026 prévoit, en l’état, la suppression des aides personnelles au logement (APL) pour les étudiants extracommunautaires non boursiers. Ce coup de pouce de quelques centaines d’euros permet aux étudiants les plus précaires de se loger décemment.
Mis bout à bout, ces obstacles pourraient, à terme, décourager certains étudiants étrangers de venir réaliser leurs études en France, estime Marie-Emmanuelle Pommerolle, qui dit craindre pour l’attractivité des universités françaises : « Il se peut qu’on ne voie plus ces étudiants, car ils se dirigeront vers d’autres pays. Et c’est déjà le cas : lorsque je me rends dans certaines universités africaines, je constate que les destinations privilégiées par ces étudiants, c’est la Turquie, la Chine, la Russie et très peu la France. »
Un millier d’étudiants visés par la hausse des frais d’inscription
L’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, prestigieuse université de sciences humaines et sociales, accompagne 45 000 étudiants à l’année. Environ un millier d’entre eux seraient visés par la hausse des frais d’inscription, en majorité des étudiants marocains, algériens, chinois, égyptiens et tunisiens, qui représentent les plus gros contingents d’étudiants extracommunautaires au sein de l’université.
Cette possibilité de différencier les droits d’inscription a été ouverte par la stratégie « Bienvenue en France », mise en place en 2019 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Mais nombre d’universités, dont Paris-1 Panthéon-Sorbonne, ne l’avaient jusque-là pas adoptée, jugeant la mesure discriminatoire. De son côté, France Universités, qui rassemble les dirigeants des universités françaises, avait également émis des réserves à ce sujet, craignant que ces frais d’inscription différenciés ne créent d’importants obstacles financiers pour les étudiants des pays les plus vulnérables.
Depuis 2019, une dizaine d’universités en France se sont finalement résolues à établir des frais d’inscription différenciés selon l’origine des étudiants. Celle de Paris-1 Panthéon-Sorbonne « espère revenir sur cette décision dès qu’elle aura retrouvé une situation budgétaire plus stable ».
Frais d’admission à l’université : que font nos voisins européens ?
En Europe, la France est loin d’être une exception sur ce sujet si l’on en croit les dernières données issues d’une étude comparative réalisée par la Commission européenne entre 2020 et 2021. Dans les trois quarts des systèmes d’enseignement supérieur européens étudiés, les universités peuvent facturer des droits d’inscription plus élevés aux étudiants non ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. L’Allemagne, l’Italie et la République tchèque font figure d’exception.
Dans les autres États européens, ces frais peuvent varier sensiblement d’une université à l’autre au sein d’un même pays : « Le plus souvent, les frais applicables aux étudiants internationaux ne sont pas réglementés […] les établissements d’enseignement supérieur peuvent fixer leurs propres barèmes pour cette catégorie d’apprenants », pointent les auteurs de l’étude.
L’Autriche déroge quelque peu à cette règle. Le barème est fixe : les étudiants internationaux doivent débourser 1 500 euros par an pour une année universitaire dans une université du pays. Comme en France, les étudiants des pays les plus vulnérables sont exemptés de coûts supérieurs à ceux des étudiants nationaux.
À Chypre, le montant des études pour les étudiants non européens compte parmi les plus élevés du continent. Pour un cursus à temps plein de premier cycle, ils peuvent débourser jusqu’à 7 000 euros par année universitaire et jusqu’à 11 500 euros pour un cursus à temps plein de deuxième cycle.
Enfin, en Slovénie, les étudiants extracommunautaires de pays ayant signé des accords bilatéraux en matière de coopération pédagogique paient des frais identiques à ceux des citoyens slovènes, souligne l’étude. Les autres étudiants internationaux paient des frais de scolarité plus élevés.
RFI