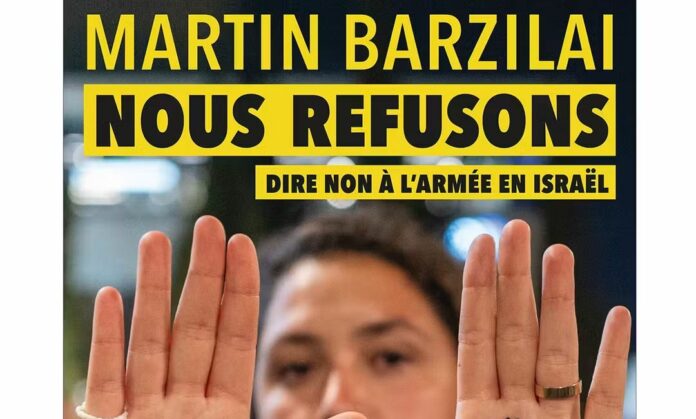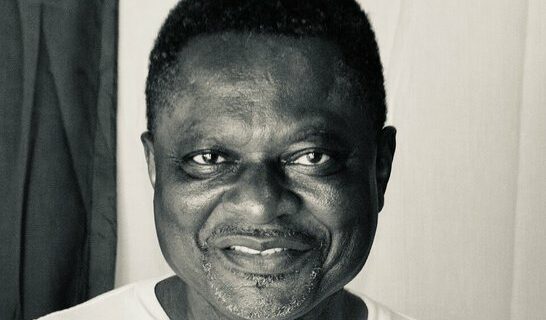La scène médiatique tunisienne connaît une nouvelle secousse. À l’appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), un rassemblement est organisé ce mardi devant la Cour d’appel de Tunis pour soutenir la journaliste Chadha Hadj Mbarek, condamnée en première instance à cinq ans de prison dans l’affaire Instalingo. Une affaire devenue, pour beaucoup, le symbole d’un climat répressif visant la presse indépendante.
Un rendez-vous de solidarité qui dépasse la corporation
Le SNJT a choisi un moment clé : l’examen du dossier en appel. Dès 9h30, journalistes, militants des droits humains, syndicalistes, mais aussi simples citoyens, sont appelés à se rassembler pour exiger la libération immédiate de Chadha Hadj Mbarek et l’abandon des charges qui pèsent sur elle.
Pour le syndicat, l’enjeu dépasse le cas individuel : « La condamnation de notre collègue relève d’une instrumentalisation de la justice pour faire taire les voix professionnelles critiques », affirme l’organisation.
Selon le SNJT, le travail de Hadj Mbarek au sein de la société de production Instalingo appartient entièrement à l’activité journalistique, loin des accusations de complot, d’atteinte à la sécurité de l’État ou de diffusion de fausses nouvelles avancées par les autorités.
L’affaire Instalingo, turning point d’une dérive autoritaire
Depuis plus de deux ans, l’affaire Instalingo polarise la société tunisienne. Plusieurs journalistes, blogueurs, influenceurs, avocats et personnalités publiques y ont été arrêtés ou poursuivis.
Pour les défenseurs des libertés, ce dossier s’est progressivement transformé en machine judiciaire visant à intimider les voix dissidentes.
La condamnation de Chadha Hadj Mbarek en février 2025 avait suscité une vague d’indignation nationale et internationale. La Fédération internationale des journalistes (FIJ), Reporters sans frontières (RSF) et de nombreuses ONG ont dénoncé « une répression sans précédent depuis 2011 », pointant particulièrement l’usage du controversé décret-loi 54, souvent mobilisé pour sanctionner des contenus jugés critiques envers les autorités.
Une justice sous pression, une profession en première ligne
Le rassemblement annoncé traduit un malaise profond : la crainte d’un recul durable de la liberté de la presse en Tunisie, pays longtemps considéré comme l’un des rares espaces médiatiques pluralistes de la région.
Les journalistes tunisiens sont désormais confrontés à un double danger : la judiciarisation du travail journalistique et la criminalisation de la critique politique.
Dans ce contexte, la mobilisation du SNJT apparaît comme une tentative de défendre les derniers espaces d’expression encore ouverts. « Le procès de Chadha est aussi le procès de notre métier », affirment plusieurs journalistes tunisiens engagés dans la campagne de solidarité.
Un appel qui résonne au-delà de la Tunisie
L’affaire Chadha Hadj Mbarek trouve un écho particulier en Algérie, où les questions de liberté d’expression et de protection des journalistes restent sensibles.
Pour les observateurs algériens, la situation tunisienne illustre l’urgence de défendre les droits fondamentaux dans la région et de rester solidaires des professionnels visés pour leur travail d’information.
Ce qui se joue aujourd’hui à Tunis
Le rassemblement de ce mardi ne changera peut-être pas à lui seul l’issue judiciaire du dossier. Mais il rappelle une chose : la liberté de la presse, en Tunisie comme ailleurs, demeure un fragile équilibre, constamment menacé.
Pour le SNJT et ses partenaires, la bataille pour Chadha Hadj Mbarek est aussi celle pour l’avenir de toute une profession — et, au-delà, pour le droit du public à être informé librement.
Mourad Benyahia