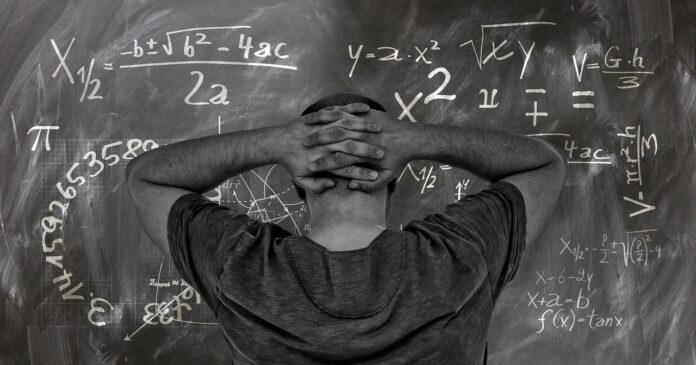L’Algérie a rendu son dernier hommage à Baya Bouzar, plus connue sous son nom de scène Biyouna, décédée la veille à l’âge de 73 ans des suites d’une longue maladie.
Les cérémonies, empreintes de sobriété et d’une profonde émotion, ont marqué le départ d’une figure singulière et audacieuse qui a profondément influencé la culture et le théâtre national.
La dernière scène au TNA
La matinée du mercredi 26 novembre a débuté par un recueillement public au Théâtre National Algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi à Alger. Ce lieu symbolique, cœur battant de la création théâtrale, a servi de dernière scène à l’artiste, conformément aux vœux de ses proches.
Dès 11h00, une foule d’admirateurs, de personnalités du monde des arts, de la culture et de représentants officiels se sont succédé devant la dépouille. L’hommage au TNA a symbolisé la reconnaissance de la nation à celle qui avait fait rire et pleurer des générations de spectateurs, non seulement en Algérie mais aussi à l’étranger, grâce à une carrière prolifique qui l’a menée du cinéma algérien aux productions internationales.
Une vague d’hommages unanime
Les jours précédant l’inhumation ont été marqués par une vague d’hommages unanime, saluant la liberté de ton et l’esprit rebelle de Biyouna. De nombreux acteurs culturels et politiques ont souligné son rôle d’émancipatrice et de modèle.
Le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa « profonde affliction » et rendu hommage à une « célébrité de la scène culturelle », soulignant sa contribution au cinéma, au théâtre et à la télévision. Son message de condoléances, largement relayé par les médias publics, a inscrit Biyouna dans le registre des icônes culturelles nationales, reconnaissant le « vide immense » laissé par son départ.
En France, la ministre de la Culture Rachida Dati a salué une artiste « de toutes les scènes et de tous les registres », rappelant son influence au-delà des frontières algériennes.
Des artistes ont insisté sur la sincérité et l’audace de l’actrice, souvent perçue comme une porte-voix des femmes et une critique sociale sous-jacente à ses rôles comiques.
Son héritage a été défini par la dualité de son parcours : profondément enracinée dans la culture algérienne (avec des rôles cultes comme El Harik) tout en rayonnant sur la scène internationale (Le Flic de Belleville, La Source des femmes).
Le dernier repos à El-Alia
En début d’après-midi, le corps de Biyouna a été conduit au cimetière d’El-Alia, l’un des plus grands et des plus importants cimetières d’Alger, où reposent de nombreuses personnalités nationales.
Après la prière du Dohr, la cérémonie d’inhumation s’est déroulée dans une atmosphère de dignité et de recueillement. L’affluence témoigne de l’attachement profond et populaire à cette artiste qui, par sa présence scénique unique et son authenticité, est devenue un symbole de l’identité algérienne moderne
Le départ de Biyouna laisse un héritage culturel riche et complexe, celui d’une femme qui a toujours refusé les carcans, utilisant l’art pour exprimer une vérité souvent dérangeante mais toujours accueillie avec affection par son public.
Biyouna, symbole de résilience face à l’hostilité idéologique des islamistes
La disparition de Biyouna (Baya Bouzar), l’artiste et la femme, a ravivé un clivage ancien entre reconnaissance populaire et institutionnelle, et hostilité idéologique. Figure majeure de la scène artistique maghrébine, elle a été saluée par les autorités algériennes et françaises, tandis qu’une partie des courants conservateurs a réactivé les critiques qui ont jalonné sa carrière.
Ces hommages unanimes contrastent avec les tensions qui ont marqué son parcours. Biyouna évoquait régulièrement le regard méfiant de certains milieux politiques ou intellectuels, qui la jugeaient « trop populaire, trop franche, trop algéroise ». Cette perception a façonné la réception parfois ambivalente de son œuvre.
Malgré l’hommage populaire qui a accompagné ses funérailles au Théâtre national algérien et son inhumation au cimetière d’El-Alia, des voix conservatrices ont profité de l’annonce de son décès pour relancer les attaques. Pour ces militants islamistes ou rigoristes, la comédienne incarnait un modèle de femme jugé incompatible avec leurs références morales : libre, directe, décomplexée.
Ses rôles dans les films de Nadir Moknèche — notamment Le Harem de Madame Osmane et Viva Laldjérie —, où elle incarnait des femmes modernes et transgressives, demeurent des cibles récurrentes des polémiques. Ses prises de position, sa sensualité assumée et son humour sans détour symbolisaient, pour certains, une remise en cause frontale des normes sociales et religieuses.
Pour une grande partie du public, au contraire, Biyouna reste l’incarnation d’une parole affranchie et d’une résistance artistique forgée pendant la « décennie noire », période durant laquelle plusieurs artistes avaient été menacés.
Sa mort, saluée par les institutions mais contestée par les franges conservatrices, révèle une fracture culturelle toujours active en Algérie : celle entre une culture populaire revendiquant liberté et irrévérence, et des courants idéologiques, se revendiquant de l’islam rigoriste qui continuent d’en contester la légitimité.
Samia Naït Iqbal