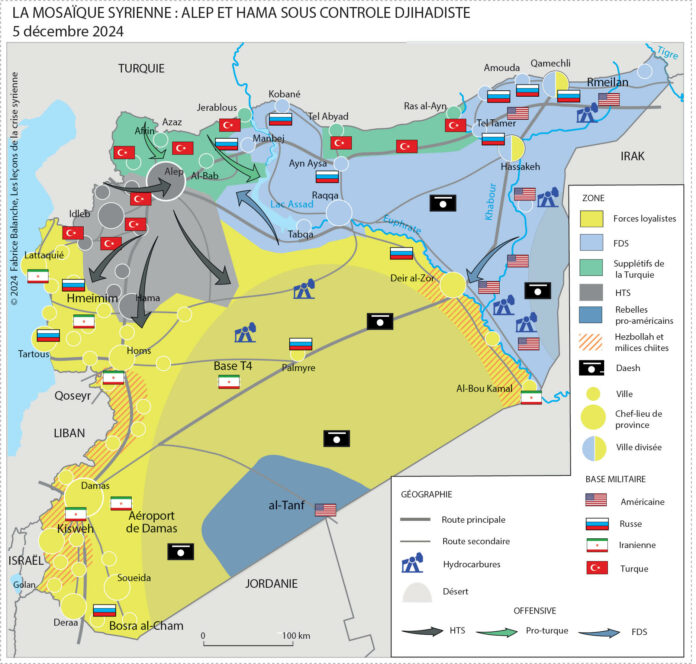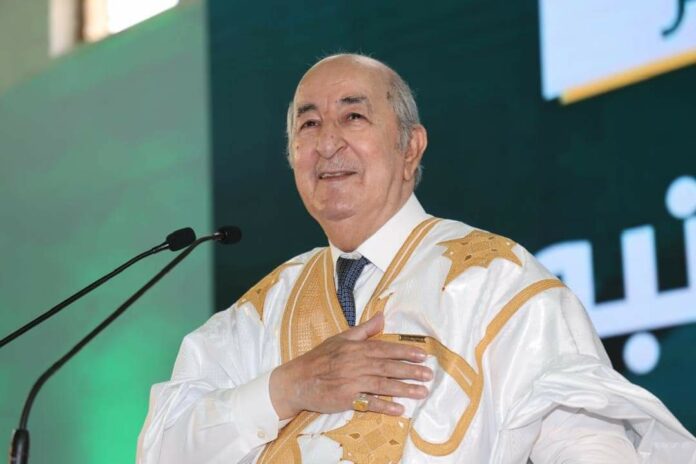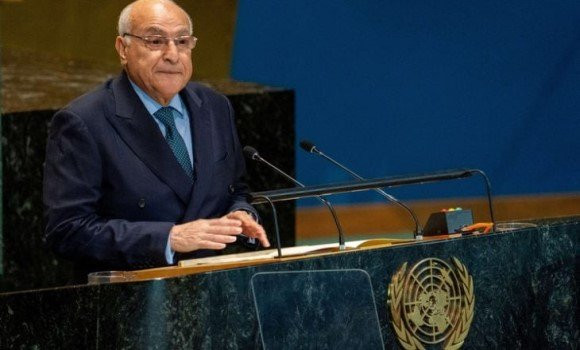De Paris à Alger, des palais d’apparat dominent des républiques où le pouvoir semble bien plus concentré qu’il n’y paraît. L’Élysée en France, El Mouradia en Algérie : deux lieux symboles d’une république moderne et démocratique. Mais derrière leurs murs, la réalité prend des accents de monarchie.
Dans ces deux capitales, les institutions démocratiques peinent à exister face à des chefs d’État qui, chacun à leur manière, incarnent la tentation de tout contrôler.
L’Élysée, trône républicain
En France, Emmanuel Macron, surnommé Jupiter, a redéfini les contours de la Ve République. Initialement pensée pour un président arbitre, la Constitution s’est transformée, au fil des mandats, en une mécanique où l’exécutif règne en maître. Macron en a fait un art : ordonnances, centralisation, et mépris à peine voilé pour un Parlement qu’il considère comme un obstacle plus qu’un partenaire.
Le dernier épisode, marqué par la chute du gouvernement Barnier après une motion de censure historique, illustre ce déséquilibre. Le Parlement a parlé, et pourtant, rien n’a changé. Macron reste, impassible, presque sanctifié par un système qu’il domine. Comme dans une tragédie classique, les seconds rôles tombent pour préserver la stature du héros principal. La république, ici, ressemble davantage à un décor soigneusement entretenu qu’à un espace de réel partage du pouvoir.
El Mouradia : un système à façade
En Algérie, El Mouradia est un lieu où le pouvoir se masque sous des allures de république depuis des décennies. Depuis l’indépendance, le pays a oscillé entre autoritarisme assumé et illusion démocratique. Le président Tebboune, comme ses prédécesseurs, occupe une fonction à la fois symbolique et stratégique, dans un système où les vrais leviers sont souvent ailleurs : dans l’armée, les cercles de pouvoir informels, et les réseaux économiques opaques.
La révolte du Hirak en 2019 a pourtant soulevé un espoir : celui d’un renouveau, d’un véritable passage de l’apparence à la réalité démocratique. Mais quatre ans après, les Algériens constatent que la façade reste intacte. Les élections se succèdent, les discours changent, mais les structures du pouvoir demeurent immuables. À El Mouradia comme à l’Élysée, la république semble plus un prétexte qu’une promesse.
Les institutions : entre ombre et lumière
Le point commun entre ces deux systèmes réside dans le rôle des institutions. En théorie, elles incarnent la démocratie, le partage du pouvoir et le contrepoids à l’autorité exécutive. En pratique, elles sont souvent réduites à des instruments pour légitimer les décisions prises ailleurs.
En France, le Parlement, fragmenté et affaibli, peine à s’imposer face à un président omnipotent. La motion de censure contre le gouvernement Barnier aurait pu marquer un tournant. Au lieu de cela, elle s’est heurtée à une Constitution qui protège le président à tout prix.
En Algérie, les institutions fonctionnent comme une vitrine. Elles existent, mais leur impact réel est limité par une concentration du pouvoir dans les sphères informelles. Le peuple, pourtant acteur principal du Hirak, reste en marge des décisions qui orientent son destin.
Même décor, mêmes illusions
Ce parallèle entre l’Élysée et El Mouradia met en lumière une vérité troublante : quand les républiques se réduisent à des décors, elles perdent leur essence. Elles deviennent des outils pour maintenir un système qui ne vit que pour lui-même, au lieu de servir ceux qu’il prétend représenter.
Les illusions d’une république parfaite, d’un président au service du peuple et d’institutions fortes, s’effacent des deux côtés de la Méditerranée. Ce qui reste, c’est un sentiment croissant de déconnexion entre les citoyens et leurs gouvernants. En France comme en Algérie, les révoltes, qu’elles prennent la forme d’un Hirak ou d’une motion de censure, ne suffisent plus à restaurer une véritable démocratie.
Et après ?
La question qui se pose est universelle : combien de temps un décor peut-il tenir avant de s’effondrer ? Dans une république, les institutions ne sont pas là pour faire joli ; elles sont là pour fonctionner. Si elles ne remplissent plus leur rôle, si elles ne protègent plus la voix du peuple, alors elles deviennent obsolètes.
Entre l’Élysée et El Mouradia, le parallèle est audacieux, mais il pointe une vérité essentielle : la démocratie ne se nourrit pas de symboles, mais de pratiques réelles. Et tant que ces pratiques seront éclipsées par la concentration du pouvoir, les républiques, qu’elles soient au nord ou au sud de la Méditerranée, risquent de n’être qu’un jeu d’ombres et de lumières, sans substance.
Le miroir des illusions : la république en crise de confiance
La question centrale qui émerge de cette analyse, c’est celle de la légitimité. Dans deux républiques qui se veulent démocratiques, la légitimité ne repose plus sur la capacité des institutions à représenter le peuple, mais sur la force de la concentration du pouvoir entre les mains d’un petit nombre. Que ce soit Emmanuel Macron à l’Élysée ou Abdelmadjid Tebboune à El Mouradia, la véritable question est : qui détient le pouvoir réel ?
Si le peuple est l’architecte théorique de la république, il semble souvent n’être que spectateur des grandes manœuvres politiques. Le système électoral, les institutions, tout cela semble exister davantage pour légitimer un pouvoir préexistant que pour en construire un véritableement démocratique. On peut alors se demander si le peuple est toujours le souverain, ou s’il n’est plus qu’un figurant dans une pièce dont il ne contrôle plus le script.
La centralisation du pouvoir : symptôme d’une démocratie malade
Le constat est amer, mais nécessaire : dans ces deux républiques, la centralisation du pouvoir est le symptôme d’une démocratie malade. Ce n’est plus un partage du pouvoir entre les différentes branches de l’État, mais une course à l’accumulation d’une toute-puissante présidence. Cette concentration exacerbe la tension entre l’État et les citoyens, et bien souvent, les révoltes qui en résultent sont comme des appels à un changement de décor. Mais à chaque fois, la machine politique semble ne jamais se fissurer réellement.
En Algérie, ce phénomène est exacerbé par l’histoire du pays : une indépendance acquise dans la lutte, mais une gestion politique restée captive des héritages du pouvoir militaire. Le pouvoir n’a jamais totalement quitté les coulisses, même après la chute de Bouteflika. Le Hirak, pourtant puissant, n’a pas suffi à déraciner un système aussi solidement ancré dans les rouages de l’État.
À l’Élysée, la France semble avoir pris un tournant similaire. Le président n’est plus seulement un arbitre : il est devenu un acteur omniprésent, l’alpha et l’oméga de la politique nationale. Et tout cela, dans une république censée être le modèle de la séparation des pouvoirs.
La révolution de l’indifférence
Ce qui est encore plus préoccupant dans cette dérive, c’est le désenchantement populaire. Loin de la scène des grandes révolutions, où le peuple se lève pour renverser un régime, nous assistons à une forme de révolution de l’indifférence.
L’indifférence des citoyens face à des institutions qu’ils jugent inefficaces et déconnectées de leurs préoccupations quotidiennes. L’indifférence des électeurs, désillusionnés par des promesses de renouvellement qui ne se réalisent jamais.
Que ce soit en France, où la popularité de Macron, après des années de réformes contestées, s’effrite, ou en Algérie, où le Hirak s’essouffle malgré son immense mobilisation, il est clair que la fracture entre le peuple et ses dirigeants ne cesse de se creuser. Et dans ce contexte, une question essentielle demeure : qui représente vraiment le peuple ?
Le défi démocratique : restaurer la confiance ou sombrer dans l’illusion ?
À la croisée des chemins, la France et l’Algérie se trouvent face à un même défi : celui de redonner du sens à la démocratie. Celle-ci ne peut exister sans une véritable séparation des pouvoirs, sans une volonté politique de déconcentrer la prise de décision, de rendre l’élu responsable devant les citoyens, et non plus devant une élite restreinte. Les républiques, qu’elles soient françaises ou algériennes, ont tout à perdre si elles continuent à se limiter à un décor de façade.
La véritable réforme, celle qui réconciliera les peuples avec leurs institutions, devra passer par une transformation radicale des rapports entre l’État et les citoyens. Il ne suffit pas d’élire un président, il faut lui rendre le pouvoir de gouverner en collaboration avec un Parlement véritablement indépendant. Une république ne peut être un simple décor, ni un espace où se jouent des stratégies de pouvoir. Elle doit être un lieu où l’exercice du pouvoir s’effectue au service du peuple, et non contre lui.
Un appel à la refondation
Le défi est grand, mais il est aussi une chance. France et Algérie, malgré leurs divergences historiques et culturelles, peuvent tirer les leçons de leurs crises actuelles pour imaginer une démocratie qui, enfin, soit véritablement partagée. Cette république-là ne sera ni une illusion ni un décor. Elle sera, espérons-le, une réalité vécue par ceux qu’elle est censée servir : le peuple.
Les révoltes, petites ou grandes, les motions de censure, les manifestations populaires, sont autant de signes avant-coureurs d’une république en quête de sens. Il appartient aux dirigeants de saisir ce moment pour remettre en question un système devenu obsolète. La démocratie, c’est l’art de partager le pouvoir, et non de le concentrer. Si la France et l’Algérie veulent renaître démocratiquement, elles devront regarder au-delà du décor et remettre au cœur de l’État ce qui a fait leur raison d’être : le peuple.
« La démocratie, c’est l’art de partager le pouvoir ; la monarchie, c’est l’art de le concentrer. » Cette citation illustre parfaitement la dynamique à l’œuvre dans les républiques contemporaines comme la France et l’Algérie, où le pouvoir semble être de plus en plus concentré entre les mains de quelques-uns, et où les institutions démocratiques apparaissent comme de simples façades. Elle met en lumière la tension fondamentale entre un idéal démocratique de partage du pouvoir et une réalité politique où le pouvoir est souvent monopolisé, affaiblissant ainsi la véritable nature républicaine des systèmes.
Dr A. Boumezrag