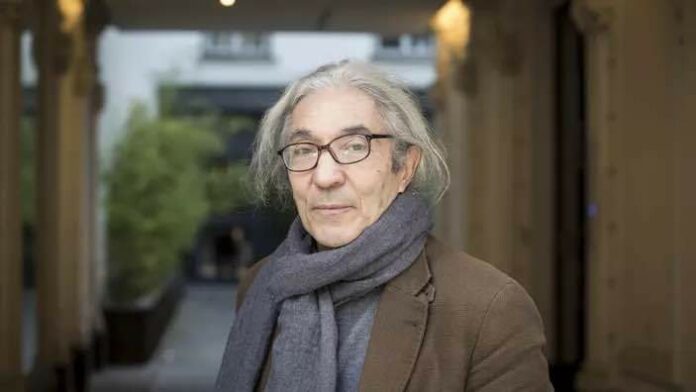Ah, l’Algérie ! Terre d’accueil, de chaleur humaine, et apparemment d’oubli sélectif. Voilà qu’à Rahmania, dans la banlieue d’Alger, des travailleurs africains ont eu l’audace… de manifester leur colère. Oui, vous avez bien entendu : une colère.
Imaginez la scène. Ces ouvriers, venus d’Afrique, qui ont sué sang et eau pour construire des logements AADL, logés dans des abris de fortune, sous-payés (quand ils sont payés), et maltraités par des promoteurs, se permettent de sortir dans la rue. Pas pour une promenade, non. Pour réclamer leurs soldes. Oui, leurs salaires. Et pourquoi pas, tant qu’on y est, des papiers. Rien que ça. Un semblant de dignité. Quelle audace, franchement !
Leur protestation a bloqué un chantier important. Et dans ces cas-là, que fait-on ? On négocie ? On cherche des solutions ? Pas du tout. On appelle les autorités pour “rétablir l’ordre”. Et l’ordre a répondu : des forces anti-émeutes à la hauteur de l’affront. Arrestations massives, bus réquisitionnés… direction le Sud. Pas pour les remercier, bien sûr. Non, juste pour les expulser vers les frontières.
Ces gens-là, après avoir trimé sous notre soleil, mangé notre poussière, et construit nos logements, se permettent de vouloir… y habiter, s’y enraciner, et pourquoi pas, y bâtir leur avenir. Ils se voient déjà y vivre, fonder des familles, élever leurs enfants dans ces mêmes logements qu’ils ont eux-mêmes construits. Quelle audace, franchement ! Vous imaginez ? Ils resteraient, pour de bon. Pas juste des passants, mais des habitants. Bref, ils osent exister.
Imaginez un peu la scène, telle qu’on voudrait la planter dans la tête de l’Algérien (avec l’intox qui va bien) : ils débarquent en masse, s’installent confortablement dans nos logements, prennent nos espaces, et s’organisent pour rester. Ils occupent, ils revendiquent, ils changent la donne. Et ce n’est pas tout ! Ils font des enfants, beaucoup d’enfants.
Des enfants qui, dans cette imagination débridée, deviennent plus nombreux que les nôtres. Et pire encore, ces enfants grandissent, se mêlent à nos familles. Peut-être même qu’ils se marieront avec nos filles ! Oui, nos filles (parce que nos hommes qui se marient ailleurs, ça, évidemment, c’est tout à fait différent, bien sûr)
Un comble, vous ne trouvez pas ?
Et là, le chaos imaginaire s’emballe. Ils envahissent. Ils menacent. Ils déstabilisent ce qu’on appelle pompeusement notre “patrimoine génétique”. L’Algérien blanc, ça va. Brun “elqahwi”, passe encore. Mais noir “lazreg” ou, pire encore, “kahlouche” ? Là, c’est trop. Beaucoup trop. Ce n’est plus une menace, c’est une apocalypse en construction. Une intox savamment distillée qui, bien sûr, fait son chemin. Soyons sérieux, tout de même. On a un patrimoine impeccable à défendre, non ?
Et là, un doute nous saisit : sommes-nous toujours ces Africains, fiers et solidaires, héritiers d’un continent uni par l’histoire et le destin ? Ou bien avons-nous trouvé plus pratique de diviser l’Afrique en “eux” et “nous” ? Parce que, soyons honnêtes, “eux”, ce sont les bras qui travaillent, les corps qui peinent, les ombres invisibles. Et “nous”, ce sont les cœurs compatissants, mais de loin, très loin. Après tout, le panafricanisme, c’est beau, tant que ça reste une idée. Pas une réalité.
Racisme ordinaire ? Non, voyons ! Nous, racistes ? Jamais. Juste un léger malaise, un peu de condescendance, et, allez, disons-le, un refus obstiné de partager ce qui est déjà trop peu pour “nous”.
Mais il y a une solution, bien sûr, et elle est typiquement algérienne : amenez-les d’où ils viennent, dans des bus escortés, pourquoi pas une bouteille d’eau et un sandwich pour le voyage. Pas besoin de les ramener jusqu’à chez eux. Juste à la frontière, histoire de ne pas trop se fatiguer. Une autre manière, subtile et élégante, de faire la propagande de notre légendaire hospitalité. Après tout, c’est l’intention qui compte, non ?
Un peu d’histoire, pour comprendre comment on en est arrivés là. Le mot Afrique. Vous saviez que ce sont les Romains qui nous l’ont collé ? Ah bon, tiens ! Ils ont baptisé leur province (Carthage et Numidie) conquise : Africa ! Merci pour le cadeau. Ça viendrait des Afri, un peuple autochtone, ou peut-être du berbère ifri, “caverne”. D’autres disent que c’est phénicien, afar, “poussière”. Bref, on ne sait pas trop, mais peu importe. Une chose est sûre : on était les premiers à porter le nom du continent. Fier héritage qu’on a soigneusement balayé sous le tapis.
Les Arabes, eux, n’ont pas cherché bien loin. Ils ont simplement repris ce que les Romains avaient laissé. Africa est devenue Ifriqiya. Pas de révolution, juste une petite arabisation du nom, en passant. Puis, avec le temps, l’Ifriqiya s’est effacée pour laisser place au Maghreb arabe “Maghreb El Arabi” . Là, c’est clair : nous ne sommes pas Africains, nous sommes Arabes. Et hop, doucement mais sûrement, l’Afrique s’est retrouvée reléguée en arrière-plan. Invisible. Oubliée.
Et comme si ça ne suffisait pas, les Français sont arrivés. Pas question de se casser la tête, évidemment. Ils ont juste francisé ce que les Arabes avaient arabisé. Le Maghreb arabe ? Le Grand Maghreb. Une couche de peinture française sur une base arabe. Voilà tout. Mais avec un petit supplément colonial : découper l’Afrique en cases, mettre le Nord sur un piédestal, et repousser le reste du continent dans l’ombre. Résultat ? On n’est plus Africains ! Une identité flottante, coincée quelque part entre l’Europe et l’Afrique, sans vraiment appartenir à l’une ni à l’autre.
Ça, c’est ce que l’histoire nous rappelle. Mais revenons à “nous”. Aujourd’hui, on a gardé ce même mépris bien pratique. Regardez nos politiques : ils arpentent l’Afrique, signent des accords, paradent dans les sommets, et se posent en champions du panafricanisme. On construit des projets pharaoniques comme la Transsaharienne et la grande ligne de chemin de fer qui relie Alger à Tamanrasset, censées nous ouvrir les portes de l’Afrique profonde. Nous, la porte de l’Afrique! Rien que ça. Un titre qu’on adore se donner.
Mais en réalité ? Cette porte est solidement verrouillée. Et quand elle s’ouvre, ce n’est pas pour accueillir des hommes, mais pour faire passer des richesses. Bah oui, les matières premières, ça ne dérange pas, mais les Africains eux-mêmes ? Ah non, faut pas exagérer. Vous imaginez le désordre ?
Et pourtant, imaginez un instant : ce génie africain, celui qui comble déjà les manques des Européens dans tous les secteurs, s’il était mis à profit ici, en Algérie, toute proche. Avec une vraie politique d’ouverture, ce qu’il pourrait ramener comme idées, comme talents, comme opportunités économiques… Mais non, on préfère l’ignorer, le repousser, continuer à croire que nous sommes trop différents, trop « autres« .
Une belle porte, bien huilée, qui s’ouvre juste assez pour laisser passer ce qu’on peut exploiter : profits, et, soyons fous, une ou deux médailles de grande puissance régionale. Mais dès qu’il s’agit d’échanger, d’apprendre, ou… Dieu nous en préserve, de s’enrichir des autres, cette porte se referme aussi vite qu’un courant d’air suspect. Ah non, pas question de laisser entrer un souffle de diversité, ça risquerait d’aérer nos certitudes et de rafraîchir nos esprits moisis.
Une Algérie qui aurait pu briller comme une perle dans ce continent, mais qui préfère être un sas : pratique, fonctionnel, et surtout bien vide. Stérile, inutile… mais tellement rassurant. Parce que rester figés dans notre petit entre-soi étouffant, c’est ça, notre fierté nationale. Et puis, qui veut vraiment respirer autre chose ? On préfère : nchemou khra ba3dhana.
Za3im