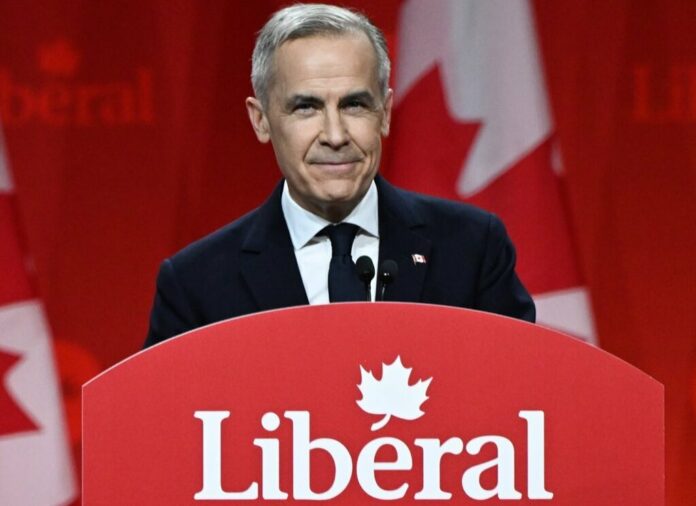Dans son rapport sur les droits humains 2024, Amnesty International alerte sur une crise mondiale des droits humains et un « effet Trump » qui accélère les tendances destructrices. Nous publions ci-dessous la partie traitant de l’Algérie.
Les autorités ont maintenu la fermeture de l’espace civique et réprimé sévèrement les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association. Elles ont continué d’écraser l’opposition pacifique en utilisant des accusations infondées de « terrorisme », notamment contre des militant·e·s politiques, des journalistes, des syndicalistes et des défenseur·e·s des droits humains. Elles ont durci la peine encourue pour sortie illégale du territoire algérien et instauré une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour aide à la sortie illégale du territoire.
Au moins 31 404 personnes réfugiées ou migrantes ont fait l’objet d’expulsions collectives et illégales vers le Niger. Les autorités n’ont pas enquêté sur des allégations de torture et d’autres mauvais traitements. La société civile a recensé 48 féminicides ; le pays ne tenait toujours pas de statistiques officielles exhaustives sur les violences liées au genre. Une sécheresse prolongée due au changement climatique a eu des effets néfastes en matière de droits humains.
Les autorités ont pris des mesures pour lutter contre l’inflation ; l’augmentation des prix des denrées alimentaires a ralenti, mais est restée élevée.
Contexte
Une élection présidentielle anticipée s’est tenue le 7 septembre. Selon la Cour constitutionnelle, le président, Abdelmadjid Tebboune, a été réélu avec 84,3 % des suffrages exprimés et le taux de participation a été de 46,1 %.
En juillet, la Banque mondiale a modifié la classification de l’Algérie, la faisant passer de revenu intermédiaire inférieur à revenu intermédiaire supérieur, à la suite d’une révision des statistiques des comptes nationaux entreprise par les autorités. D’après l’initiative World Weather Attribution, la vague de chaleur extrême qui a frappé en juillet la région méditerranéenne, dont l’Algérie, était liée au changement climatique.
Répression de la dissidence
Les autorités ont cette année encore restreint les droits à la liberté d’association et de réunion pacifique des membres des partis d’opposition, et ont arrêté arbitrairement et poursuivi en justice des militant·e·s politiques d’opposition qui n’avaient fait qu’exerce leurs droits fondamentaux.
En août, la justice a soumis des militant·e·s politiques à des conditions de contrôle judiciaire abusives, leur interdisant notamment toute publication, toute intervention dans les médias et toute activité politique.
Libertés d’association et de réunion pacifique
Les autorités ont continué de très peu tolérer les rassemblements pacifiques et autres réunions non violentes.
Durant l’année, les forces de sécurité ont empêché la tenue d’au moins trois événements culturels ou relatifs aux droits humains et arrêté au moins 64 militant·e·s qui tentaient d’organiser des rassemblements pacifiques. En mars, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT s’est déclaré profondément préoccupé par les multiples difficultés rencontrées par les dirigeant·e·s de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) et de ses organisations affiliées dans l9exercice de leurs droits syndicaux et de leur droit à la liberté d’association.
Dans son rapport paru en mai, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a déclaré que la criminalisation de l’action de la société civile en Algérie avait « un effet dissuasif et cré[ait] un climat de peur, entraînant un fort rétrécissement de l’espace civique ».
Les autorités ont continué d’utiliser couramment des accusations de terrorisme sans fondement et formulées en termes vagues pour réprimer l’opposition pacifique. Mohamed Tadjadit, militant et poète, a été détenu arbitrairement pendant neuf mois à la suite de son arrestation le 29 janvier pour « terrorisme ». Le 28 mars, le syndicaliste Hamza Kherroubi, président de l’Union algérienne des industries (UAI), affiliée à la COSYFOP, a été injustement déclaré coupable de charges sans fondement liées au terrorisme et condamné à 20 ans de réclusion.
Liberté d’expression et liberté de la presse
Le 28 avril, le président a ratifié la Loi no 24- 06 modifiant et complétant l’Ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. Le nouveau texte introduisait de nombreuses modifications formulées en des termes excessivement vagues et larges, ainsi que de nouvelles dispositions facilitant les poursuites judiciaires pour des actes protégés par le droit international relatif aux droits humains. Il pourrait accroître l’autocensure et empêcher la tenue de débats libres et ouverts sur des sujets d’intérêt public.
Les autorités ont continué d’entraver le travail de journalistes en les soumettant à des arrestations et des poursuites arbitraires, ainsi qu’en infligeant des sanctions illégales à des médias indépendants. Le 13 juin, la cour d’appel d’Alger a confirmé la dissolution arbitraire du groupe de presse Interfaces Médias, après la condamnation en juin 2023 de son directeur et fondateur, Ihsane El Kadi, à sept ans de prison sur la base d’accusations vagues et forgées de toutes pièces.
Ihsane El Kadi a été libéré le 1er novembre à la faveur d’une grâce présidentielle accordée à 4 000 détenu·e·s, dont ont bénéficié également le militant Mohamed Tadjadit (voir Lutte contre le terrorisme et droits humains), le défenseur des droits humains Mohad Gasmi et au moins 20 autres militants, défenseurs des droits humains et journalistes détenus arbitrairement.
Les autorités ont aussi imposé ou maintenu des interdictions arbitraires de voyager et d’autres restrictions à l’encontre de militant·e·s, d’avocat·e·s, de syndicalistes et de journalistes pour des actes liés à l’exercice de leurs droits fondamentaux, dont la liberté d’expression.
Droits des femmes
Le Code pénal et le Code de la famille contenaient toujours des dispositions contraires au droit international relatif aux droits humains, car discriminatoires à l’égard des femmes en matière d’héritage, de mariage, de divorce, de garde des enfants et de tutelle. Des groupes de défense des droits des femmes continuaient d’appeler à l’abrogation de ces dispositions.
Au 23 décembre, le groupe militant Féminicides Algérie avait recensé au moins 48 féminicides. Il n’existait pas de statistiques officielles exhaustives sur les violences liées au genre. Ces violences étaient d’ailleurs probablement loin d’être toujours signalées compte tenu de la réprobation sociale, de l9inaction de la police, du nombre limité de foyers d’accueil, de la peur de subir de nouvelles violences et d9autres obstacles rencontrés par les femmes et les filles en quête de protection et de justice.
Le Code pénal condamnait toujours les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe, qui étaient passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement assortis d’une amende.
Droits de circuler
La Loi numéro 24-06 a porté à trois ans d’emprisonnement (contre six mois auparavant) la peine maximale pour sortie illégale du territoire algérien. L’article 175 bis 1 de cette loi a instauré une nouvelle peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’incarcération pour « quiconque facilite ou tente de faciliter, de manière directe ou indirecte » la sortie illicite d’une personne du territoire.
Droit des personnes réfugiées ou migrantes
Selon l’organisation Alarme Phone Sahara, l’Algérie a procédé à l’expulsion sommaire et collective d’au moins 31 404 personnes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes vers le Niger.
Liberté de religion
Les autorités ont continué de recourir à l’ordonnance numéro 06-3, discriminatoire envers les adeptes de religions autres que l’islam sunnite, pour violer les droits de personnes non musulmanes n’ayant fait que pratiquer leur religion, notamment en les poursuivant en justice.
L’Église protestante d’Algérie a indiqué que 46 de ses 47 églises restaient closes, soit pour cause de harcèlement judiciaire, soit parce que les autorités avaient ordonné leur fermeture.
Tortures et mauvais traitements
Les autorités judiciaires et les services de sécurité ont continué d’ignorer les allégations de détenus faisant état de torture et d’autres mauvais traitements. Aucune enquête n’a été ouverte sur la plainte déposée le 12 août par le journaliste Merzoug Touati, qui accusait des policiers de la ville de Béjaïa, dans le nord-est du pays, de l’avoir torturé et maltraité afin qu’il révèle où se trouvait son téléphone, et notamment de l’avoir menacé de violences sexuelles en garde à vue.
Cette année encore, l’Algérie n’a pas soumis au Comité contre la torture de l’ONU son quatrième rapport périodique, qu’elle était censée remettre en 2012.
Droit à un environnement sain
Un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne paru en janvier a mis en évidence les effets des sécheresses graves et persistantes liées au changement climatique dans la région méditerranéenne, notamment en Algérie, soulignant leurs répercussions négatives sur l’agriculture, les écosystèmes, la disponibilité de l’eau potable, la production d’énergie et le risque d’incendie.
Face à la sécheresse, l’Algérie a annoncé le 8 février un programme de réhabilitation de plusieurs usines de traitement des eaux usées, avec pour objectif déclaré que 60 % de l’eau utilisée pour l’irrigation soit issue du traitement des eaux usées d’ici 2030.
Le 8 juin, des manifestations ont éclaté dans la région de Tiaret, au nord-ouest du pays, après des mois de pénurie d’eau et de rationnement liés à la sécheresse.
Le gouvernement a renvoyé des responsables locaux qu’il accusait de mauvaise gestion, déployé des camions-citernes et annoncé la construction d’une conduite d’adduction d’eau. L’Algérie figurait toujours parmi les neuf pays du monde ayant brûlé en torche les plus gros volumes de gaz. Cette pratique émettrice de gaz à effet de serre était susceptible de porter atteinte à la santé des populations environnantes. En juin, la Banque mondiale a constaté une réduction de 5 % du volume de gaz « torché » et une baisse de 3 % de l’intensité du torchage en Algérie par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une diminution de 2 % de la production pétrolière.
Droits économiques et sociaux
Le 1er juillet, un tribunal a injustement condamné le militant de la société civile Rabah Kadri à un an de prison avec sursis, une amende et le versement de dommages et intérêts pour ses publications sur TikTok critiquant la situation socioéconomique de la population algérienne et réclamant des changements politiques. L’augmentation des prix des denrées alimentaires a ralenti mais est restée élevée (près de 5 % d’inflation), menaçant les droits à l’alimentation, à la santé et au logement des catégories les plus pauvres de la population.
Selon la Banque mondiale, la nourriture représentait plus de la moitié des dépenses des ménages chez les 40 % les plus pauvres. Le budget de 2024 a mis en place des exonérations de taxes sur les ventes et les importations de plusieurs produits alimentaires, augmenté d’environ 15 % l’échelle des salaires pour les employé·e·s du secteur public, et revalorisé les allocations versées aux étudiant·e·s et aux personnes en situation de handicap ou sans emploi. Les autorités ont annoncé un nouveau contrat aidé pour l’embauche de chômeurs ou de chômeuses en avril et une hausse de 10 à 15 % des retraites en mai.
L’Algérie n’avait toujours pas soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels [ONU] son cinquième rapport périodique, qu’elle était censée remettre en 2015.
Ci-dessous le rapport complet
- Publicité -